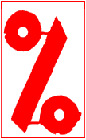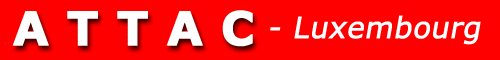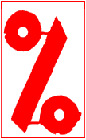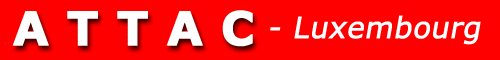|
|
 |
L'UNION
EUROPEENNE: LA TAXE TOBIN ICI ET MAINTENANT!
Par Bruno Jetin
La mondialisation est souvent présentée comme une fatalité qui vient de
l'étranger et qui s'impose à nous sans que l'on puisse rien faire. C'est
une idée qu'il faut rejeter car elle est tout simplement fausse.
Tout n'est pas mondialisé, et jamais totalement, et rien ne serait possible
sans la volonté, l'assentiment ou la complicité de nos gouvernements.
Depuis la fin des années 1970, les gouvernements du G7 se sont acharnés
à promouvoir le libre-échange, à déréguler les marchés financiers et à
légaliser le droit des capitaux à se déplacer d'un continent à l'autre.
Le FMI, l'homme de main du G7, s'est employé à contraindre les pays du
Tiers monde à faire la même chose. Avec les catastrophes que l'on connaît:
En 1997, c'est l'équivalent de 11% de la richesse nationale de la Corée,
de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines et de la Thaïlande qui
ont fuit en quelques semaines, plongeant ces pays dans une grave crise
économique et surtout sociale. Depuis, rien de décisif n'a été réalisé
pour que ces catastrophes ne se renouvèlent. Et pourtant le ralentissement
mondial de l'économie se confirme, des pays comme l'Argentine, élève modèle
du FMI, sont déjà dans le gouffre, et les difficultés s'accumulent pour
les autres pays du sud.
N'y a-t-il rien à faire? Est-on à court d'idées? Par où commencer? Le
bon sens devrait conduire à stopper net les mesures qui ont prouvé leur
nocivité: stopper net l'intégrisme du libre-échange, stopper net le droit
des capitaux à aller et venir d'un coin à l'autre de la planète. Des propositions
existent, débattues par les opposants à la mondialisation néo-libérale.
On peut en citer quelques unes: Une taxe mondiale sur les profits des
firmes multinationales, rétablir le droit des Etats à accepter où à refuser
les investissements directs, et en matière de finance internationale,
taxer les transactions financières à commencer par les transactions de
change.
L'idée de taxer les transactions de changes est connue sous le nom de
"taxe Tobin". Son auteur, le prix Nobel d'économie J. Tobin, est un libéral
tempéré partisan du libre-échange, de l'OMC, de la Banque Mondiale et
du FMI. Dans ces conditions, pourquoi sa proposition de taxer les transactions
de change a-t-elle séduit beaucoup d'opposants à la mondialisation néo-libérale?
"L'idée est simple: il s'agit d'effectuer sur chaque opération de change
un prélèvement minime équivalent à 0,5% de la transaction. De quoi faire
fuir les spéculateurs" ( ) En cas de fuite des capitaux, une taxe élevée
éviterait aux Etats d'augmenter les taux d'intérêt à des niveaux astronomiques
et de plonger leur pays dans la crise. "La taxe Tobin redonnerait une
marge de manoeuvre aux banques centrales des petits pays pour lutter contre
la tyrannie des marchés financiers " (idem).
Tant pis si J. Tobin affirme "n'avoir rien de commun avec les practiciens
de cette révolution contre la mondialisation". C'est cette idée initiale
qui nous intéresse. Elle fait désormais partie du débat public, qui l'a
fait progresser du point de vue de son efficacité et de sa faisabilité.
Deux exemples: la taxe sera plus efficace si son taux est proportionné
à l'intensité de la spéculation. En temps normal, une taxe de 0,1% pourrait
être suffisante pour dissuader la spéculation ordinaire. En temps de crise,
on ne pourra contenir un raz de marée spéculatif suivi d'une fuite des
capitaux qu'à l'aide d'une taxe élevée (de 1% à 10%) complétée par des
mesures complémentaires de contrôle des capitaux. Deuxième exemple, la
faisabilité. On peut rompre la logique du tout ou rien. La spéculation
est mondiale et la "taxe Tobin" est intéressante car elle a une vocation
universelle. Mais des régions du monde comme l'Europe peuvent prendre
l'initiative de mettre en oeuvre la "taxe Tobin".
Pourquoi? Parce que même la finance n'est pas totalement mondialisée.
Ce qui est mondialisé, c'est la négociation de la transaction de change:
un professionnel d'une banque prend son téléphone pour appeler un collègue
proche ou à l'autre bout du monde pour lui demander à combien il vend
ou achète telle ou telle monnaie. Par contre la "livraison" des monnaies
s'effectue, en dernier ressort, grâce à des systèmes de règlements nationaux
sur lesquels chaque banque centrale exerce une activité de surveillance
et de contrôle du respect de la législation nationale. Mieux, la "livraison"
se matérialise par un jeu d'écriture dans les comptes que chaque banque
privée est tenue d'ouvrir auprès de la banque centrale des pays où elle
opère. Ce jeu d'écriture est entièrement réalisé grâce à des programmes
informatiques de pointe qui identifie et enregistre l'identité des banques
et la nature de la transaction. Même si au départ une société privée chargée
d'effectuer la "livraison " des monnaies est localisée dans un paradis
fiscal, ses clients, eux, sont majoritairement localisés dans les grandes
économies de la planète. Pour avoir accès à ses clients, cette société
doit respecter la législation nationale en vigueur. Il est donc techniquement
et juridiquement possible de collecter la taxe Tobin. A chaque fois qu'une
transaction de change réalisée par une banque est identifiée, la taxe
serait automatiquement prélevée et versé sur un compte spécial de la banque
centrale, avec un coût nul.
La création de l'euro rend la collecte encore plus simple, puisque les
pays de la zone euro ont décidé d'unifier leurs systèmes nationaux de
règlement en un système unique appelé "Target". Il est géré par la Banque
Centrale Européenne qui s'appuie en cela sur les banques centrales nationales.
Target est même ouvert aux pays, qui comme la Grande-Bretagne, n'ont pas
adopté l'euro. L'Union Européenne dispose de la puissance économique nécessaire
pour instaurer la taxe à chaque conversion de l'euro dans une autre monnaie,
le dollar et le yen par exemple. Elle pourrait créer la première "zone
Tobin". Elle modifierait le rapport des forces politiques actuelles à
l'échelle internationale et au sein de chaque pays. En prouvant que c'est
possible, elle inciterait d'autres pays de la planète à la rejoindre.
Le ministère des finances de la France a même chiffré les recettes pour
la seule Union Européenne à une fourchette de 22 à 26 milliards d'euros,
qui pourraient être consacrés au financement du développement. On pourrait
reprendre la démarche du budget participatif initié par la ville de Porto
Alegre pour confier le soin aux populations du Tiers-Monde de définir
elles-mêmes les priorités sociales et écologiques à financer.
|