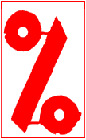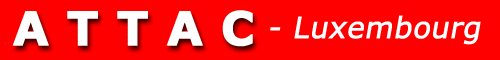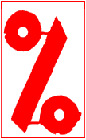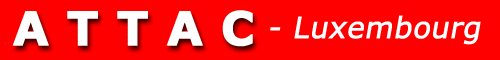|
|
 |
FISCALITES
EN EUROPE:
le secret bancaire en point de mire!
L'Accord conclu, en novembre 2000 au sein d'Ecofin (le conseil des quinze
ministres de l'Economie et des Finances de l'Union européenne) est-il
un pas "historique" vers une fiscalité plus équitable, où chacun(e) participerait,
par ses impôts, au financement des besoins collectifs et sociaux, au prorata
de ses revenus et de son patrimoine? La difficile "harmonisation fiscale
européenne" doit-elle rester un prétexte pour justifier des dispositifs
qui empêchent de mettre davantage à contribution les plus riches?
Une fiscalité au service du néolibéralisme
Plus que les discours, les politiques effectivement menées permettent
de juger de la réalité des choix politiques des gouvernements. Les mesures
fiscales, prises aussi bien dans chaque pays membres de l'UE qu'au niveau
européen, ont, jusqu'à présent, renforcé la concentration des richesses
dans les mains d'une poignée de groupes et de personnes et creusent, en
même temps, les inégalités sociales.
En 1989/90, les ministres des Finances de l'Union européenne adoptaient
la liberté totale de circulation des capitaux entre les Etats de cette
zone de libre échange. Ceci concerne à la fois les monnaies (avec la fin
du contrôle des changes, notamment) et les actions/obligations (avec la
création de nouveaux produits financiers). A partir du 1er janvier 1993,
les frontières au sein de l'UE ont disparu, avec, comme conséquence immédiate,
la suppression de tout contrôle ou formalité à finalité fiscale, lors
du franchissement physique des frontières intracommunautaires par les
marchandises.
Tout ceci s'est fait sans prévoir une harmonisation des taxations des
capitaux et des revenus des capitaux. Les privilèges fiscaux accordés
au capital et à ses revenus se sont accrus au fil de la construction européenne.
Aux motifs avancés d'"attirer les capitaux pour l'investissement et pour
l'emploi", on a vu fleurir les mesures fiscales dérogatives pour les entreprises,
visant à favoriser certaines zones géographiques (zones franches, etc.)
ou certaines activités (par exemple, les centres de coordinations en Belgique).
De plus, la fraude fiscale en matière de TVA des entreprises a crû de
manière considérable depuis le 1er janvier 1993, avec la suppression des
frontières au sein de l'UE. Au niveau européen, on peut risquer l'estimation
de plus de 2000 milliards de FB de perte annuelle de recettes budgétaires.
En matière d'impôts sur les patrimoines et les revenus des particuliers,
les modifications intervenues ces dernières années dans plusieurs pays
de l'UE ont été dans le même sens d'un allégement de la taxation des hauts
revenus. En laissant croire aux pauvres et aux classes moyennes que leurs
impôts vont sensiblement diminuer, les couches aisées ont l'opportunité
de faire baisser leur contribution aux budgets publics (voir la dernière
réforme fiscale en Belgique). L'impôt sur les grosses fortunes, minime
mais existant tout de même dans plusieurs pays -Allemagne, Italie, Danemark,
France- risque lui aussi d'être abandonné. Les paradis fiscaux, avec leur
secret bancaire, leur vide juridique et leur fiscalité faible ou nulle,
jouent également un rôle déterminant pour tirer vers le bas la taxation
du capital.
Pour éviter de creuser les déficits publics - dus principalement à la
baisse de l'impôt sur les entreprises, la réduction des cotisations patronales
à la sécurité sociale (149 milliards en Belgique pour 2001), l'absence
ou la faible taxation des patrimoines financiers (et les revenus engendrés
par ceux-ci) ainsi que des profits spéculatifs, les Etats de 1'UE ont
augmenté la charge fiscale pesant sur le travail salarié, non mobile,
et sur les consommations des ménages (les impositions indirectes touchant
de la même manière le chômeur et le riche!). En même temps, le remboursement
de la dette publique (en Belgique, plus de 600 milliards par an, remboursés
surtout aux organismes financiers dans le pays, soit plus du quart du
budget total de l'Etat), avec le recul de la masse salariale et la stagnation
des salaires, des pensions et des minima sociaux, permettent de mieux
rémunérer encore les actionnaires, les groupes financiers.
L'accord "historique" des Quinze sur la fiscalité de l'épargne En novembre
2000, les quinze ministres de l'Economie et des Finances (Ecofin) aboutissaient
à un accord destiné à harmoniser la fiscalité des revenus de l'épargne.
Accord qui devrait, dès le 1er janvier 2003, mettre fin à la concurrence
déloyale entre Etats membres, dont certains attirent l'épargne des citoyens
des autres pays grâce à des conditions fiscales nettement plus avantageuses.
L'accord prévoit également un code de bonne conduite de la fiscalité des
entreprises. Est-ce la fin programmée des paradis fiscaux pour les Européens
qui place leur épargne dans un autre Etat de l'Union, ou encore des régimes
préférentiels pour des entreprises? Est-ce la fin du secret bancaire à
l'horizon 2010? Première précision. Cet impôt sur les revenus des épargnants
non-résidents ne vise pas les actifs les plus rentables, à savoir les
actions et les plus-values générées par la spéculation boursière. Il touche
les obligations domestiques ou internationales, les intérêts (les titres
à revenus fixes et les comptes bancaires), les revenus distribués par
les sicav (et par leurs dérivés) à condition que ceux-ci se rattachent
à des obligations. La directive devrait exclure tous les fonds qui investissent
dans au moins 60% d'actions, ce qui devrait "donner beaucoup d'imagination
à la place financière", a estimé le ministre luxembourgeois du Budget,
Luc Frieden.
Deuxième précision. L'accord prévoit une période transitoire de 7 ans
( 2003-2010), avec, en bout de piste, la levée généralisée du secret bancaire.
Pendant cette période, trois pays, le Luxembourg, l'Autriche et la Belgique,
qui maintiennent leur secret bancaire, appliqueront une retenue à la source
des revenus de l'épargne de 15% (pendant 3 ans), puis de 20% (les 4 années
suivantes). La retenue à la source est un impôt forfaitaire anonyme, bien
accommodant pour une grosse fortune, surtout si elle n'a pas été déclarée
aux autorités fiscales (en vert du secret bancaire!). Les recettes prélevées
sur les non-résidents seront partagées entre le pays de l'épargnant (75%)
et le pays où est prélevée la taxe (25%).
A quoi serviront ces recettes supplémentaires? Le ministre des Finances,
Didier Reynders, a déjà sa petite idée: "elles serviront à financer la
poursuite de la réduction des charges pesant sur le travail (les charges
des entreprises!)". De même, les recettes obtenues par le démantèlement
du régime fiscal favorable accordé aux centres de coordinations des entreprises
multinationales (les effets d'un tel régime de faveur devraient cesser
au plus tard fin 2005 ou au-delà "pour tenir compte de circonstances particulières"!)
devraient servir à financer la baisse du taux nominal d'imposition des
entreprises. Un donné pour un repris en quelque sorte, même si le chiffre
météorique de 362,4% d'augmentation des profits des multinationales dans
le monde a été avancé pour la période située entre 1983 et 1999.
Pendant cette période de 7 ans, les douze autres Etats (qui ont déjà levé
partiellement ou totalement le secret bancaire) appliqueront l'échange
généralisé et automatique d'informations sur le revenu tiré de l'épargne
de leurs non-résidents. Troisième précision. Fin 2002, les Quinze d'Ecofin
devront voter à 1'unanimité la directive qu'il faudra encore transcrire
dans les droits nationaux. Et oui, quand l'Europe veut avancer dans la
privatisation des services publics, la règle de l'unanimité ne joue pas
et les directives sont contraignantes. Quand il s'agit de justice fiscale
ou d'Europe sociale, l'unanimité est la règle du jeu.
Ce n'est pas tout: d'ici fin 2002, l'Europe des Quinze devra obtenir de
"pays tiers" - la Suisse, le Lichtenstein, Andore, Saint-Marin, Monaco
ou encore les îles Anglo-Normandes - qu'ils lèvent leur secret bancaire.
Le Luxembourg, premier centre en Europe pour les fonds d'investissements,
en fait un préalable. La directive sur l'épargne pourrait bien ainsi attendre
des années encore. Sauf si!
Mobilisations sociales et citoyennes
La fiscalité n'est ni une question "technique", ni un problème "complexe".
C'est un sujet totalement politique qui doit être pris en charge par les
citoyens. Sans justice fiscale, il ne peut y avoir de justice sociale.
Un rapport de force social et politique est un préalable évident face
aux multiples tergiversations et hypocrisies qui enrobent ce dossier de
l'harmonisation fiscale des revenus du capital.
La présidence belge de l'Union européenne offre l'occasion de construire
ce rapport de force dans l'unité la plus large. C'est l'occasion d'exiger
du gouvernement fédéral une double démarche: proposer des directives précises
au niveau européen et concrétiser sans attendre certaines mesures sur
le plan national. Pour régler démocratiquement l'harmonisation de la fiscalité
du capital, l'Union européenne devrait se doter d'une directive contraignante
abolissant le secret bancaire fiscal et obligeant les Etats à échanger
périodiquement les informations sur tous les revenus générés par les produits
financiers, y compris les plus-values. Dans le même temps, une autre directive
pourrait établir un dispositif de sanctions à l'égard des paradis fiscaux
et des centres offshore. La plate-forme d'Attac et ses nombreuses contributions
en vue du démantèlement de ces pratiques méritent d'être soulignées.
La Belgique est probablement aujourd'hui le pays de l'UE le plus rétrograde
en matière de transparence fiscale. Quand on compare la Belgique par exemple
avec les trois pays voisins qui font également office de référence en
matière de formation des salaires (Allemagne, France, Pays-Bas), il apparaît
que le fisc belge est le fisc le plus mal outillé pour obtenir auprès
des institutions financières des informations sur les contribuables. C'est
un des derniers pays au secret bancaire, sans cadastre des patrimoines
mobiliers (financiers) et sans impôt sur la fortune.
Une note commune de la FGTB et de la CSC, datée de septembre 2000 soulignait:
"le FGTB et la CSC sont conscientes que certaines avancées ne pourront
se faire qu'à l'échelle européenne. L'Union européenne ne peut toutefois
pas toujours servir d'alibi: certaines mesures peuvent être prises à l'échelle
belge pour assurer une meilleure connaissance de certains revenus et,
par ce biais, une meilleure contribution de ces revenus aux recettes de
l'Etat" Et de citer, comme mesures indispensables: "la suppression du
secret bancaire fiscal, notamment pour permettre à l'administration fiscale
une meilleure perception et un meilleur recouvrement de l'impôt"; "la
suppression des titres "au porteur" pour les remplacer par des "actions
nominatives".
En ce sens, nous saluons la campagne nationale de la CSC qui veut récolter
d'ici juin (avant la présidence belge de l'UE) au minimum 300.000 pétitions,
portant sur la suppression du secret bancaire et la mise en place d'un
cadastre des fortunes au niveau belge, ainsi qu'un impôt sur la fortune
au niveau européen. Des revendications qui font également partie des résolutions
de la FGTB et avancées également, depuis 1996, par l'Appel des six cents.
N'est-ce pas le moment de porter ensemble, ces revendications: organisations
syndicales, sociales, réseaux (Attac, réseau contre la spéculation financière,
Appel des six cents), partis!
N'est-ce pas, pour la Belgique qui présidera de juin à décembre 2001 le
Conseil européen des chefs d'Etat et de gouvernement ou encore le Conseil
Ecofin, le moment de "balayer d'abord devant sa porte"!
Denis Horman, membre d'ATTAC-Liège, animateur de l'Appel des six cents.
liege@attac.org
|