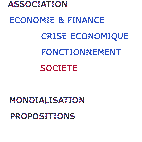|
|
|
| Messager 1 | Messager 2 | Messager 3 |
| Messager 4 | Messager 5 & 6 | Messager 7 |
LE MESSAGER SYNDICAL N°1 Juin 2000
Bulletin d’information sur le mouvement ouvrier en Fédération de Russie
Après dix années de réformes libérales brutales, la Russie connaît une crise économique et sociale sans précédent. Le paysage social est dévasté : fermeture massive des entreprises, hausse des prix, salaires non payés (en mars 2000 la dette salariale s’élevait à 44 milliards de roubles, soit 9 milliards de francs), dégradation des systèmes de santé et d’éducation. L’immense majorité de la population a basculé dans la misère (au moins 35% de la population vit aujourd’hui au dessous du seuil de pauvreté, fixé à 200 FF par mois !) et est condamnée à des logiques de survie au quotidien.
Face à cette politique dévastatrice, les résistances ont été faibles, morcelées, incapables de donner un coup d’arrêt - même provisoire, aux processus en cours. Il y a à cela plusieurs raisons : la violence même de la “ thérapie de choc ” qui a laissé la population littéralement assommée, la faiblesse du mouvement syndical, qu’il s’agisse de la Fédération des syndicats indépendants (syndicats issus de la période soviétique) ou des nouveaux syndicats (numériquement faibles et, pour certains, corporatistes), la solidarité très faible (pour ne pas dire inexistante) entre les travailleurs des différentes branches, l’absence de tout système politique (partis, associations, mouvements) où la société civile pourrait faire entendre sa voix, la “ privatisation ” de l’Etat et des ses institutions pour le seul profit de quelques oligarques proches du Kremlin.
Dans cette période très difficile, le mouvement syndical en Russie, et plus généralement tous ceux qui sont attachés à la défense des intérêts des travailleurs a un besoin vital de contacts et d’échanges avec le mouvement syndical international. Dans la mise en place d’un tel espace, le manque d’informations est un obstacle important. La création du Messager syndical vise à combler, au moins en partie, ce vide.
Ce bulletin d’informations mensuel est publié à l’initiative de deux chercheurs français spécialistes de la Russie (Carine Clément et Denis Paillard ), en étroite collaboration avec l’Ecole de la démocratie du travail de Moscou, qui, depuis huit ans, organise en Russie des stages de formation pour des militants syndicaux, venus de tous les secteurs professionnels et appartenant aussi bien à la Fédération des syndicats indépendants qu’aux nouveaux syndicats. L’Ecole de la démocratie du travail a aussi publié plusieurs dizaines de brochures de formation.
Chaque mois, le Messager syndical publiera deux pages d’informations brèves sur l’actualité syndicale et les luttes en cours ainsi qu’un dossier de deux pages sur un thème précis : présentation de telle ou telle branche d’activité et des syndicats qui y existent (mineurs, enseignants, etc.), réforme du Code du travail, pauvreté, système de retraites, comptes rendus de luttes significatives, interviews, etc.
Afin de fournir l’information la plus fiable possible, les rédacteurs du Messager utiliseront les sources les plus variées : presse et documents des différents syndicats, bulletin hebdomadaire d’informations syndicales (ASTI) publié par la Fédération des syndicats indépendants, revue de militants et chercheurs de gauche "Alternativy", interviews de militants syndicaux, etc. Comme son nom l’indique, le Messager s’efforcera de contribuer de façon efficace au développement des rapports entre syndicalistes à l’Ouest et syndicalistes de Russie, en répondant y compris à des demandes spécifiques.
Brève présentation des principales organisations syndicales de la Fédération de Russie.
- Fédération des syndicats indépendants. Cette Fédération est l’héritière directe des syndicats de la période soviétique. Elle en a gardé un certain nombre de traits : tant à l’échelon central qu’au niveau de l’entreprise, elle se pose en partenaire responsable des autorités (gouvernement, autorités régionales, direction de l’entreprise). Lors des dernières élections la direction de la Fédération a apporté son soutien à Vladimir Poutine, dans l’espoir de se voir confirmée dans son rôle de partenaire social privilégié.
- Nouveaux syndicats. Ce sont des syndicats apparus dans le sillage de la grande grève des mineurs de 1989, en rupture avec la pratique des anciens syndicats. Ils sont regroupés dans deux confédérations, la Confédération du travail de Russie et la Confédération russe du travail. Certains syndicats (comme celui des travailleurs du métro de Moscou) développent des pratiques strictement corporatistes, d’autres (comme le syndicat Edinstvo de Toliatti) s’efforcent d’articuler défense des travailleurs de l’entreprise et participation à des actions collectives.
- Fédération Zachita truda (“ Défense du travail ”). Revendiquant 20 000 membres (elle est surtout implantée dans la région d’Astrakhan, Moscou et Iaroslav), elle défend l’idée d’un syndicat de combat et une opposition intransigeante à la politique du pouvoir en place. Les mêmes positions sont défendues par les Comités ouvriers de Russie, une organisation moins importante qui regroupe des soviets ouvriers dans plusieurs régions de Russie. Ce sont les premiers syndicats à avoir dénoncé le nouveau Code du travail.
NOUVELLES BREVES.
Réforme du Code de travail.
Actuellement, le Code du travail est toujours le Code du travail hérité de la période soviétique (même s’il est systématiquement non appliqué).En 1998, le pouvoir a mis au point un nouveau Code du travail dont la caractéristique essentielle est de priver les travailleurs de tous leurs droits face aux patrons. Il fait ainsi passer la journée de travail de 8 à 12 heures, encourage la flexibilité, le travail sur plusieurs postes, légalise le non-paiement des salaires, enlève toute garantie d'emploi pour les syndicalistes et réduit le licenciement à une simple formalité. L’adoption de ce projet avait été bloquée sous la précédente Douma où l’opposition était majoritaire. Le vote du Code est à l’ordre du jour de la session de la nouvelle Douma, beaucoup plus docile. Les différentes Fédérations qui refusent toutes le projet gouvernemental sont partagées sur le type de bataille à mener à cette occasion. La Fédération des syndicats indépendants (issus des syndicats soviétiques) ainsi que certains responsables des nouveaux syndicats (notamment de la Confédération du travail de Russie) ont élaboré un projet alternatif modéré. La Fédération Zachita truda (“ Défense du travail ”) et le Comité des ouvriers de Russie défendent un projet alternatif radical proposé par le député de la Douma T. Avaliani. Le 17 mai, une journée de protestation a été organisée à travers toute la Russie par la Confédération du Travail et par la Fédération Zachita truda. Le vote du nouveau Code a été reporté à l’automne. (Le Messager reviendra en détails sur les batailles autour du Code dans un prochain numéro).
Création d’un groupe syndical à la Douma.
25 députés ont constitué un groupe de travail syndical à la Douma élue en décembre 1999. La majorité de ce groupe est constituée de syndicalistes membres de la Fédération des syndicats indépendants. A.Ivanov, président du syndicat Edinstvo (“ Unité ”) de l’usine d’automobiles de Toliatti et vice-président de la Confédération du Travail de Russie (nouveaux syndicats) ainsi que A.Chein, coprésident de la Fédération syndicale Zachita (“ Défense ”), font également partie de ce groupe (ces deux députés ont été élus au scrutin d’arrondissement).
Statistiques sur les grèves en 1999.
En 1999, le nombre de grèves dans la Fédération de Russie s’est élevé à 7285. Globalement, ces grèves n’ont concerné que les travailleurs payés par l’Etat : enseignants et personnels médicaux. Ces actions visaient à obtenir le paiement de la dette salariale. Dans les autres secteurs les grèves sont extrêmement rares (21 actions de grève recensées pour toute l’industrie). Mais de nombreuses grèves éparses éclatent à des micro-niveaux, dans des ateliers ou usines isolées, et ne passent pas dans les statistiques. La journée d’action nationale qui devait être organisée le 17 mars par la Fédération des syndicats indépendants (à l’instar de celles organisées régulièrement jusqu’en 1998) a été annulée suite à l’annonce par V.Poutine d’un relèvement de 20% des salaires.
Renforcement de la Confédération du travail de Sibérie.
Le 30 janvier 2000, à Novosibirsk, s’est tenue une Conférence de la Confédération du travail de Sibérie. Officiellement, cette Confédération existe depuis 1996 et regroupe les différentes unions territoriales des nouveaux syndicats. A l’occasion de la Conférence, trois nouveaux syndicats ont adhéré. Parmi les documents adoptés le principal est un appel aux associations, aux partis et aux syndicats appelant à se mobiliser contre la détérioration de la législation du travail et surtout contre l’adoption du nouveau Code du travail.
Violences contre les syndicalistes
Récemment, des militants syndicaux sont victimes de tentatives d'intimidation ou même d'assassinat visant à les dissuader de s'opposer aux malversations financières ou aux prédations dont fait l'objet leur entreprise. Il y a trois ans déjà, A.Ivanov, président du syndicat Edinstvo (“ Unité ”) de l'usine automobile de Toliatti, qui dénonçait l’emprise de la maffia sur l’entreprise avait été blessé par balles.. L'année dernière, Oleg Maksakov, coprésident du syndicat Zachita (“ Défense ”) de la région d'Astrakhan, a été tué d'une balle dans le dos. Agé de 36 ans, ce syndicaliste avait à son actif des dizaines d'actions de protestation. Au moment de son assassinat, il menait une campagne pour être élu député de l'assemblée régionale. Il poursuivait également une enquête visant à établir les machinations financières de plusieurs directeurs de la région et avait déjà déposé plusieurs plaintes en justice. Ses camarades du syndicat ne doutent pas qu'il s'agisse d'un assassinat politique commandité. Le 5 avril 2000, Alexeï Rybalko, ouvrier-tourneur dans une usine de production d'appareils de mesure à Oufa et coprésident du syndicat Zachita dans la république du Bachkortostan a été sauvagement agressé par un groupe d'hommes en uniformes de policiers. Il s'en est sorti avec une main cassée et un traumatisme crânien. Deux autres militants du mouvement ouvrier d'Oufa ont subi le même sort dans les mois précédents. Les coupables n'ont jamais été retrouvés.
Une expérience de contrôle ouvrier au combinat cellulose de Vyborg
La politique de privatisation systématique lancée au début des années 90 par le pouvoir a, dans de très nombreux cas, signifié la disparition plus ou moins rapide de l’entreprise. Beaucoup de nouveaux propriétaires, ayant acquis des entreprises pour des sommes dérisoires, se sont révélés moins soucieux de maintenir l’entreprise en activité que de s’approprier les bâtiments, l’équipement, la production existante, avec pour corollaire le non paiement des salaires et des vagues successives de licenciements. Dans la majorité des cas, les travailleurs ont été incapable de s’opposer à cette de liquidation du potentiel productif de leur entreprise. Les exemples de résistance collective sont rares. La lutte menée pendant plusieurs années par les travailleurs du combinat de cellulose de Vyborg pour sauver leur outil de travail est de ce point de vue exemplaire, même si, en janvier 2000, elle a débouché sur un échec.
Situé dans la région de Leningrad, dans la cité ouvrière Sovetski, le combinat de cellulose, entreprise rentable dont l’équipement avait été entièrement renouvelé dans les années 80, constituait une proie idéale. Privatisé en 1994, il change quatre fois de propriétaires, chacun laissant derrière lui une situation financière et économique toujours plus dégradée : chute de la production, emprunts à des taux usuriers, non paiement des salaires. Ce n’est qu’en décembre 1997, lorsque le dernier propriétaire (une firme anglo-cypriote, Alcem) annonce des licenciements massifs et la transformation de l’entreprise en simple scierie que la résistance s’organise. Lors d’une assemblée générale, un Comité de grève est constitué, avec la participation d’élus locaux solidaires. L’usine est placée sous “ contrôle ouvrier ”. Un “ directeur populaire ” (un député de la Douma locale) est élu. Au bout de quelques mois, le Comité de grève se transforme en comité syndical (dont la majorité des membres sont des ouvriers des ateliers. Les travailleurs occupent l’usine et développent la lutte sur plusieurs fronts.
La bataille essentielle est celle de l’ensemble des travailleurs pour la relance de la production ; avec l’intensification de la discipline au travail, la mobilisation de tous les savoir faire, la remise en route des installations. Un appel est lancé aux fournisseurs et aux clients pour qu’ils soient solidaires. Très vite la production repart et l’utilisation du potentiel productif atteint 80%. Les salaires sont payés et progressivement augmentés. Les tâches spécifiques de gestion et de démarchage en direction de l’extérieur sont confiées au directeur populaire.
La seconde bataille est d’ordre juridique. Une plainte contre les propriétaires est déposée devant les tribunaux, afin que les opérations successives de privatisation soient déclarées illégales et annulées. En même temps, l’idée d’une prise de possession de l’entreprise par les travailleurs eux-mêmes est jugée irréaliste. Il s’agit d’obtenir la reconnaissance officielle de l’entreprise populaire et, par l’intermédiaire du Comité syndical, l’ouverture d’un compte bancaire. La déprivatisation de l’entreprise doit déboucher sur une nouvelle forme de propriété avec rétrocession à l’Etat de 51 % des parts, les travailleurs disposant des 49% restants. Cette démarche de renationalisation suscite toutefois des réserves de la part de certains travailleurs (comment faire confiance à l’Etat qui a accepté la privatisation sous sa forme sauvage ?).
Le combat est également mené sur le terrain de la mobilisation, contre les propriétaires et contre le pouvoir régional. Afin de défendre l'usine contre l'éventualité d'une offensive lancée par les premiers, les ouvriers s'organisent en équipes de surveillance. Pour faire pression sur les pouvoirs régionaux (politiques et judiciaires), ils multiplient les actions de protestations (meetings, manifestations, blocages de routes).
Enfin, les travailleurs du combinat accordent également beaucoup d'importance à l'établissement de liens de solidarité locaux ou nationaux. Ils multiplient les actions de sensibilisation auprès de la population de la cité Sovetski et réussissent à obtenir son soutien. La majorité des élus locaux s’engagent à leurs côtés. Des liens sont établis avec des Comités d’autres entreprises en lutte à Saint-Pétersbourg. En décembre 1999, un congrès réunissant des collectifs d’entreprises engagés dans des luttes similaires se tient dans les locaux du combinat. Enfin, les dirigeants de l’usine et du Comité syndical entreprennent des actions de lobbying politique et obtiennent un vote de soutien à leur lutte de la Douma d'Etat, à l’initiative de députés du Parti Communiste de la Fédération de Russie et du Parti Communiste Ouvrier de Russie.
Mais cette mobilisation dans l’entreprise et hors de l’entreprise s’est heurtée à des obstacles de taille. Les propriétaires tentent à plusieurs reprises de reconquérir “ militairement ” l’entreprise. Les media régionaux et surtout nationaux dénoncent les travailleurs du combinat comme des “ fauteurs de troubles ” et surtout comme des gens qui violent le “ droit sacré à la propriété ”. Progressivement, se met en place un véritable blocus économique de l’entreprise qui entraîne l’arrêt de l’approvisionnement y compris en combustible (toute la population de la cité se retrouve privée de chauffage). Enfin, la bataille juridique s’enlise dans d’interminables procès en appel. La lassitude s’empare des travailleurs eux-mêmes. Les quatre derniers mois de 1999, les salaires ne sont plus payés. Des divisions apparaissent entre le directeur populaire et le Comité syndical, au sein même des dirigeants du mouvement, sur la stratégie à adopter : radicaliser la lutte (mais comment ?) ou au contraire chercher un compromis avec les propriétaires de l’entreprise. C’est finalement, sur fond de démobilisation, cette seconde attitude qui l’emporte. En janvier 2000 un accord est signé entre la majorité des travailleurs (qui reçoivent 500 roubles - soit 100FF - en échange du "retour à l’ordre") et la firme Alcem : la firme reprend le contrôle de l’entreprise, s’engage à ne pas licencier et à maintenir le profil de l’entreprise, promet le remboursement de la dette salariale et un salaire moyen égal au salaire moyen régional. L’expérience passée augure mal du respect de ces engagements et, d’ailleurs, la production n’a toujours pas repris.
Environ quarante travailleurs (dont la majorité du comité syndical élu le 27 décembre 1999), ont refusé de signer l’accord.. Chaque matin, ils organisent un piquet à l’entrée du combinat et poursuivent la bataille sur le plan juridique et politique.
Repères chronologiques :
- janvier 1994 : 1è étape de la privatisation. Les salariés n'ont droit qu'à 17% des actions, La firme "Elis-Lak", qui a servi d'intermédiaire, obtient gratuitement 30% des actions. Le reste des actions va à la direction.
- mai 1995 : Ellis-Lak revend ses actions à une société enregistrée à Chypre, "Alliance Cellulose Limited", qui devient majoritaire en rachetant leurs actions aux salariés.
- août 1996 : déclenchement de la procédure de mise en faillite.
- septembre 1997 : mise en vente du combinat, estimé à 266 milliards de roubles (266 millions de francs), soit 5 fois moins que sa valeur immobilière comptable. "Nimonor", une autre firme anglo-chypriote, rachète le combinat pour seulement 187 milliards de roubles, dont elle ne paiera que 22.44 milliards, soit moins du 10è de l’estimation initiale.
- décembre 1997 : le directeur annonce, devant l’assemblée des salariés, son intention de transformer le combinat en scierie, de licencier la moitié du personnel et de ne pas rembourser les dettes salariales accumulées (depuis août 1996, les salaires ne sont quasiment pas payés).
- février 1998 : création d’un comité de grève
- mars 1998 : à l'initiative du comité de grève, les salariés instaurent un contrôle ouvrier de l'usine avec élection d’un "directeur populaire". Redémarrage de la production.
- mars-août 1998 : meetings, actions coups de poing devant les instances juridiques et politiques de la localité et de la région, dans le but d’obtenir le droit d’ouvrir un compte en banque et d’enregistrer l’entreprise "populaire".
- fin 1998 : les salaires augmentent et sont régulièrement payés. Le comité de grève se transforme en comité syndical dont les membres sont élus par l'assemblée des travailleurs.
- début 1999 : le comité syndical dépose une plainte devant le tribunal d’arbitrage de Saint-Pétersbourg.
- mai 1999 : "Nimonor" cède ses droits à "Alcem", une autre firme fantôme.
- 9 juillet 1999 : première tentative musclée des dirigeants d’Alcem pour reprendre le contrôle de l’usine. L’assaut est repoussé par les ouvriers.
- 29 juillet 1999 : les ouvriers bloquent 2 heures l’autoroute Nord-Ouest "Scandinavia".
- août-septembre 1999 : plusieurs piquets sont organisés devant le siège du gouvernement régional.
- 14 octobre 1999 : deuxième assaut contre l’entreprise populaire. Deux ouvriers sont blessés par balle, huit sont retenus en otages pendant plusieurs heures.
- 26-27 novembre 1999 : congrès fondateur des collectifs de travailleurs "en lutte pour le contrôle ouvrier et l’autogestion", organisé par le comité syndical dans les locaux du combinat.
- 15 janvier 2000 : signature d’un accord entre une partie du syndicat, la plupart des chefs d’ateliers et les dirigeants d’Alcem. Les ouvriers permettent l’accès du combinat aux propriétaires qui en reprennent le contrôle.