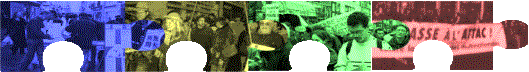 GROUPES LOCAUX
GROUPES LOCAUXMondialisation. Etat des lieux
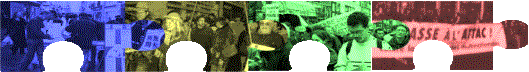 GROUPES LOCAUX GROUPES LOCAUX |
Mondialisation: quel départ pour le XXIe siècle?Transcription de la conférence qui s'est tenue le mercredi 12 janvier 2000 sur le campus universitaire de Jussieu (Paris 5e). Transcription par Raphael Martelli Calvelli Bianchi Résumé 1) Ce que l'on appelle "mondialisation" est en fait le produit d'un rapport de forces, non seulement entre diverses réalisations du capitalisme, mais aussi entre puissances dominantes et puissances dominées. 2) On parle souvent de "mondialisation" à propos des tentatives de régularisation de l'économie qu'opère l'OMC. Mais il existe d'autres tentatives, en particulier celles revendiquées par les divers mouvements protestataires. 3) L'éducation est soumise à la mondialisation des échanges sous la forme d'une pression accrue des entreprises. La massification de l'enseignement et les déficits budgétaires accélèrent le processus. Conférenciers:
Le capitalisme s'affirme aujourd'hui de manière globale et universelle. Dans le monde du réel, par les objets, mais également dans l'imaginaire du monde, comme le montre l'ethnologue Marc Auger à travers cet exemple d'une tribu amérindienne, qui rêve non plus de la contrée des dieux et de la nature, mais des lumières de la ville, la ville à l'occidentale. De plus, la mondialisation touche à la totalité des domaines du réel. Du coup, certains font une histoire de la mondialisation "heureuse", où le libéralisme économique provoquerait le libéralisme politique, et simultanément réduirait la distance entre les cultures et les peuples, avec pour effet final la convergence des niveaux de vie entre Nord et Sud, un nivellement qui se ferait vers le modèle des pays occidentaux et développés. Ce serait donc un nouvel Age d'or, celui de la fin de l'histoire, celui de la victoire finale du capitalisme et du libéralisme dans son ensemble. Mais admettre cette vision serait oublier que le monde est à chaque époque le résultat d'un rapport de forces. Non seulement la mondialisation résulte elle-même d'un rapport de forces, mais elle en impose un autre: elle est un système international comme il y en a déjà eu auparavant. Dans le domaine de l'agir économique, nous avons vu en effet au cours de ces 20 dernières années le renversement des rapports de force entre capital et salariat, puis entre Etats et secteur privé, avec la constitution des multinationales, et enfin entre Nations et groupes de Nations. C'est cet aspect de la mondialisation comme rapport entre Nations que je développerai ci-après. Un premier rapport de forces est celui qui oppose des Nations ayant adopté différentes formes de capitalisme. Avant la fin de la Guerre froide, il existait dans le monde occidental, Japon compris, une certaine uniformité politique, mais pas d'uniformité des niveaux de vie. Alors que le modèle capitaliste s'est universalisé, il a pris différentes formes, comme l'a montré l'école de la régulation. Les deux plus saillantes étaient d'un côté le laissez-faire social et le libéralisme économique des anglo-saxons, et de l'autre, les systèmes rhénan et nippon, où l'Etat intervient davantage dans la vie économique et dans les rapports sociaux. Donc il existait des capitalismes, mais force est de constater qu'aujourd'hui il se produit une uniformisation des capitalismes vers le modèle anglo-saxon. C'est ainsi que depuis 10 ans, le système nippon de régulation sociale est sous la pression des idéologues anglo-saxons et des marchés. Et de manière similaire, depuis 15 ans, l'Etat-providence européen subit un procès de la part de ses contempteurs anglo-saxons. A la fin de la Guerre froide se sont libérées les tensions latentes qui existaient entre ces manières de penser différentes. Aujourd'hui, le Japon doit donc se plier aux exigences de ce capitalisme nouveau, international. Après 5 décennies de régulation sociale et d'Etat-providence, on entre dans une période de déchéance sociale, et il se crée au sein des entreprises non pas l'harmonie sociale qu'imposaient les traditions patriarcales, mais une compétition qui n'existait pas à l'origine dans la société. Il en est de même en Europe. On s'en convaincra en pensant aux débats quotidiens qui entourent les réformes des Etats actuellement à l'ordre du jour, par exemple en Allemagne celles que propose Schröder. Un deuxième rapport de forces oppose les pays développés aux pays en voie de développement (PVD). La mondialisation était présentée comme un moyen de faire converger avec un faible coût les niveaux de vie de ces derniers vers ceux des pays développés. Cela a en effet été pratiqué dans certains pays d'Asie du Sud-Est, à travers l'ouverture du marché des capitaux. Mais il ne faut pas oublier que cela se passait dans le contexte de la Guerre froide, lorsque les Etats-unis soutenaient ces pays pour leur ôter toute tentation de passer au bloc communiste. Aujourd'hui, les pays en voie de développement (non compris les Nouveaux pays industrialisés comme Taiwan ou Singapour), se sont complètement engagés dans la division internationale du travail, où ils sont producteur de biens à faible valeur ajoutée, des biens en général conçus en Occident. La répartition du travail fait que leur progression économique reste liée à des facteurs de compétitivité assez faibles: l'extraction de matières premières et le travail peu qualifié. Ainsi la Thaïlande est-elle productrice de produits à basse technologie, et tout au plus assembleuse de produits technologiques. Sous les contraintes d'érain du système financier, imposées par la Grande-Bretagne, les Etats-unis ou l'Europe dans les années 1980 et 1990, une impulsion a été donnée aux libéralisations. Pendant cette période, le rendement des investissements dans les PVD montait jusqu'au chiffre exceptionnel de 15%, avec jusqu'à 300 milliards de dollars investis dans toute l'Asie du Sud-Est entre 1985 et 1995. Toutefois la moitié était investie en portefeuilles de placements, des placements en général à court terme, et non en structures destinées à rester. Les pays où était investi cet argent, dépendants de ces flux, en fait débiteurs de ces flux, ont donc subi de plein fouet la crise russe de 1994-1995, ainsi que la crise de 1997-1998 en Asie du Sud-Est: les capitaux ont brusquement disparu. C'est ainsi qu'en quelques mois, parfois quelques semaines, 15 ans d'efforts économiques ont volé en éclat. La crise économique a profondément endommagé le tissu social: en Corée, le chômage n'était que de 2% avant la crise, mais de 9% après, et encore ce chiffre ne compte-t-il pas tous ceux qui sont encore aujourd'hui sous-employés. En Indonésie, le chômage est passé avec la crise de 11% à 18%, tandis que la population vivant sous le seuil de pauvreté, qui est rappelons-le de 1 dollar par jour, représente non plus comme avant 15% mais 50% de la population du pays. Quel ordre mondial ces deux rapports de force produisent-ils? Dans tout contexte géopolitique, on peut distinguer trois niveaux de puissance. Au premier niveau se trouve le centre, qui jouit de toute sa souveraineté, que ce soit dans les domaines politique, juridique, ou économique. Il s'agit aujourd'hui des Etats-unis. Ensuite se trouvent des sous-centres, dont la souveraineté est moins importante. Nous pouvons mettre à cette place l'Europe. En troisième lieu enfin, les périphéries, qui n'ont que très peu de souveraineté et subissent la volonté des centres : ce sont aujourd'hui tous les pays en voie de développement. Du point de vue des relations internationales, les PVD ne sont que des quasi-Etats, pas ou peu souverains. C'est cet état de fait que signifie en réalité la mondialisation, lorsqu'elle est regardée sous l'angle des relations politiques entre les Etats. A ce bref coup d'¦il, la conclusion qui convient sera donnée par Thomas Friedmann, qui écrit dans le New York Times et n'est certes pas un contempteur de la mondialisation: la mondialisation serait en fait une "hégémonie bénigne mondialisée". Que faut-il retenir de Seattle, et comment le mouvement associatif peut-il se mobiliser pour permettre une mondialisation plus juste et plus équitable ? Ce qui devait se tenir à Seattle était une conférence où serait décidé l'agenda des prochaines tâches de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dans son travail de régulation du commerce mondial. Il faut savoir que l'OMC < celui qui a été en voie de se développer à Seattle < est la continuation et le développement du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Le GATT, système d'accords mis en place par la conférence de Bretton Woods en 1948, a permis au cours de ses presque 50 ans d'existence de très fortes réductions douanières. Ce n'est qu'en 1995 que le GATT devient une structure institutionnelle autonome, sous le nom donc d'OMC. Ce qui est propre à l'OMC, c'est que par ses décisions il ne statue plus seulement sur des questions de douane ou de quotas, mais sur des pans de plus en plus larges de la vie humaine: travail, alimentation, environnement. La mondialisation, dans le système mis progressivement en place par l'OMC, met en concurrence non plus des produits, mais des systèmes de production tout entiers. Cela veut dire que la concurrence économique se fait non plus seulement sur les prix ou les droits de douane, mais aussi sur des critères de contraintes dues à la protection sociale ou à la tutelle des intérêts culturels: ce sont finalement des politiques publiques que l'on met en concurrence. De plus, les entreprises qui s'installent à l'étranger apportent souvent avec elles leur propre système de production au lieu de s'adapter à la culture du pays, et en ce sens la mondialisation est un élément destructeur. Mais le GATT et l'OMC n'ont pas le monopole de la régulation mondiale. Parallèlement, l'ONU a abordé au cours des années 1990 une série de "défis communs" mondiaux, c'est-à-dire des questions qui ne pouvaient être abordées efficacement qu'à l'échelle planétaire: l'effet de serre, l'environnement, la pauvreté, la sécurité alimentaire, la démographie. Il fallait à ces problèmes des réponses globales, qui seraient données par ce système que l'on appelle du terme de "gouvernance internationale". Mais à la différence d'autres organismes internationaux, l'OMC possède un système juridique propre, le célèbre Organe de Règlement des Différents (ORD), qui établit des jurisprudences dans les secteurs les plus variés. Cette régulation commerciale est en mesure d'influencer les autres régulations (sanitaire par exemple), et non le contraire. C'est dans ce contexte que prend place la conférence de Seattle: on découvre que le commerce a une influence non plus seulement sur les tarifs douaniers, mais sur les politiques publiques, tandis que des problèmes mondiaux ont été unanimement reconnus. Alors que les précédentes négociations avaient été tenues en privé, la conférence de Seattle a été un événement public. De nombreux mouvements ont exprimé les craintes et le désaccord d'une large majorité des sociétés du monde. Comment se situent ces mouvements sociaux par rapport à l'OMC ? Il existe un courant d'opposition qui refuse tout simplement l'existence de l'OMC et de tout système similaire de régulation mondiale du commerce. Il existe aussi des courants qui veulent réformer l'OMC, tout en lui gardant une forme intergouvernementale. Il s'agirait alors d'équilibrer l'architecture des instances internationales, pour que le commerce ne soit plus prééminent par rapport, par exemple, à la santé ou à l'environnement. Le désir de ces mouvements est que l'OMC écoute ces revendications exprimées à travers la scène politique internationale. Et effectivement, étant donné la présence très marquée des mouvements sociaux, il arrivait souvent qu'à Seattle les délégués parlent, dans un même phrase, de comment l'OMC pouvait favoriser "le droit aux investissements et le développement durable". Mais les représentants des Etats devant négocier à Seattle n'étaient pas investis d'une grande souveraineté populaire, ce qui a accru la critique de non-démocratie de la part des protestataires. Ils ont été confortés dans cette opinion quand l'Union européenne a mis sur la table des négociations des thèmes qui initialement n'avaient pas été prévus, comme les biotechnologies. L'Europe a aussi nié la multifonctionnalité de l'agriculture, et elle a oublié le principe de précaution. Après Seattle, les problèmes posés par la mondialisation sont apparus plus clairement, même si aucun n'a trouvé de solution satisfaisante. Face à toutes ces tentatives plus ou moins heureuses de régulation, les conventions des Nations unies sont restées prudentes. Pourtant, la place des pays en développement dans ce processus de construction est aussi à redéfinir complètement. Car pour ces pays, c'est l'ensemble du multilatéralisme qui n'est pas crédible. Ce n'est pas faute d'avoir répété qu'autant que la règle ou la norme internationale, c'est son processus de construction qui importe. Celui-ci doit évidemment associer l'ensemble des pays et respecter autant que possible les priorités de chacun. Il doit aussi intégrer les modalités de mise en ¦uvre ultérieure et notamment la prise en charge de son coût. La défiance des pays en développement vis-à-vis du multilatéralisme tient pour beaucoup aux promesses non tenues, notamment en terme d'engagements financiers, de la part des pays développés. Le suivi des grandes conférences des Nations unies est de ce point de vue accablant. Peut-on défendre l'interdiction du travail des enfants si dans le même temps on ne prend pas en charge, au moins temporairement, le manque à gagner pour les familles d'envoyer les enfants à l'école plutôt qu'à l'usine? Peut-on imposer des normes environnementales sans favoriser des transferts peu coûteux de technologies et de savoir-faire ? En dehors de ces conventions, il existe diverses tentatives de régulation internationale soutenues par des ONG, par exemple autour de la Taxe Tobin. Le problème agricole reste toujours irrésolu, mais toujours aussi urgent à résoudre. Or non seulement les Etats ne sont pas d'accord entre eux, mais en Europe les organisations s'attachent à leurs positions. En effet, entre la Confédération paysanne et les organisations professionnelles, il a existé pendant Seattle un consensus paysan de fait autour de la PAC, qui empêche sa réforme, alors que ce système devrait être réformé en profondeur. Les droits de propriété intellectuelle sont un autre grand chantier, car la question du brevet du vivant n'est toujours pas éludée. Et il faut réfléchir à quel type de protection intérieure mettre en oeuvre. Enfin, les ONG ou les organisations d'étudiants ne sont pas légitimes pour négocier sur ces questions, et il faut encore définir dans quel cadre institutionnel un débat respectueux de toutes les parties peut se mettre en place. Souvent, on présente la marchandisation de l'enseignement comme une conséquence du développement des technologies de la communication. Mais il existe d'autres causes à cette privatisation, dont on parle moins: - la pression des employeurs 1. La pression des employeurs Jusqu'aux années 1980, il se développe un besoin de plus en plus massif de formation, un besoin d'ordre quantitatif donc. Mais depuis la crise, et surtout après 1989, les besoins de formation portent davantage sur le contenu des enseignements, sur leur aspect qualitatif donc. C'est du moins ce qui a été mis en évidence par la Table ronde européenne des Industriels, lorsqu'en 1989 elle a créé pour la première fois un groupe de travail sur les "politiques de l'éducation". Le but de ce groupe de travail était de réfléchir aux moyens d'accroître la collaboration entre le monde de l'économie et l'école, notamment en privilégiant la formation en alternance, et que le système éducatif lui-même soit plus flexible et davantage décentralisé. En effet, influencer le contenu des enseignements permettrait d'adapter le contenu des enseignements et la formation de la main d'¦uvre aux besoins des employeurs. 2. Le marché de l'enseignement Le marché de l'enseignement représenterait 1000 milliards de dollars
par an, concernerait 50 millions de travailleurs (les enseignants), et un
milliard de clients potentiels (les élèves). Ce marché se répartit en
quatre grands domaines: L'enseignement est donc déjà entré dans le champ d'application de l'OMC. Et que l'on se rappelle les déclarations d'industriels américains à propos de ces marchés de l'enseignement: aucun obstacle n'était selon eux plus irritant que cette idéologie française centrée sur le service public. Pour comprendre toute la portée de cette phrase, il faut avoir conscience que les Etats-unis sont les premiers exportateurs mondiaux d'enseignements, tandis que les Français sont les seconds et qu'ils sont en monopole sur le marché francophone. 3. L'intérêt des Etats à réduire leurs dépenses Au cours des Trente Glorieuses, les dépenses d'éducation sont passées en France de 2,5% à 6% du PIB. Mais depuis les années 1980, cette proportion reste stagnante. Depuis, le nombre d'étudiants a pourtant augmenté de manière presque exponentielle, tandis que le budget qui était affecté à leur enseignement ne croissait que légèrement. La conséquence de ceci, c'est que les moyens disponibles pour chaque étudiant sont toujours plus réduits, et que les conditions d'étude ne s'améliorent pas. Les parents qui peuvent placent leurs enfants dans le secteur privé, et l'enseignement public voit s'éroder ses qualités démocratiques et égalitaires. L'enseignement n'a jamais été libre de la spéculation économique, mais à présent il est déjà soumis aux courants d'échanges de la mondialisation, par le biais de mesures destinées à lui faire perdre les protections dont il bénéficiait par ses vertus de service public. C'est contre cette mondialisation, que la conférence de Seattle tentait d'imposer, que nous nous défendons.
|
Universités. Documents
Les Campus |
| GROUPES LOCAUX |