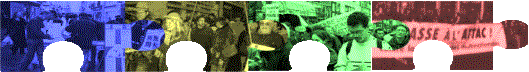 GROUPES
LOCAUX
GROUPES
LOCAUX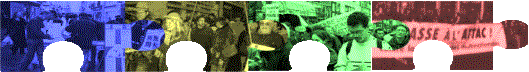 GROUPES
LOCAUX GROUPES
LOCAUX |
Déréglementation du contrôle aérien en Europe Supplément au bulletin n°5 : compte-rendu de la réunion du 20 mars 2000 Présentation par Jean-Paul Armangau et Sylvain Rech du syndicat USAC-CGT (Les intervenants sont contrôleurs aériens depuis dix ans au centre de contrôle aérien d'Athis-Mons. Ils sont responsables nationaux de l'Union syndicale de l'aviation civile-CGT, (deuxième syndicat de la navigation aérienne). Jean-Paul Armangau est membre du comité % Attac 14e à Paris.) Bruxelles lance son OPA sur le ciel européen ... titrait début mars l'hebdomadaire Air cosmos/Aviation magazine international. "La commission Prodi érige le contrôle aérien en priorité politique". En tentant "de réformer à Quinze l'organisation de l'espace aérien européen, elle prend un gros risque politique", poursuit le journaliste. Pourquoi la Commission s'attaque-t-elle au contrôle aérien ? Quels sont les avantages et les risques liés à cette "OPA" ? Où sont les pièges ? Et pourquoi tant de détermination de la part de la Commissaire européenne aux Transports, Mme Loyola de Palacio (par ailleurs vice-présidente de la Commission) qui tente de marquer son passage à Bruxelles par la création du "ciel unique européen" comme d'autres l'ont fait avec le marché unique ou la monnaie unique ? Nous espérons vous donner suffisamment d'éléments d'interrogations dans l'exposé qui suivra; mais avant tout, nous allons commencer par expliquer, en quelques mots, en quoi consiste le contrôle aérien. I- Le contrôle aérien, qu'est-ce que c'est ? Le désir de pouvoir faire voler les avions par tous les temps, la vitesse toujours plus élevée des appareils ainsi que la densité toujours croissante du trafic aérien, ont amené les pouvoirs publics à développer un système de surveillance du ciel. Par l'intermédiaire de la radio, un aiguilleur du ciel (encore appelé contrôleur aérien) ayant connaissance de tous les avions présents dans un volume d'espace donné, pourra renseigner les pilotes sur les risques d'abordage avec d'autres appareils et leur donner des instructions pour éviter ces abordages. Le contrôleur peut par ailleurs donner au pilote des informations nécessaires à la bonne conduite du vol(changements dans la météo, disponibilité des équipements et des infrastructures.) et assurer, en cas d'incident ou d'accident, un service d'alerte, de recherche ou de sauvetage. Pour l'aider dans sa tâche, deux autres outils sont indispensables. Le téléphone , grâce à des lignes spécialisées, permet de communiquer rapidement avec les autres contrôleurs en charge des volumes de contrôle adjacents desquels (ou vers lesquels) viennent (ou vont) les avions dont il a la charge. Le radar enfin, rendu "intelligent" depuis bientôt 30 ans en France, permet (pour l'essentiel) de visualiser la position de l'avion,son altitude, ainsi que sa position future. Chaque contrôleur aérien est donc en charge d'un volume d'espace, qu'on appelle secteur de contrôle, dans le-quel peuvent évoluer jusqu'à 20 avions simultanément. Afin de réduire le nombre de croisements possibles, les pilotes doivent conduire leurs machines le long de "voies aériennes" bien déterminées. Pour les aider, des balises de radio navigation ou des systèmes de navigation par satellite guident les ordinateurs de bord au fil du trajet. Le travail du contrôleur consiste à surveiller l'espace dont il a la charge, à s'assurer que la communication avec le pilote est correcte et à détecter si un avion risque, au cours de sa route, de sa montée ou de sa descente, de se trouver aux abords d'un autre avion. Si tel est le cas, le contrôleur ordonne aux pilotes des manouvres leur permettant d'éviter la collision, avant de les repositionner sur les routes pré-établies. Aujourd'hui, avec plus de 8000 vols par jour en France (voir encadré n°1), à une vitesse moyenne de 900 km/h, le nombre potentiel de collisions et la rapidité avec laquelle elles peuvent arriver sont considérables. Dans la partie d'Europe comprise entre le sud de l'Angleterre et le nord de l'Italie se trouvent les plus gros aéroports du continent. Dans cette zone, le trafic que traite les contrôleurs est non seulement très dense, mais aussi très complexe du fait des nombreuses accélérations, montées, paliers, descentes et décélérations sur de courtes distances. Ce trafic vient s'imbriquer parmi les survols déjà nombreux. Si l'on ajoute à cela des performances très différentes d'un appareil à l'autre et l'impossibilité de "faire garer un avion sur le bas côté" pour "arranger" un croisement, on a une petite idée de l'utile présence de l'oil du contrôleur aérien. Pour gérer tout cela, les contrôleurs aériens sont répartis dans les tours de contrôle qui s'occupent du trafic aux abords immédiats des aéroports. (Pour une grosse plate-forme comme Roissy, par exemple, imaginez un camembert de 30 kilomètres de diamètre et de 3000 mètres de hauteur.) Ailleurs dans l'espace, et jusqu'au "camembert" de l'aéroport d'arrivée, c'est un Centre de contrôle qui prendra l'avion en charge. Il y en a cinq en France, et c'est là qu'on y trouve la majeure partie des personnels de l'aviation civile. Un exemple : l'aéroport de Roissy, pourtant deuxième d'Europe, emploie environ 350 personnels de la navigation aérienne alors que le Centre de contrôle d'Athis-Mons en emploie 700. Ce Centre veille à une portion d'espace qui va de la Manche à la frontière suisse et de la Normandie à la Champagne. Encadré n°1 : 50 ans d'évolutions Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, le trafic aérien n'a cessé de se développer dans les pays occidentaux. Les méthodes de contrôle et les matériels ont considérablement évolués et le contrôle aérien français qui traitait quelques dizaines de vols par jour en 1949, en contrôle aujourd'hui plus de 8000. Pour mémoire, la journée la plus chargée de 1994 (un vendredi du mois de septembre) a vu passer 5400 vols dans le ciel français. ce qui correspond à la journée la moins chargée de 1999. Les missions des contrôleurs ont aussi évolué dans le temps. Si jusqu'au début des années 60 il s'agissait principalement de veiller à la sécurité des vols, les années 70 ont vu apparaître la notion de régularité (décoller et atterrir aux heures prévues), la décennie suivante celle d'économie (grâce à la flambée des prix du baril de pétrole), et depuis peu, la notion d'écologie mobilise tous les services de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Parlons gros sous Rendre le service de contrôle aérien suppose des matériels ultra-performants, fiables, des technologies de pointe et, le trafic augmentant sans cesse, de perpétuelles adaptations. Cela a un coût. Le personnel et le maintien de son haut niveau de qualification a lui aussi un coût. Aux côtés des contrôleurs, il faut aussi penser aux électroniciens de la sécurité aérienne, aux techniciens spécialisés, aux ingénieurs qui établissent les règles et les procédures et aux personnels administratifs qui doivent être formés aux spécificités de ce domaine d'activité (jargon aéronautique, réactivité importante, domaine international.). Et tout cela, il faut bien le payer aussi. Il a donc été décidé, depuis 40 ans, à un niveau européen élargi à d'autres pays que ceux de l'Union (1), de faire payer les compagnies pour le service rendu (voir encadré n°2). Un organisme,Eurocontrol, a mis en place un système de redevances au prorata de la masse de l'avion et du nombre de kilomètres parcourus. Le contrôle aérien facture la prestation aux compagnies, qui payent un interlocuteur unique (Eurocontrol), qui reverse ensuite à chaque pays la part lui revenant (2). Ces redevances servent donc à payer les personnels, le matériel, la recherche. bref, tout ce qui concourt à faire que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Encadré n°2 : Ce ne sont pas vos impôts qui payent les contrôleurs La quasi totalité des services fournis par la DGAC sont payés par les passagers au travers du billet d'avion. L'Etat ne subventionne le budget de l'aviation civile qu'à hauteur de 2,4%, soit 215 MF par an, pour des activités de police ou de douane que les compagnies estiment ne pas avoir à payer. Cette subvention est en constante diminution depuis 20 ans. Parallèlement à cela, le taux de redevance imputé aux compagnies est lui aussi en constante baisse. L'augmentation du trafic s'accompagnant d'une amélioration des techniques, la "productivité" des contrôleurs français s'est accrue de 70% en 20 ans (nombre de vols contrôlés par nombre de contrôleurs) ; c'est ce qui permet à la France d'être le moins cher des pays industrialisés tout en ayant un équipement à la pointe de la technologie mondiale. Un seul exemple : dès le début des années 80, tous les centres de contrôle français étaient équipés d'un système de coordination automatique entre secteurs de contrôles, ou de systèmes d'attribution automatique des codes radars. Le centre de contrôle de Francfort vient (depuis février 2000) de s'équiper de ces systèmes et rien de semblable n'est encore opérationnel au Royaume-Uni ! II- En quoi cette activité est-elle considérée par certains comme une marchandise ? Depuis vingt ans, le domaine aérien, dans son ensemble, est la cible des financiers internationaux. Tout d'abord, le transport aérien. Au début des années 80, le président Reagan s'illustra dans son pays en déréglementant le transport aérien. Auparavant, pour exploiter une ligne aérienne, une compagnie devait s'engager à respecter un cahier des charges définissant un service public (horaires, fréquences) pendant une période minimum. L'administration américaine veillait à ce qu'il n'y ait pas plus de deux compagnies sur la même ligne afin de garantir un service fiable et continu. Suite à la déréglementation, n'importe quelle compagnie a eu le droit d'exploiter n'importe quelle ligne. On a vu alors des centaines de compagnies-champignons remettre en service des coucous parqués depuis vingt ans dans des déserts avec des moteurs suintant l'huile et le kérosène, des commandants de bord organiser l'enregistrement avant de charger les bagages en soute, puis de prendre les commandes. et plusieurs de ces avions finir "au tapis" avant que ces compagnies ne fassent faillite. Bilan : quinze ans plus tard, le nombre de compagnies était redescendu à sept ou huit, les billets d'avion dont le prix avait chuté jusqu'à 50% de leur valeur étaient revenus au niveau de 1980. Des centaines d'emplois ont été perdus et le marché de la côte ouest est aujourd'hui dominé par les compagnies japonaises qui payent moins cher leurs personnels. En Europe, la Commission Delors s'inspira de cette réussite libérale pour reproduire le modèle américain sur le vieux continent, mais de manière plus graduelle. Ce que Ronald Reagan a fait en un an, Bruxelles l'a échelonné sur dix ans. Depuis le premier avril 1997, la déréglementation est totale en Europe. C'est à dire qu'une compagnie étrangère, par exemple, peut exploiter la ligne Paris-Rodez sans autre contrainte que d'obtenir une autorisation de décollage. Cela à conduit à la multiplication des vols (jusqu'à 130 allers-retours par jour en février entre Paris et Londres malgré la concurrence de l'Eurostar) ; à la diminution de la taille des appareils (plus aucune compagnie ne fait voler un Airbus A330 de 412 places sur le Paris-Toulouse, chacune préférant des avions de 100 à 150 places) ; à une offre toujours plus extravagante pour séduire le passager (les navettes d'Air France proposent un départ toutes les demi-heures, mais comme il y a trop d'avions en l'air, ces vols ont souvent une heure de retard au décollage) ; et par voie de conséquence, à augmenter le trafic et les risques de collision sans transporter beaucoup plus de passagers (3). Et au finish, c'est aux organismes en charge de l'aviation civile d'encaisser les à-coups générés par le délire libéral de quelques-uns. Et maintenant, le contrôle aérien Après que leurs prédécesseurs aient semé la pagaille dans le ciel européen, les nouveaux membres de la Commission européenne ont décidé de donner une impulsion supplémentaire à la libéralisation.Ils se sont laissé largement inspirer par la "propagande active" menée par les compagnies elles-mêmes. Non contentes de faire quasiment ce qu'elles veulent dans les airs depuis trois ans, les compagnies aériennes, regroupées au sein de deux grosses associations (4) mènent depuis un an une campagne de dénigrement des services de contrôle européens en essayant de leur faire porter tous les maux, au risque d'avancer des arguments contradictoires. Voici, en vrac, ce qui est reproché aux contrôleurs européens et aux services (déjà privatisés ou non) qui les supervisent : "les retards sont insupportables" (coûts et image de marque) ; "nous payons trop cher les redevances" ; "les différents systèmes ne sont pas harmonisés" ; "il y a trop de centres de contrôle en Europe" ; "il n'y a pas assez de contrôleurs en Europe" ;"il ne faut plus s'occuper de la sécurité, son niveau actuel est satisfaisant". III- Le but de la déréglementation ? Acheter l'activité de contrôle comme on achète une écurie de Formule 1 ou une équipe de foot. Regroupées au sein d'alliances mondiales aux côtés d'industriels, les compagnies veulent pouvoir maîtriser l'activité de contrôle aérien. Elles visent ainsi à récupérer une activité aujourd'hui non marchande confiée aux États. Elles poursuivent ainsi plusieurs objectifs. Le premier est celui de la maîtrise des coûts : amélioration de la productivité, limitation des investissements et de la recherche, possibilité de se servir en priorité (par exemple, priorité à l'atterrissage à l'avion dont la compagnie est actionnaire du service de contrôle). Le second est de mettre en vente les autorisations de décollage dont personne ne fait commerce aujourd'hui. En effet, plus les compagnies multiplient la demande dans un espace et untemps limités, plus une autorisation de décollage peut acquérir de valeur marchande. Alors que tout le monde veut décoller de Roissy à huit heures du matin pour des raisons commerciales, seuls trois avions au maximum pourront y être autorisés. Les autres devront attendre leur tour. Si les compagnies aériennes et les holdings desquelles elles font partie,maîtrisent les aéroports (5) et le contrôle aérien "en-route" (6), elles pourront faire commerce de cette ressource rarissime que représente la bonne heure de décollage sur le bon aéroport. Comment ces multinationales pourraient bien arriver à leurs fins ? Elles envoient en émissaire des représentants de compagnies aériennes faire un travail de lobbying auprès de la Commission de Bruxelles. Celle-ci reçoit avec complaisance les arguments techniques qui lui sont présentés. Le fonctionnement de la Commission étant tout sauf démocratique, il est impossible aux autres acteurs de se faire entendre. Jamais, sur un sujet étudié par la Commission, les représentants des personnels ou des usagers ne sont conviés à une quelconque concertation. Seuls les industriels ont leur place dans les groupes de travail mis en place par la Commission. Ce n'est que sous la pression des personnels français que les aspects "facteurs humains" et écologie seront finalement examinés en groupe de travail à Bruxelles. Dans ce contexte, les vues libérales des commissaires peuvent facilement être traduites en actes. Première étape : séparer le régulateur de l'opérateur On entend par régulateur, l'autorité qui a en charge l'aspect réglementaire du contrôle et du transport aérien : celui qui établi les règlements, les procédures, qui les fait appliquer ou sanctionne s'ils ne sont pas observés. A la DGAC (Direction générale de l'aviation civile), c'est la partie "administrative" de la maison, celle qui s'occupe du contrôle technique des aéronefs, du règlement de la circulation aérienne, des études techniques et de la recherche, mais aussi les directions régionales. L'opérateur, ou prestataire de servi-ce, utilise ces règlements pour rendre le service dont il a la charge ; dans ce qui nous intéresse : le contrôle aérien. Actuellement, les redevances payées par les compagnies pour bénéficier du service du contrôle financent aussi le régulateur. En séparant nettement les deux fonctions, le but avoué des compagnies est de savoir où va leur argent. En apparence, rien de plus louable. Satisfaire les compagnies La DGAC a donc mis en place, depuis plusieurs années, une comptabilité analytique qui permet aux compagnies de connaître l'affectation de chaque franc versé au BAAC (le Budget annexe de l'aviation civile). Il n'a pas été nécessaire pour cela de séparer quoi que ce soit, si ce n'est d'affecter des lignes comptables sur un poste ou sur un autre. Cela n'a pas suffit. Les compagnies ont ensuite argué qu'elles payaient certaines redevances alors que les services rendus sont du ressort de l'Etat (la sécurité incendie par exemple - demain, avec la même logique, il pourrait en être de même pour la maintenance des systèmes). Bien que cela puisse paraître paradoxal (on n'assure pas la sécurité incendie pour faire bien mais parce qu'il y a des risques à l'atterrissage et au décollage), le Conseil d'Etat leur a donné raison et la DGAC a remboursé les sommes "indûment" perçues. Puis le Parlement a créé d'autres taxes pour compenser. Toujours pour montrer que la navigation aérienne est vraiment compétitive, la DGAC a ensuite baissé les redevances. Et depuis deux ans, tous les budgets "maison" sont en diminution de 5%: il a donc fallu bagarrer très dur pour obtenir quelques postes de contrôleurs supplémentaires et les services peu-vent attendre six mois pour avoir une cartouche d'encre pour imprimante. Deuxième étape : quel sera le premier Centre de contrôle délocalisé à Manille ? Mais cela n'a toujours pas suffit. Les compagnies et les alliances mondiales auxquelles elles appartiennent aux côtés d'autres industriels essayent main-tenant, par tous les moyens (voir encadré n°3), de contrôler cette activité de prestataire de service. La partie "régulateur" ne les intéresse guère car elle est lourde à gérer et ne génère que peu de profits. Par contre qui n'achèterait pas,même cher, un bon créneau de décollage sur un bon aéroport ? Une fois séparées ces deux activités (c'est ce qui a été fait sous Miss Maggie en Grande-Bretagne), il ne reste plus qu'à vendre, sur les places boursières, la partie rentable : c'est la privatisation. Au Royaume-Uni, Tony Blair, malgré l'émotion suscitée par l'accident de Paddington, s'apprête à vendre, d'ici la fin de l'année, tout le contrôle aérien britannique. Encadré n°3 : Pour la Commission, la fin justifie les moyens Depuis dix mois, elle explique sans jamais pouvoir le démontrer, que la séparation opérateur-régulateur, puis la privatisation est la seule réponse possible à la résorption des retards aériens. La France, grâce à des réponses techniques vient de démontrer que l'on pouvait diminuer les délais sans changer de structure. La Commission enfourche donc un nouveau cheval de bataille, celui de la sécurité. Manque de pot, là encore, la France est le pays ayant le plus investi dans ce domaine : mise en place de subdivisions "Qualité de service" et du retour d'expérience, développement d'un système anti-collision,équipement de tous les aérodromes d'images radar. Aucun de nos voisin ne peut afficher autant en ce domaine. Une fois encore, la Commission et les gens bien intentionnés qui la pilotent font plus preuve d'intérêt pour le gâteau que représente le plus gros volume de trafic européen que pour résoudre les problèmes réels du contrôle aérien. No Erika, No Paddington in Air Trafic Control ! L'étape suivante, voulue par les compagnies aériennes qui inspirent la Commission, est la mise en concurrence des systèmes de contrôle. Une fois encore, l'exemple nous vient du Royaume-Uni où le rail a été ainsi morcelé et où plusieurs sociétés sont en concurrence pour obtenir des concessions d'exploitation d'un réseau. Après avoir répondu à un appel d'offres, la compagnie concessionnaire essaye, pour le temps que va durer son exploitation (de 5 à 15 ans selon le secteur), de satisfaire en premier lieu son actionnariat. On connaît les enchaînements : réduction d'effectif, externalisations, baisse des investissements. et crash à Paddington. La riposte s'organise Les contrôleurs aériens européens, en charge de la sécurité, sont unanimement opposés à la privatisation. Bien conscients de leurs responsabilités, ils refusent d'accréditer un système qui mènerait inéluctablement à la catastrophe aérienne. En France, les syndicats vont plus loin. La majeure partie d'entre eux (CGT, CFDT, FO, CFTC et quelques autonomes) refusent que dans un secteur en pleine croissance, l'on aggrave encore les inégalités au profit d'une élite d'industriels et de banquiers. Une inter-syndicale demande que les retombées de cette croissance soient utilisées pour poursuivre les investissements et la recherche, embaucher des jeunes, former les personnels,réduire la durée du temps de travail et améliorer les systèmes de retraites. Ces syndicats, représentatifs d'environ 90% des personnels,n'entendent pas cautionner une tentative de satisfaire une minorité d'initiés spéculant en bourse comme on jouait autrefois au tiercé et qui seraient prêt à délocaliser un centre de contrôle pas assez productif à Bucarest ou à Manille. Pour ce faire, plusieurs actions ont été engagées ces derniers mois. Travail d'explication auprès des parlementaires français et européens, des journalistes, mais aussi de la Commission européenne. Une manifestation a amené 300 personnels devant le siège d'Eurocontrol à Bruxelles, le jour de la conférence des 38 ministres de la grande Europe de l'aviation. Des con-tacts ont été noués avec d'autres syndicalistes européens. Mais dans une Europe dominée par le mode de pensé anglo-saxon, ces représentants pensent souvent que le cours libéral est irréversible et qu'il ne sert à rien de s'y opposer. Il faut dire, qu'en Europe du Nord, les syndicats sont plus souvent des associations professionnelles (7) et n'ont aucune pratique de la concertation telle qu'elle est pratiquée en France. Cependant, nous ne désespérons pas d'amener nos collègues à un mouvement européen avant la fin du semestre. En effet, courant juin, le groupe de travail mis en place par la commissaire aux Transports pour donner de la consistance à son projet de "ciel unique européen", rendra ses conclusions. Ces actions ont eu un premier effet. Plutôt que d'engager chaque État européen à séparer, chez lui, l'opérateur du régulateur, la Commission envisage maintenant d'avancer plus prudemment. Elle voudrait, par l'intermédiaire de son adhésion à Eurocontrol, imposer à cette organisation de prendre sous son aile quelques aspects régaliens aujourd'hui du ressort des États. La séparation ne serait effective que dans plusieurs années, lorsque les États auraient progressivement transféré leurs prérogatives à Eurocontrol. Se rendant compte des réticences des personnels, la Commission réalise ainsi qu'elle aura du mal à imposer son point de vue aux États et préfère prendre son temps pour arriver à ses fins. Mais si, fin juin, les visées de la commissaire aux Transports ne sont pas stoppées, le processus sera bel et bien engagé et, comme cela a été le cas pour les télécommunications ou l'énergie, tous les systèmes de contrôle aérien seront soumis aux lois du marché d'ici dix ans. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous usagers du transport aérien. Que nous soyons passager, ou simple habitant survolé par ces tonnes d'acier ailées planant au dessus de nos têtes, nous sommes tous concernés par ce projet de démantèlement et de mise en concurrence des systèmes de contrôle aérien en Europe. Après la santé, l'énergie, le transport maritime, ferroviaire et routier voici un nouveau domaine où la pensée uni-que va faire des ravages. Il appartient à l'opinion publique de s'emparer du sujet afin de faire entendre le point de vue citoyen de l'usager, volontaire ou non, que nous sommes. L'Union syndicale de l'aviation civile-CGT vous propose une première initiative : soutenir les contrôleurs britanniques dans leur opposition à la privatisation du Nats (National air traffic services).Pour cela, branchez vous sur notre site internet : http://www.usac-cgt.org et signez la pétition adressée au ministre britannique des Transports. Compte-rendu réalisé par Jean-Paul Armangau (Notes) (1) L'organisation Eurocontrol regroupe aujourd'hui 28 pays européens dont les 15 de l'Union. (2) En France, un budget annexe (le BAAC, Budget annexe de l'aviation civile), géré par Bercy mais ne faisant pas partie du budget de l'Etat, finance presque entièrement les dépenses de la DGAC par le produit des redevances que lui reverse Eurocontrol. (3) Sur la dernière décennie (1989-1999), le trafic aérien parisien a cru d'environ 60% pour seulement 40% de passagers embarqués en plus. (4) IATA (International Air Transport Association) et AEA(Air transport European Association) (5) à Rome, c'est Pirelli et Benetton qui sont les mieux placés pour remporter la concession. (6) au Royaume-Uni, Thomson-CSF est le premier sur les rangs pour racheter tout le contrôle aérien britannique. (7) Si le nombre de syndiqués y est supérieur à la France, ce n'est pas pour autant que les syndicats pèsent dans les choix des dirigeants, aucune culture d'opposition constructive n'animant généralement les syndicalistes anglo-saxons. |
| GROUPES LOCAUX |