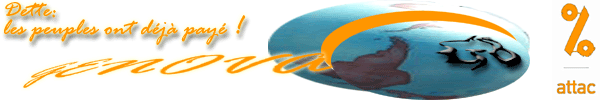

Pour une politique et une économie du bien commun (propositions aux pays du G8)
Par: Rete Lilliput
Pour une politique et une économie du bien commun
Prémisse
Ce document se veut la base du contenu qui caractérisera l’engagement et le travail de Rete Lilliput et de Tavolo Intercampagne durant le chemin menant à sommet du G8 de Gênes, en représentant un large appui de la société civile italienne.
Dans l’optique du prochain sommet de Gênes, nous invitons le gouvernement italien à une réflexion et à une confrontation qui aille au-delà du sommet, auquel nous ne reconnaissons aucune légitimité démocratique vu que les huit pays plus riches au monde ne peuvent s’arroger la prérogative de prendre des décisions globales touchant le sort de la planète entière. Nous estimons que la planète appartient à tous les peuples de la terre et que tous les peuples ont droit à l’expression, au droit de cité et à l’autodétermination. Ainsi, nous ne pouvons accepter que la “loi des plus forts” puisse devenir une loi pour tous. Nous ne pouvons pas accepter que les choix finalisés à l’élimination de la pauvreté soient produits “en exclusivité” par ceux qui ont provoqué de la pauvreté. Nous ne pouvons accepter qu’une nouvelle forme de néocolonialisme, appelée mondialisation néo-libérale, maintienne deux tiers de l’humanité en état d’esclavage économique, culturel et idéologique.
Nous demandons ainsi que le gouvernement s’engage depuis maintenant à préparer la rencontre des Nations Unies à propos de Finance et Développement (Finance for Development), événement important pour la redéfinition des engagements de la communauté internationale en faveur du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, où l’Italie jouera un rôle de premier plan.
Comme le rappelle à juste titre le PNUD (1999), il est nécessaire d’intervenir à propos de ces phénomènes en prêtant une grande attention à six composantes fondamentales : éthique, équité, inclusion, sécurité humaine, environnement durable et développement, avec ces caractérisations suivantes:
éthique : diminuer les violations des droits de l’homme, et non pas les augmenter ;
équité : diminuer les disparités à l’intérieur et entre les nations, et non pas les augmenter ;
inclusion: diminuer la mise en marge d’individus et des pays, et non pas l’augmenter ;
sécurité humaine: diminuer l’instabilité des sociétés et la vulnérabilité des individus, et non pas les augmenter ;
environnement durable: diminuer la dégradation de l’environnement, et non pas l’augmenter ;
développement: diminuer la pauvreté et le manque, et non pas les augmenter ;
Analyse du contexte social et environnemental actuel
Les études menées de la part de tous les plus importants centres d’analyse et de recherche nous montrent toujours plus de quelle façon notre système économique et productif est désormais entré en contraste manifeste avec les systèmes naturels qui nous supportent et sans lesquels nous ne pourrions vivre, et de quelle façon la situation économique et sociale a produit une crise des modèles de développement qui désormais ont besoin d’une grande réorientation éthique et morale. Continuer sur le chemin du “business as usual” apparaît absolument insensé et la responsabilité du changement est immense pour les pays à plus forte industrialisation et économie.
A presque dix ans de la Conférence ONU sur l’environnement et développement de Rio de Janeiro (1992), il est indispensable de diminuer l’impact environnemental de nos sociétés avec une engagement sans précédants. L’économiste Herman Daly a écrit que l’amorce d’une économie durable demande moins de ressources à notre environnement, mais contextuellement, demande plus de ressources à notre morale.
Selon les estimations de la Banque Mondiale (Development Indicators 2000), 2,8 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour, 1,2 milliards de personnes avec moins d’1 dollar par jour, 1,1 milliards de personnes sont sous-alimentées, 1,2 milliards n’ont pas accès à l’eau potable. Derrière ces statistiques froides il y a des visages, des histoires, des vies, réduites à survivre. Ce sont les opprimés et les délaissés de la Terre qui souffrent.
Le produit global brut s’est élevé de 6.400 milliards de dollars en 1950 à au-delà de 42.000 de dollars en 1999. Cependant, comme nous le rappelle le PNUD (Human Development Report 1999), la différence de revenu entre le 1/5 des individus qui vivent dans les pays les plus riches et le 1/5 qui vit dans les pays les plus pauvres est passé de 30 à 1 en 1930, à 60 à 1 en 1990 et à 74 à 1 en 1997. 20 % des individus les plus riches du monde détient 86 % du PNB mondial, 82 % des exportations des biens et des services et 93 % des utilisateurs d’Internet. Le patrimoine des trois personnes les plus riches est supérieur au PNB conjoint à tous les pays les moins développés alors que le patrimoine des 200 personnes les plus riches est supérieur au revenu conjoint de 41 % de la population mondiale.
Le dernier rapport biennal “World Resources 2000–2001” établi par la World Resources Institute, la UNEP, le PNUD et la Banque Mondiale (People and Ecosystems: The Fraying Web of Life) contient les conclusions du rapport PAGE (Pilot Analysis of Global Ecosystems) voulu par les quatre institutions et propédeutique au plus détaillé Millennium Assessment of Global Ecosystems.
Le PAGE analyse cinq grands écosystèmes planétaires fondamentaux pour la vie de l’espèce humaine: côtier-maritime, celui des eaux douces, celui des terres agricoles, celui des prairies et forestier. Tous ces milieux présentent des signes irréfutables de déclin, de surexploitation et des difficultés évidentes de reprise.
Les zones côtières sont habitées de deux milliards d’êtres humains: deux tiers de la pêche mondiale dépend, lors des différentes périodes de sa propre existence, de la condition des zones côtières humides, des bancs d’algues et des barrières coralliennes. Il s’agit de zones où la main de l’homme a une responsabilité notable.
La pêche mondiale est en train de décliner sensiblement en au moins un tiers des zones majeures de pêche; l’effondrement de la pêche touche directement un milliard de personnes, surtout au sud-est asiatique.
Les changements climatiques agissent sur l’état de santé des barrières coralliennes qui souffrent du phénomène du blanchissage (Bleaching) dû à l’augmentation de la température de la superficie marine.
La crise des eaux internes constitue un problème particulièrement grave parce que tous les organismes vivant ont besoin d’eau pour leur existence. La consommation de l’eau est augmentée de six fois lors du dernier siècle, accompagnée du redoublement du taux de croissance de la population. Actuellement, 54 % de la disponibilité des eaux douces est utilisées et une augmentation de ce taux pourrait menacer encore plus tous les écosystèmes.
L’eau est surexploitée (dans plusieurs zones cruciales pour la production céréalière, les nappes d’eau sont utilisées au-delà de leur capacité de régénération, des Etats-Unis à la Chine, à l’Inde), polluée et utilisée irrationnellement. Les eaux internes, des zones humides aux fleuves et lacs, subissent des interventions considérables de conversion, de fragmentation, de détournement, voire de cimentage (avec de effets dévastateurs en cas d’inondations).
Les zones agricoles couvrent un tiers des terres émergées, mais, désormais, trois quarts de ces terres sont des sols appauvris et plusieurs zones subissent l’agression du développement urbain, de la dégradation du sol et du manque d’eau.
Les prairies, savanes, maquis et toundra couvrent 40 % des terres émergées, fournissent le milieu de vie pour les grands mammifères, pour plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs, pour les animaux et les plantes utilisées en zootechnie et en agriculture, mais 80 % de ces zones présente un dégradation croissante des sols.
On estime que les forêts constituent le milieu de vie pour deux tiers des espèces vivantes sur Terre, jouent un rôle essentiel dans la régulation des phénomènes climatiques et du cycle hydrique. Les forêts subissent la surexploitation et la destruction directe, la fragmentation et les incendies (au moins 150.000 km³ de forêts sont détruits chaque année).
Le rapport “Living Planet Report 2000”, établi par le WWF, le World Conservation Monitoring Centre de l’UNEP, le Redefining Progress et le Center for Sustainability Studies, affirme que l’état de santé des écosystèmes planétaires d’eaux douces, marines et de forêts est allé déclinant d’environ 33 % en 1970 à nos jours, alors que la pression humaine sur les milieux de la Terre (calculée grâce à l’indicateur Ecological Footprint – Empreinte Ecologique) s’est vue augmenter entre 1960 et 1996 d’environ 50 %. Dans une certaine période, vers la moitié des années 70, cet indicateur (qui est un indicateur par défaut sur l’impact de l’activité humaine sur la biosphère) nous dit que la pression humaine a dépassé la capacité de régénération des écosystèmes.
Ces phénomènes sont en outre aggravés par la croissance démographique qui se traduit dans une consommation d’énergie et de matériaux toujours plus importante, ainsi qu’une augmentation consécutive de déchets qui sont produits selon le style de vie et les modes de consommation des différents pays du monde (les pays riches présentent une situation catastrophique en matière de consommation des ressources). La majeure partie des écologistes estime que, si l’on veut une stabilité de l’intervention humaine sur l’équilibre dynamique de la biosphère, la pression environnementale au niveau mondial devra être réduite d’au moins 50 % dans les prochains 50 /60 ans. Si on considère comme probable que, durant cette période, l’augmentation de la population mondiale atteindrait 9 milliards d’individus (estimation moyenne de l’ONU) et si l’on prévoit un taux de croissance modeste de consommation de biens au niveau mondial de 2/3 % (ce qui signifierait quadrupler la consommation par personne dans les prochains 50 ans), un simple calcul mathématique révèle qu’il serait nécessaire de réduire “l’intensité d’impact” des biens de consommation à 1/16 du niveau actuel. Ceci signifie que, par rapport à aujourd’hui, chaque unité de n’importe quel bien consommé devrait exercer sur l’environnement une pression réduite à 93 %! Tous les pays devraient concrètement considérer le plan d’action de la Conférence ONU sur la Population et le Développement qui s’est tenue au Caire en 1994.
L’inadéquation des politiques de la Banque Mondiale et du F.M.I.
Dans la foulée de la mobilisation massive de la société civile en Italie et à l’étranger en faveur de l’élimination des dettes extérieures des pays en voie de développement, l’Italie a déjà pris des engagements politiques de grand intérêt mais qui risquent d’être vains tandis que les causes structurelles de la pauvreté ne trouvent pas de solution, d’où l’échec des politiques de la B.M. et du F.M.I..
A 56 ans de leur création, la B.M. et le F.M.I. ont en effet fait preuve de leur incapacité de créer les bases pour un système de justice et de stabilité économique auquel peuvent participer tous les peuples du globe. Non seulement leurs politiques ont engendré l’énorme et insoutenable fardeau de la dette extérieure, mais ils ont aussi produit ce que la société civile du Sud du monde appelle “dette écologique et sociale”, une dette contractée de ces institutions internationales et des nations riches envers les pays en voie de développement qui se sont approprié de ressources naturelles à bas coût ou qui ont exploité leurs milieux incontaminés pour se débarrasser de la pollution produite et leurs habitants pour avoir de la main d’oeuvre à un coût extrêmement bas.
Toutefois, les institutions de Bretton Woods (B.M et F.M.I.) sont imperméables concernant tout changement d’orientation. Le document controversé approuvé avec l’ONU “A Better World for All”, à l’occasion du Sommet Social Mondial de Genève “Copenhague + 5”, si d’une partie identifie avec soin les causes de la pauvreté, de l’autre il continue à proposer les recettes de toujours, à savoir celles de l’ajustement structurel.
La nouvelle initiative conjointe de la B.M. – F.M.I. appelée “ Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté ” risque d’être une charge supplémentaire pour les gouvernements des pays pauvres et d’évincer un des principes de base pour de nouvelles politiques de développement, celui de la correspondance aux besoins effectifs des classes marginalisées.
Les politiques de réduction et de l’élimination de la dette sont inadéquates aux nécessités des pays pauvres: la Enhanced HIPC ou “HIPC avancée” continue au ralenti, et B.M. et F.M.I. continuent – malgré tout – à conditionner l’accès aux mécanismes de réduction de la dette à la réalisation de plan d’ajustement structurel.
Aussi, est-il nécessaire de développer une nouvelle approche économique et financière qui fasse prévaloir les besoins et les droits des peuples, par rapport aux impératifs de libéralisation et de mondialisation des marchés.
Une stratégie intégrée de lutte contre la pauvreté et à l’exclusion sociale ne peut faire abstraction d’une série de mesures et d’engagements politiques généraux finalisés à renforcer les mécanismes de gouvernement de l’économie et de la finance globale et à accélérer l’élimination de la dette extérieure des pays pauvres. Entre-temps, des réformes particulières de la part de la B.M. et du F.M.I. doivent être effectuées.
L’objectif de ces réformes sera garantir que de telles institutions fonctionnent de façon efficace, transparente et cohérente. La B.M. et le F.M.I. souffrent de défauts chroniques allant de la faible qualité de projets financés au manque de transparence envers leur propre oeuvre.
Nous demandons au gouvernement italien de s’engager afin que les pays les plus riches imposent une stratégie compréhensive susceptible d’affronter une fois pour toutes le problème de la dette extérieure, en éliminant entièrement l’endettement des pays les plus pauvres envers la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, et en créant les conditions pour un système économique et financier basé sur des critères d’équité, de responsabilité et de durabilité. Les instances politiques devront prévaloir sur celles économiques et du marché. Une des caractéristiques et des conséquences de la mondialisation économique est en effet le déplacement de l’axe des dynamiques politiques et décisionnelles des Etats et des parlements vers des institutions supranationales globales.Une réforme du système éco-financier devrait donc rejeter les bases pour un contrôle démocratique et politique de l’économie de la part de la société civile et des gouvernements.
Les piliers pour appuyer le développement social
Equité, durabilité et responsabilité devraient être les piliers pour toute action finalisée à appuyer le développement social et la lutte contre la pauvreté et la dette extérieure.
Il ne suffit pas de relancer les échanges commerciaux, ou les flux d’investissements sans indiquer les critères et les contraintes que tels choix doivent considérer. Le relancement du Millennium Round et d’un nouvel Accord Multilatéral sur les Investissements pour aider les pays appauvris aura un autre effet si le commerce et les investissements ne sont pas soumis à des impératifs sociaux et environnementaux, et si des institutions, telles que l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) ne sont pas radicalement reformées.
L’équité demande l’introduction de procédures juridiques où la société civile et les gouvernements des pays appauvris peuvent avoir les mêmes droits que ceux des pays riches, et où les politiques de développement sont orientées vers la justice sociale et le respect des droits de l’homme.
La responsabilité nécessite d’institutions responsables, transparentes, et cohérentes avec leurs propres objectifs. Ceci signifie que le secteur privé, qu’il s’agisse de banques ou de sociétés multinationales, devra être régi par des réglementations concernant la décentralisation productive et leur participation à des programmes de réduction de la dette extérieure, de prévention des crises et d’encouragement en faveur d’investissements directs dans les pays pauvres.
La durabilité demande un système économique et financier solide, non basé sur des interventions macro-économiques traditionnels, reconnaissant le droit des pays à contrôler leurs propres économies et les flux financiers spéculatifs. La durabilité veut que la durabilité environnementale soit mise au centre des politiques de développement, des échanges commerciaux et des investissements, puisque le plus bien commun est la stabilité du globe et des rapports entre ses habitants.
La dette extérieure
La dette globale des nations en voie de développement a dépassé 2.500 milliards de dollars. L’an 2000, année du jubilé, devait être l’année où les pays riches, grâce à une importante campagne publique internationale, auraient été invité à éliminer ces dettes qui sont désormais devenues une lourde “chaîne” pour la santé humaine et environnementale des pays endettés.
40 nations ont été désignées par la B.M. et le F.M.I. comme étants Highly Indebted Poor Countries (HIPC) et un programme visant à réduire leurs dettes à un “niveau soutenable” a été élaboré. Il a été demandé aux pays bénéficiant de ces programmes, en échange, de mettre en oeuvre des réformes économiques susceptibles de réduire la charge publique, de faciliter les privatisations et de promouvoir le libéralisation du commerce. Ces politiques, d’où transparaissent les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) de la B.M. et du F.M.I., se traduisent concrètement, comme il s’est passé avec les PAS, en actions qui ne font qu’aggraver les niveaux de pauvreté de la population et les dommages pour l’environnement. L’initiative la plus incisive de la part de la communauté internationale pour la résolution du problème de la dette n’a pas su donner de fruits (cette stratégie a été exprimée lors de l’accord du sommet du G8 de Cologne et lors de la révision HIPC promue par la B.M. et le F.M.I.).
Cet échec est lié aux limites que cette initiative présentait à l’origine. Les pays et les institutions créanciers ont maintenu une position dominante: ils ont introduit une distinction entre les catégories des pays endettés et ont divisé les pays selon leur degré de développement, permettant ainsi de nouvelles conditions de conflits et de tensions; ils ont définit de façon unilatérale les critères de viabilité et les modalités d’admission pour la réduction de la dette; ils continuent à ignorer les mécanismes politiques et économiques qui ont causé la crise actuelle et ainsi nient tout principe de responsabilité.
Avec les récentes innovations, obtenues grâce à la pression de la campagne pour l’élimination de la dette, les pays et les institutions créanciers ont manifesté l’intention de rendre les mécanismes de l’élimination de la dette plus efficaces et rapides. Cependant, même en présence des plus récents changements, les résultats sont décevants: actuellement, un seul pays a réussi à annuler sa dette, l’Ouganda; seulement 12 pays sur 40 du groupe HIPC sont en phase de bénéficier d’une réduction de leur dette. Pour ces pays, en tout cas, la réduction de la dette a été en moyenne de 30 % et la charge pour le service de l’élimination de la dette continue d’être supérieur à celui de l’assistance sanitaire.
Après l’échec du sommet d’Okinawa, nous sollicitons donc un nouvel accord incluant le problème de la dette, un accord susceptible de donner des certitudes sur l’emploi des ressources récupérées à travers l’élimination de la dette en faveur des populations, un accord répondant à l’exigence d’instaurer de nouveaux rapports entre pays endettés et pays et institutions créanciers, pour la rééquilibration des relations Nord-Sud.
Nous demandons au gouvernement italien d’œuvrer afin que les pays les plus riches poursuivent:
l’élimination complète de la dette de la part des pays et des institutions créanciers; le F.M.I. et la B.M. devront en particulier garantir l’élimination de 100 % de leurs crédits (abandonnant le niveau de 30 % actuellement maintenu);
l’élimination immédiate de toutes les dettes des pays se trouvant des conditions extrêmes de pauvreté, où le revenu par personne est inférieur à un dollar par jour, tenant compte des engagements pour l’utilisation des ressources rendues disponibles lors des plans de réduction de la pauvreté et qui prévoient la participation de la société civile;
la garantie que les pays pauvres et hautement endettés ne soient pas contraints à dépenser plus pour le service de la dette que pour l’assistance sanitaire;
la garantie que les conditions pour l’élimination de la dette soient cohérentes avec l’objectif de l’éradication de la pauvreté, en évitant, par exemple, l’application du système des tarifs (user fees) pour l’accès à l’éducation et à la santé;
la recherche de moyens permanents pour la résolution de la crise de la dette à travers des formes de médiation qui garantissent les intérêts des populations des pays endettés (appuyées récemment par le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Kofi Annan) et aussi l’éventuel recours à la Cour Internationale de Justice;
la modification de l’initiative HIPC en étendant le nombre de pays bénéficiaires sur la base du niveau d’endettements et de pauvreté (pour inclure des pays comme le Nigeria et Haïti); la modification des modalités pour l’accès à la réduction et l’élimination de la dette sur la base d’exigences des populations des pays endettés; la réélaboration des politiques macro-économiques ayant créé l’initiative HIPC;
la réduction des délaisNous sollicitons au gouvernement italien de s’engager à appliquer la loi visant à éliminer la dette récemment approuvée, pour obtenir un nouvel accord qui puisse résoudre définitivement la crise de l’endettement.
L’endettement écologique et social
Nous estimons que le moment est venu pour les pays riches et industrialisés et les grandes institutions financières internationales de reconnaître la dette écologique qu’ils ont envers des pays pauvres. Même si l’économie globale a promis du développement et du bien-être pour les citoyens de la planète, la pauvreté dans le monde est malheureusement augmentée et les systèmes naturels ont subi des impacts et des pressions ayant provoqué des effets dévastateurs qui sont aujourd’hui très difficiles à réparer.
Les pays pauvres, qui ont toujours été riches en ressources naturelles et en diversités culturelles, ont été dépouillés de leurs biens pour permettre le développement du Nord. Ceci s’est réalisé grâce à leurs ressources, du pétrole eux métaux précieux, des forêts à leur très riche biodiversité.
Des connaissances ancestrales et des patrimoines génétiques ont été et sont aveuglément arrachés; les sols, l’eau, les mers et l’air ont été pollués par des déchets et résidus toxiques, des armes chimiques et des tests nucléaires; la survie des peuples indigènes a continuellement été menacée.
Le poids et l’impact environnemental (qui peut être quantifié avec ladite “Empreinte écologique”) des modèles de consommation des systèmes économiques des pays riches pèsent énormément sur les ressources de toute la planète, en particulier sur celles des pays pauvres.
Les Etats Unis ont une empreinte écologique dépassant 12 unités de superficie par habitant (celle des pays de l’Europe occidentale vont de 5 à presque 10), alors que les pays de l’Afrique Subsaharienne présentent des empreintes écologiques inférieures à 2 unités par habitant (celle de l’Erithrée est, par exemple, de 0.35).
En tenant compte des capacités bioproductives des écosystèmes et de la nécessité de la conservation d’au moins 10 % de la superficie terrestre, l’empreinte écologique des habitants de la Terre ne devrait pas dépasser 2 unités de superficie. Aujourd’hui, les pays pauvres sont donc créanciers de la dette écologique et sociale.
Nous demandons au Gouvernement italien de s’engager afin que les pays le plus riches mettent en marche un processus permettant la reconnaissance de ce crédit en amorçant des mécanismes de compensation et de “restitution”. Par exemple, des augmentations des contributions pour une coopération environnementale et socialement soutenable peuvent être évoquées, ainsi que le financement de projets internationaux de récupération environnementale, des programmes finalisés à l’utilisation des sources d’énergie renouvelables pour une décentralisation des distributions de l’énergie avec une particulière attention aux besoins du Sud du monde, des écotaxes sur les produits forestiers en faveur des pays détenant un patrimoine forestier, des engagements concrets pour réduire l’empreinte écologique des citoyens des pays du Nord à travers des politiques de sobriété et d’efficacité, etc…
Environnement et changements climatiques
L’échec dramatique de la VI Conférence des Parties de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques qui s’est tenue à La Haye en novembre dernier ne peut absolument entamer ni ralentir l’important processus finalisé à la réduction des émissions des gaz qui augmentent l’effet de serre naturel, dû aux activités de notre système de production. La troisième estimation présentée par les chercheurs et discutée lors de l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), et qui sera rendue officiellement publique vers le début de 2001, confirme et renforce les inquiétudes du monde scientifique à propos de l’augmentation de l’effet de serre naturel durant ce dernier siècle. Les prévisions d’augmentation de la température moyenne pour ce siècle, selon la deuxièmeestimation, étaient de 3,5° C, aujourd’hui, selon le nouveau rapport, la température est estimée à 6° C. La communauté scientifique internationale affirme depuis longtemps que la réduction des émissions de gaz qui augmentent l’effet de serre naturel doit être d’au moins 60 %. Le Protocole approuvé lors de la troisième Conférence de Kyoto de 1997, qui est d’application de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, prévoit seulement une réduction de 5,2 % durant la période allant de 2008 à 2012 par rapport aux émissions de 1990, ne réussit pas à décoller, vu qu’il est tombé à l’eau justement lors de la conférence de La Haye.
Il ne s’agit pas seulement de ça, mais le protocole contient de nombreux mécanismes flexibles (Emissions Trading, Clean Development Mechanism, Joint Implementation, Sinks) pouvant créer une échappatoire aux engagements que les pays doivent prendre pour réduire les émissions avec des politiques plus efficaces chez soi.
Nous demandons que le Protocole soit immédiatement ratifié par les pays industrialisés, en tenant compte que le Protocole peut avoir du succès seulement s’il assure que la majeure partie des objectifs de réduction soit atteinte grâce à des politiques nationales de contrôle des émissions; que le Protocole même soit un véritable protocole de réduction des émissions et non pas un Protocole pour l’utilisation des Sinks (les forêts sont replantées comme étant des “réservoirs” de charbon pour les soustraire aux quotas de réduction pour les pays); que le Clean Development Mechanism soit amorcé avec une priorité absolue pour les technologies utilisant l’énergie “propre”; que le Protocole soit renforcé avec des pouvoirs qui garantissent le respect des pays pour leurs objectifs.
Une nouvelle approche au développement pour la B.M. et le F.M.I.
Un nouvel agenda politique et économique pour la B.M. et le F.M.I. doit inclure une série d’éléments indispensables tels que:
l’institution d’un mécanisme d’insolvabilité (International Insolvency Procedure) qui soit basé sur des règles d’équité et de transparence et garantisse la participation active du secteur privé.
l’application d’un nouveau concept d’action où la société civile, les ONG et les parties sociales peuvent jouer un rôle important dans la détermination des conditions pour l’utilisation des fonds de développement, et où les finalités classiques d’ajustement macro-économique sont changées en finalité visant le développement humain.
Une réorientation des politiques de réduction de la pauvreté à travers l’adoption de politique macro-économiques et de développement susceptible de colmater le décalage dans la distribution des ressources et favoriser l’accès gratuit aux services de base pour les classes les plus pauvres.
Un engagement de la B.M. et du F.M.I. à soutenir les gouvernements dans la mise en oeuvre de mécanismes de contrôle sur les mouvements de capitaux pour contenir les effets néfastes des investissements ayant une finalité spéculative et stabiliser les marchés financiers. Le premier pas vers un système économique stable et transparent de gestion des flux financiers et de prévention des mécanismes spéculatifs sera très prochainement illustré par l’introduction de mesures de taxation des flux de capitaux, du type Tobin Tax.
La Banque Mondiale
Le rôle de la B.M. doit être de soutenir des programmes sociaux et de développement durable.
Nous demandons au Gouvernement italien de s’engager afin que les pays les plus riches garantissent que:
les règles soient respectées à travers l’élaboration de mécanismes clairs et vérifiables visant à garantir le respect des lignes directrices socio-environnementales par les fonctionnaires de la B.M.. De même, l’activité et la fonction de l’Inspection Panel doit être protégée.
la B.M. augmente les cotisations financières, en donnant la priorité aux pays les plus pauvres, notamment ceux déjà inclus dans le processus HIPC à condition que ces gouvernements s’engagent à utiliser ces ressources pour le développement social.
Qu’une nouvelle stratégie environnementale de la B.M. soit définie, réaffirme la centralité du développement durable et contienne des objectifs clairs et vérifiables et aussi des instruments visant à en garantir la mise en oeuvre pratique.
La B.M. devra en particulier s’engager à augmenter les cotisations de financements pour des projets d’efficience énergétique et d’énergie renouvelable sur une petite échelle.Dans le cadre de l’élaboration en cours de ses politiques forestières, la B.M. devra s’engager en donnant la priorité aux droits des peuples indigènes et de la forêt et à ne pas financer la production de bois ou tout autre projet d’infrastructure dans les forêts vierges et de frontière.
Le Fonds Monétaire International: transparence et responsabilité
En ce qui concerne le F.M.I., les pays du G8 ont approuvé à Okinawa l’institution d’un mécanisme de révision indépendant des activités du F.M.I.. Bien qu’étant une petit premier pas, même s’il est tardif, vers le contrôle et le monitorage des activités du F.M.I., cette proposition, dans sa formulation actuelle ne donnera pas de contribution notable au sont but d’origine. En effet, la structure proposée n’a pas l’indépendance nécessaire lui permettant de jouer un rôle de monitorage et de contrôle efficaces, ni reconnaît à la société civile la possibilité de s’adresser à cette structure.
Nous sollicitons donc la création d’un bureau de défenseur civique, qui soit réellement indépendant et externe au F.M.I. et auquel toutes les parties en cause et toutes les populations pénalisées par les programmes du F.M.I. peuvent s’adresser.
Finances et économie
Le processus de mondialisation est en train d’avancer avec une incroyable rapidité, en particulier au sein du milieu financier. C’est surtout à l’intérieur de cette zone que les présumées vertus sont encore loin d’être concrètes.
Les crises financières mondiales qui se sont multipliées depuis 1997 dans de différentes régions du globe, ainsi que les crises des années 80 et 90, ont clairement démontré que la structure actuelle du système financier international nécessite d’une réforme, ainsi que pour les institutions qui ont la tâche d’en préserver la stabilité.
La crise du Sud Est asiatique a démontré comment la sensibilité des flux des capitaux peut miner profondément la stabilité des pays, surtout ceux en voie de développement.
Par exemple, en 1996, 97 millions de dollars parvinrent en Thaïlande, en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie et en Corée du Sud. L’année suivante, ces pays expérimentèrent une fuite de capitaux s’élevant à 12 millions de dollars. En termes réels, il a eu une bouleversante inversion de richesse égale à 109 millions de dollars.
En outre, en 1998 et en 1999, la majeure partie des Pays de l’Amérique Latine connut une récession économique dramatique qui poussa plusieurs entreprises à l’insolvabilité d’abord, puis à la faillite.
La récession comporta aussi une forte détérioration et une accentuation de la fragilité du système bancaire, en faisant hausser les niveaux de chômage et en causant de lourdes pertes du pouvoir d’achat de nombreuses classes de la population. Plusieurs analyses concordent à ce que la cause de la crise fut l’augmentation considérable des flux à courte période. De 1990 à 1995, en effet, le flux des capitaux dans les marchés émergents triplèrent. L’effet provoqué par ces capitaux fut d’abord positif dans la mesure où ils financèrent les importations, les crédits au secteur privé, les crédits à la consommation et servirent aussi à garantir le remboursement de la dette extérieure. Cependant, la nature même des flux à courte période a une forte composante spéculative et imprévisible, et des fuites massives de capitaux mènent inexorablement à des crises financières et à des récessions économiques.
Si l’on observe l’Amérique Latine, on peut relever que le niveau de croissance, égal à 5,3 % en 1997, est descendu à 2,3 % en 1998 et à un modeste 0,3 % en 1999.
Juste après la crise, les Pays de l’Amérique Latine reçurent des prêts d’urgence de la part de banques multilatérales, c’étaient des opérations qui haussèrent de façon draconienne le niveau d’endettement qui actuellement est de 750 millions de dollars.
En outre, les prêts de sauvetage, conçus pour protéger les créanciers internationaux ont légitimé le “moral hazard”. En effet, les acteurs financiers ont pu continuer à procéder à des activités de nature spéculative et à haut risque, étant conscients que, en cas de crise, les organisations internationales les auraient sauvés.
Le crises financières ont aussi eu des répercussions concrètes en matière de bilans nationaux. Au Brésil, par exemple, juste après la crise, des retranchements furent effectués dans le secteur de l’agriculture, de la sécurité sociale, de l’environnement, de la sécurité alimentaire et de l’assistance aux familles vivant dans l'indigence.
Nous sollicitons en particulier au Gouvernement italien de considérer ces propositions.
La première proposition réside dans le contrôle des capitaux. Jusqu’il y a quelques années les contrôles des capitaux étaient un sujet tabou. Le 1er septembre 1998, la Malaisie devint le premier pays asiatique à être touché par la crise économique et à annoncer une série de mesures de contrôle sur les capitaux et sur le taux d’échange dans une tentative de mettre en marche une reprise économique.
Au niveau académique, par contre, le tabou contre les contrôles des capitaux ne se fit pas sentir en 1998, lorsqu’un économiste du M.I.T., Paul Krugman, invita les gouvernements asiatiques à introduire des contrôles sur les capitaux comme un unique moyen pour sortir de la crise.
En premier lieu, le Gouvernement italien pourrait proposer une légitimation politique de la faculté d’introduire des contrôles sur les capitaux en cas de crise financière.
L’expérience de la dernière décennie démontre clairement comment les capitaux étrangers de nature spéculative peuvent nuire au développement d’un pays.
Les Pays du Sud du Monde ont un besoin désespéré d’investissements étrangers, sans aucun doute, mais d’investissements à long terme, productifs et compatibles avec les objectifs de développement social et durable.
En second lieu, le Gouvernement italien doit s’engager afin que les pays les plus riches instituent un impôt sur les transactions de devises.
L’application de cet impôt pourrait:
réduire l’incidence des capitaux spéculatifs à courte période,
renforcer l’autonomie politique nationale,
renforcer les potentialités de rendement fiscal des Etats provenant de l’internationalisation des marchés,
redistribuer de façon plus équitable la pression fiscale entre les différents secteurs de l’économie et
contrôler les mouvements de capitaux pour combattre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles.
En plus de ces objectifs, cette taxe pourrait repérer des ressources à destiner à des objectifs globaux tels que la lutte contre la pauvreté, la protection des droits de l’homme et du patrimoine environnemental.
Il est cependant fondamental que les ressources créées à l’aide d’une taxe sur les transactions de devises soient utilisées pour la réalisation de projets cruciaux, tels que destiner 0,7 % du PIB à la coopération au développement, engagement dont la réalisation devrait être un objectif prioritaire.
Commerce mondial et pourparlers du Millennium Round
Après l’échec de la Troisième Conférence Interministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Seattle en 1999, et malgré les grandes déclarations de démocratie et de transparence, peu de choses ont changé à l’intérieur de l’organisation. Rien n’indique qu’il y ait eu une pause réelle de réflexion, ni si l’on a cherché à interpeller les citoyens des pays membres pour avoir leur opinion ou mettre en marche une consultation sur les principaux sujets de discussion.
Au contraire, à travers de diverses rencontres, le commissaire européen pour le commerce Pascal Lamy, qui représente aussi la position de l’Italie, aussi bien que les ministres du commerce extérieur des pays industrialisés, y compris le ministre italien de l’industrie et du commerce extérieur Letta, se sont engagés à surmonter ce qu’ils ont toujours considérés comme un simple “arrêt” du processus vers l’élimination des obstacles entravant le marché global des marchandises et des services.
Des négociations relatives au TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) et au GATS (General Agreement on Trade Services).
Au cours de l’an 2000, les pays les plus pauvres ont plusieurs fois réitéré que, avant l’organisation d’un nouveau round de négociations, il est nécessaire de corriger les disparités contenues dans les accords actuels.
Les pays les plus riches n’ont pas répondu à ces requêtes et, lors de toutes les réunions du Conseil Général de l’OMC, ont évité de prendre des décisions. Au contraire, on a assisté à une pression continue de la part des représentants USA et de l’Union pour convaincre les pays réticents de la nécessité de mettre en marche le Millennium Round.
En outre, dans le siège Genevois de l’OMC, les négociations pour le renouvellement de l’accord sur l’agriculture et le commerce des services ont continué dans la discrétion habituelle. Elles visaient l’expansion de la couverture du GATS et les plus différentes ergoteries techniques ont été utilisés pour obtenir les plus importants résultats possibles vers la libéralisation des secteurs relatifs aux services de base. Relativement à la révision de l’accord TRIPs, et malgré les efforts des pays africains pour revoir plus profondément le texte de l’accord (surtout la révision de l’article 27.3 (b) concernant la brevetabilité des formes vivantes, l’effet des droits de propriété intellectuelle sur la vie et la sécurité alimentaire, sur les droits des communautés locales, l’accès aux ressources et les effets sur l’environnement), les pays occidentaux considèrent le prolongement des temps relatifs à la mise en application de l’accord comme l’unique concession possible. Depuis lors, malheureusement, rien de concret n’a été fait pour accueillir les requêtes des pays en voie de développement et de la société civile qui a manifesté à Seattle. Au début de décembre, le commissaire Lamy a déclaré que la proposition de l’Union européenne sera reformulée pour converger vers les attentes de ces pays, en soulignant, cependant, que pas tous les pays membres concordent sur cette position. Au terme de 2001, le prochain meeting ministériel aura lieu et avec une probabilité que l’activité diplomatique visant à éviter un non-accord comme à Seattle sera très intense.
Nous demandons au Gouvernement italien de s’engager afin que les pays les plus riches établissent que :
le Millennium Round ne soit pas mis en marche
les accords OMC ne s’étendent pas à des aspects déterminants pour le bien-être des hommes et des systèmes naturels, comme l’eau, la nourriture, les services sociaux de base, la santé et la sécurité, la protection des être vivants. Les négociations relatives au renouvellement du GATS ne doivent pas concerner des secteurs comme la santé, l’éducation, l’énergie et d’autres services de base qui ne doivent pas faire l’objet de règles internationales du libre commerce ;
l’accord TRIPs soit revu selon les indications suggérées par le Groupe des Pays Africains et contenues dans le document présenté par le Kenya (WT/GC/W/302 du 6.9.1999) où il est requis que plantes, animaux, micro-organismes et tous les autres êtres vivants ainsi que leurs parties ne peuvent être brevetées. Nous invitons les pays du G8 à appuyer cette proposition et à mettre en oeuvre la révision, sans délais, et une moratoire sur l’accord jusqu’à son échéance ;
la révision de l’accord ne permette pas l’augmentation du prix des médicaments dans les pays du Sud du monde ;
les mesures prises pour promouvoir et protéger la sécurité alimentaire, l’agriculture, les modes d’élevage ne doivent pas se soustraire aux réglementations internationales du libre commerce, vu la nourriture a un statut de bas. Les négociations pour le renouvellement de l’accord sur l’agriculture doivent tenir compte de tout cela. Nous estimons que tous les pays, surtout les pays les plus pauvres, doivent avoir le droit d’adopter des choix politiques autonomes, basées sur les respectives exigences et priorités.
Les accords visant à stabiliser la production et les prix soient reétablis. Ceci aurait une importance fondamentale pour des secteurs comme le café, les bananes, le cacao pour éviter des excès de production susceptibles de provoquer des chutes de prix au dam des petits agriculteurs et pour la main d’oeuvre.
L ‘OMC mette en marche un processus de révision radicale de sa propre structure et de son propre moyen d’oeuvrer pour devenir une institution démocratique et transparente, justement parce que tous les peuples ont le droit de connaître et décider les engagements qui les concernent sur le plan du commerce international.
Réforme des agences de crédit à l’exportation
Le manque de contrôle démocratique et de contraintes aux activités des agences de crédit à l’exportation crée une situation grâce à laquelle les sociétés multinationales peuvent donner le coup d’envoi à une course vers le bas, en optant de s’adresser à ces agences ayant des règles plus faibles ou superficielles et leur permettant ainsi d’oeuvrer sans aucune contrainte. Il s’agit de la même situation en passe de se concrétiser avec l’éventuelle approbation de l’Accord Multinational sur les Investissements (AMI) : la différence dans ce cas est que la course vers le bas serait financée directement avec les fonds du contribuable.
Les gouvernements des pays les plus riches, le club du G8, qui dominent sur une échelle mondiale les flux de garanties pour le crédit à l’exportation et des assurances sur les investissements, se sont engagés à conclure avant la fin e 2001, année où le sommet aura lieu en Italie, un processus d’adoption des lignes directrices communes concernant l’impact environnemental.
Un tel processus de négociation est effectué dans le cadre de l’OCSE. L’Italie est la lanterne rouge : au mois de mars seul, une étude sur la faisabilité de l’éventuelle adoption de procédure d’évaluation d’impact environnemental a été rédigée.
Nous sollicitons au Gouvernement italien de s’engager afin que les pays les plus riches :
adoptent avant l’année 2001 des critères sociaux et environnementaux contraignants pour les activités des agences de crédit à l’exportation définissent une “liste noire” de projets que la SACE ne devrait pas appuyer en aucun cas, tels que :
des centrales nucléaires ou des incinérateurs et des systèmes thermoélectriques qui ne respectent pas les standards les plus élevés concernant l’efficacité énergétique et la réduction progressive d’émissions de gaz-serre ;
de grandes digues ;
l’exportation d’armes, de substances toxiques ou nocives interdites par les conventions internationales ;
l’exportation de technologies et de produits pouvant être utilisés par les forces de police et militaires pour la répression et qui pourraient comporter une violation des droits de l’homme (dual-use goods) ;
des projets de développement ou des infrastructures dans des zones protégées, réserves naturelles et parcs qui ne soient pas compatibles avec les finalités des parcs.
De nouveaux projets d’exploration et d’exploitation de combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz) dans des zones sensibles telles que les forêts vierges,
Des activités sur une échelle industrielle d’extraction et transformation de bois à l’intérieur de forêts tropicales, tempérées et boréales,
Des projets d’infrastructure comportant l’évacuation forcée de mille personnes ;
définissent une “ liste blanche ” de projets et technologies qui devraient bénéficier de conditions favorables à d’autres formes d’encouragement d’assurance et financés par la SACE. Cette catégorie inclurait des projets et des technologies viables et à un impact bas, comme par exemple des sources d’énergie renouvelables et sur une petite échelle (photovoltaïque, géothermique, éolien), visant à encourager le transfert de technologies viables dans les pays en voie de développement et les Pays ayant une économie en Transition et l’expansion des PME oeuvrant dans le secteur ;
repèrent un mécanisme d’évaluation préventif des projets qui ne rentrent pas dans les catégories citées ci-dessus et qui prévoit l’introduction de différentes catégories de projets, selon leur effet social et environnemental potentiel. La B.M., par exemple, utilise les catégories A, B et C selon l’impact environnemental et fixe l’obligation pour qui demande le financement de mener et publier les recherches de la VIA pour les projets de catégorie A ;
repèrent des critères d’évaluation inspirés aux “standards” les plus élevés et reconnus au niveau international, en utilisant comme point de départ ceux suivis par les agences IFC et MIGA de la B.M. et ceux du Development Assistance Committee de l’OCSE ;
instituent l’obligation de publier chaque année une liste des projets appuyés et approuvés, qui spécifie quelles mesures ont été entreprises pour réduire l’impact des projets particulièrement risqués.
Technologies génétiques : risques inutiles, dommages certains pour les populations et l’environnement
Le modèle FAO et IFPGRI ont démontré que, à l’horizon de 2020 et exceptionnellement pour quelques zones extrêmement limitées, la production mondiale agricole est suffisante pour faire face à la croissance de la population aussi bien à la demande (Rome, 1996 – 2000).
Il est évident qu’il n’existe pas à l’état naturel aucun besoin réel de multiplier de façon exponentielle la production totale de nourriture et, ainsi, la thèse selon laquelle le génie génétique mettra un terme à la faim dans le monde ne trouve aucune justification. En plus, des nombreuses études menées aux USA ont démontré que la productivité des terrains cultivés avec des OGM est inférieure à ceux cultivés traditionnellement (Benbrook Consulting Services Sandpoint, Idaho – Institute of Agriculture and Natural Ressources of University of Nebraska). Le problème de la faim dans le monde dépend uniquement de choix politiques et économiques.
Après la mécanisation et la chimie, les technologies génétiques ouvrent une nouvelle phase dans le processus d’industrialisation de la production agricole.
L’élément qui constitue cette nouvelle phase est l’énorme degré de concentration de l’offre de nouvelles technologies dans les mains de groupes restreints d’industrie agro-chimiques et de capitaux financiers qui, à travers des politiques de concentration et de concertation, créent des monopoles mondiaux dans des secteurs stratégiques tels que les semences.
Aujourd’hui, partout dans le monde, 1500 plantes différentes sont cultivées, mais 95 % du besoin alimentaire total est fourni par seulement 30 espèces de plantes ; 10 plantes cultivées (soja, canne à sucre, pommes de terre, patates douces, igname, millet, blé, riz, mais, et sorgho) fournissent 75 % des produits alimentaires les plus consommés sur Terre.
Plus de 60 % des calories d’origine végétale sont extraits de 3 céréales : blé, riz et mais. Il est évident qu’une dépendance aussi forte rend inefficace et ainsi peu crédible toute stratégie pour la sécurité alimentaire d’un pays, d’un continent ou de la planète qui ne soit pas basée sur la possibilité de diversifier de façon stable et permanente les sources d’approvisionnement de l’alimentation humaine.
La diversité biologique, base de l’agriculture même, est en train de se réduire de manière draconienne. Face à la rapidité de propagation des processus d’érosion génétique variétale et entre les espèces, il est nécessaire de procéder à des initiatives visant à les endiguer de façon significative.
L’augmentation de la productivité – souvent caractérisé par des pratiques agricoles qui forcent la Nature au lieu de la seconder – mène à une diminution de la fertilité et à l’inviabilité des processus. Il est nécessaire donc de d’affronter cette contradiction et chercher à augmenter la productivité des écosystèmes sans changer les caractéristiques des écosystèmes naturels, ou du moins en recréant ces caractéristiques au sein des agro-écosystèmes modernes.
La promotion aveugle du développement et de la commercialisation des OGM, à travers une législation qui n’en garantit pas l’usage monopoliste aux détenteurs des brevets, altère de façon arbitraire, irréversible et irresponsable la vie sur la planète. Le monopole mondial des multinationales bio-technologiques dans un secteur clef comme celui agro-alimentaire comporte en outre un obstacle notable pour la recherche publique et constitue un instrument supplémentaire d’asservissement des PVD, légitimé par une réglementation de brevets (la Directive 98/44/EC, à titre d’exemple) qui, en permettant la brevetabilité d’OGM, de plantes, d’animaux et même des parties du corps humain, manque de respect à de nombreuses Conventions Internationales : la Convention sur le Brevet Européen (1973), la Déclaration de l’UNESCO pour la Défense du Génome Humain (5/11/97), la Convention du Conseil d’Europe de 1996, etc…
Nous demandons donc :
le rejet de toute proposition qui introduit des législations basées sur la brevétation d’êtres vivants. Nous estimons en particulier qu’une reprise des négociations pour la révision de l’article 27.3 b de l’accord TRIP est urgente, de façon que les Etats puissent identifier des formes de protection des conventions biologiques basées sur les droits des ressources génétiques.
l’introduction de critères et de normes sur la responsabilité civile et pénale pour les producteurs d’OGM, entrant en vigueur en cas de dommages à l’environnement ou à la santé humaine.
L’adoption des mesures du Protocole de Cartagena sur la Bio-sécurité, en particulier pour ce qui est du commerce international (en garantissant, en cas de différends internationaux, la priorité du Protocole sur les traités internationaux de commerce).
Une suspension totale à toute reconnaissance de droits de brevet sur les formes de vie.
Le gel immédiat de toute procédure visant à l’introduction sur le marché des OGM ayant un impact possible sur l’agriculture, l’environnement et l’alimentation de l’homme, sur la base du principe de précaution et en considérant qu’aucune procédure scientifique autonome et indépendante n’a été développée dans aucun des pays membres du G8. Cette procédure serait souhaitable dans le but d’évaluer, à travers une approche complexe et systémique, les risques provoqués par l’impact des OGM sur les systèmes agraires.
Le renforcement de la recherche publique visant à protéger la biodiversité, à l’amélioration génétique des végétaux sans le recours à des technologies transgéniques, à l’approfondissement de la connaissance de la Nature dans le but de la seconder et non pas la forcer.
Une planète en guerre
Une fois le mur de Berlin tombé, on a espéré que le monde aurait connu une vraie paix, non plus menacée par une course à l’armement atomique. Au contraire, il y a eu une escalade de guerre combattue avec des armes conventionnelles sans qu’aucune des organisations internationales ait trouvé un moyen de les empêcher ou au moins de les freiner.
Derrière cette escalade se cachent de considérables intérêts économiques, à partir du moment que la guerre et la peur de la guerre ont toujours été le plus juteux business du monde.
Après la tendance négative liée à la crise de la guerre froide, qui avait induit à fermer les usines et à de reconversions, même le commerce des armes italiennes, depuis quelques années, recommence à croître. Le volume d’affaires des armes effectivement livrées à l’étranger a aussi augmenté : en 1999, le chiffre d’affaires a été de 1715 milliards, 15 % en plus de deux ans auparavant.
La recette gagnante semble être la coproduction avec les européens et un marketing agressif.
Derrière la croissance forte des exportations en 1999, il y a tout de même un contrat à douze zéros stipulé entre les Emirats Arabes Unis et la joint-venture italo-française Elettronica-Thomson.
C’est une industrie, celle des armes et de la guerre, qui provoque de façon directe la mort et la pauvreté, mais que personne essaie à arrêter parce qu’elle comporte d’énormes bénéfices.
Dans la liste des pays importateurs de chars de combat, d’avions et d’autres armes lourdes d’origine italienne, il y a les pays du Sud du Monde, qui ont pris possession d’environ 65 % des exportations ayant eu le feu vert de la part du gouvernement italien.
La moitié de l’Afrique est continuellement armée, des enfants soldats, des pays entiers condamnés à cohabiter avec des centaines de millions de mines. Il est question du flux immense et sordide de diamants, d’or et de pierres précieuses qui parviennent en occident du Sud du Monde.
La convoitise pour les grands gisements pétroliers ne connaissent pas de règles ni de barrières. Les intérêts américains plutôt que français ou belges ont signifié armes et argent aux gouverneurs africains, et un enfer sans issue pour les peuples de ces pays.
“Nous sommes extrêmement inquiets du fait que les armes, mêmes italiennes, sont en train d’affluer dans des zones à haut risque et à haute tension“, dit Maria Villa, responsable du Département Armes d’Amnesty International, qui accuse l’exportation vers des zones chaudes telles que la Chine, la Turquie, l’Inde, l’Algérie et les Philippines.
Mais ceci ne suffit pas. Dans de brefs délais les armes deviennent dettes, dettes inutiles s’il n’y a pas de guerre, mais dettes à régler pour avoir d’autres fonds, et pour avoir ces fonds, d’autres dettes. Il faut donc accepter les recettes du F.M.I., situation qui provoque des licenciements, de la pauvreté, des protestations, des accrochages et de la répression, et voilà que les armes sont utilisées. Cependant, les armes ont besoin d’entretien, coûteuse, et d’autres dettes doivent être réglées.
Cette forte incidence des PVD dans le commerce des armes donne lieu à un autre problème : qui s’occupe de régler ces transactions milliardaires?
Selon le responsable du centre de documentation de l’Archivio Disarmo de Rome, Maurizio Simoncelli, ce sont les crédits des exportations qui stimulent le marché mondial des armes, outre la réorganisation des forces armées des pays industrialisés : environ un quart de la dette publique des nations du Tiers Monde est dû à des achats militaires et si le pays qui effectue la commande ne règle pas, ce sont les contribuables du pays exportateur qui en feront le frais, parce qu’il existe souvent une institution étatique qui est garante dans ces cas (en Italie, c’est l’Institut pour les Services d’Assurances du Commerce Extérieur).
Sans compter que les effets de cette folie peuvent déjà être remarquées dans les pays occidentaux.
Combien de retranchements à la charge publique, aux retraites, à la santé et à l’éducation ont été effectuées durant ces dernières années par les gouvernements du vieux continent pour “accéder en Europe“? Combien de souffrances, de retraites minimales, de personnes mal soignées, mal instruites, au chômage qui auraient eu un sort meilleur si des retranchements avaient été appliqués sur les charges de la guerre ? En Italie seule, alors que dans la Constitution “est contre la guerre comme moyen de résolution des conflits“, 100 milliards de lires par jour sont dépensés pour se préparer à la faire. Des milliards de lires dépensés pour des avions et des portes avions au lieu d’écoles et d’hôpitaux, qui offriront de l’uranium appauvri à des gens déjà pauvres.
Si l’Italie est le sixième entre les pays exportateurs d’armes conventionnelles (source Sipri), elle est le troisième dans la production d’armes légères qui, selon une étude de la Croix Rouge Internationale, sont responsables de la majorité des morts de civils dansles guerre actuelles. L’exportation de pistolets, fusils et munitions, cependant, est beaucoup plus difficile à contrôler: selon l’Observatoire pour le Commerce des Armes de Florence, plusieurs carabines et de revolvers sont exportées comme des “armes sportives“, pour éviter le contrôle de l’Etat et se retrouvant ainsi entre les mains de guerilleros de tous types, enfants compris. Les dernières données de l’Istat disent que lors du premier semestre 2000, l’Italie a exporté 13 millions de kilos d’armes légères pour une valeur de 285 milliards de lires : parmi les destinataires il y a la Colombie et l’Indonésie. “L’Italie a une excellente loi en matière de commerce d’armes qui en interdit la vente à des pays belligérants et responsables de violations prouvées des droits de l’homme – précise Maria Villa – cependant, l’application n’est pas également courageuse et nous retrouvons des pistolets Beretta dans les caves du Sierra Leone : en termes de contrôle des armes, entrer en Europe a signifié, pour nous, une diminution des contrôles”.
Enfin, au cours du long chemin vers une démocratie planétaire, il est urgent de comprendre que rien ne nuit plus à la démocratie que la guerre. L’OTAN qui désarçonne l’ONU et les pays qui la composent, l‘ONU même qui ne respecte pas ni fait respecter les règles qu’elle a fait, des votes parlementaire et non pas des faits, des cachets économiques à posteriori, la dignité humiliée de pays souverains selon les raisons de l’“Alliance”. Nous nous souvenons de Ustica, du Cermis, des bombes dans l’Adriatique, du chalutier japonais coulé, sans qu’aucun responsable n’ait été trouvé et condamné.
Nous avons combattu contre l’Iraq pour éliminer Saddam Hussein sans succès, nous nous sommes vengés sur les enfants iraquiens avec un embargo dont nous n’avons pas le courage de sortir.
Nous avons combattu en Somalie pour restaurer l’espoir et nous nous sommes retirés en laissant à eux-mêmes, sans avoir rien résout, avec les mystères jamais résolus de la mort de Ilaria Alpi et Hrovatin, et le scandale des violences de nos soldats sur les femmes et les prisonniers somaliens.
Nous avons bombardé les Kosovars pour les aider en détruisant leur pays. Nous leur avons jeté des bombes à l’uranium appauvri pour les sauver, après avoir sabordé dix longues années de lutte populaire non-violente.
Nous avons armé les groupuscules albanaises les plus violentes, en les appuyant et en les défendants. Maintenant, nous mous apercevons tristement qu’ils tuent les Serbes restés et les Albanais modérés,.
Nous sollicitons au Gouvernement italien de s’engager afin que chacun des pays les plus riches s’engage pour :
interdire toute vente d’armes (de guerre et légères) à des pays en guerre, que ce soit contre d’autres Etats qu’à l’intérieur de leurs frontières, créant en même temps des mécanismes efficaces pour prévenir des fraudes, et des productions sur licence.
interrompre immédiatement l’usage des armes à l’uranium appauvri, du moins jusqu’à la preuve irréfutable de leur inoffensivité totale pour les soldats et, surtout, pour les populations civiles habitant dans les territoires bombardés.
stimuler, instituer et promouvoir l’utilisation de corps de paix non armés et non violents en alternative et avant de n’importe quelle intervention armée. Utiliser ses propres troupes seulement à l’intérieur des opérations des Nations Unies comme garantie, même partielle, de la démocratie de la décision prise.
Suspendre immédiatement l’embargo contre l’Iraq, avec l’exclusion de fournitures militaires, cause de la mort de centaines de milliers d’enfants innocents.
Promulguer des lois finalisées à garantir la transparence, punir les responsables en cas d’événements tels que la tragédie du Cermis ou du chalutier japonais.
(c) Open Content License - Rete Lilliput -2001
Favorisé par: Aifo, Beati Costruttori di Pace, Bilanci di Giustizia, Campagna chiama l'Africa, Campagna dire mai al MAI, Campagna globalizza-azione dei popoli, Campagna Sdebitarsi, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, CoCoRiCò, CTM Altromercato, Mani Tese, Nigrizia, Pax Christi, Riforma della Banca Mondiale, WWF