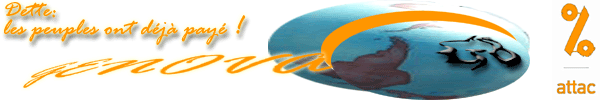

Diplomatie de club et régulation internationale
Par: Marie Claude Smouts
A partir de 1971, date de la suspension de la convertibilité du dollar en or qui a marqué l'effondrement de l'ordre de Bretton Woods, le monde n'a pas retrouvé de règles et de structures permettant d'introduire un minimum de stabilité dans les échanges internationaux. le marché est devenu le principale -sinon l'unique- moyen d'ajustement, dans un contexte d'instabilité monétaire, de compétitivité exarcerbée, d'hypertrophie du secteur financier (plus de 1 000 milliards de dollars échangés chaque jour), de déficits publics presque partout menaçants. Dans toutes les sociétés, l'écart se creuse entre ceux qui ont les moyens de jouer ce jeu de la compétition internationale et ceux qui en sont exclus. Les déséquilibres sociaux s'aggravent et l'Etat est devenu plus fragile. Le besoin d'une politique économique internationale concertée est de plus en plus fortement ressenti par les dirigeants des domaines publics et privés.
Pendant plus de quinze ans (1974 - 1980), les Etats du Sud ont lutté pour que cette définition d'un minimum d'ordre économique international se fasse dans les organisations du système des Nations Unies où ils pouvaient s'exprimer à égalité avec les grands (selon le principe "un pays = une voix"). Ils demandaient aussi la construction d'un nouveau système de stabilité des taux de change avec un FMI (Fonds monétaire international) rénové et moins aristocratique. Leurs revendications ont été écartées. Les Etats occidentaux ont pris l'habitude de contourner les instances multilatérales et de rechercher entre eux, de façon informelle, les moyens de reprendre la maîtrise des principaux leviers de l'économie mondiale.
Les sommets des pays industrialisés sont l'illustration la plus spectaculaire de cet esprit de club prévalant désormais sur les grandes machines mises en place dans l'après-guerre. Regroupant les chefs d'Etat et de gouvernement des sept pays les plus riches de la planète (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada), le G7 n'ait été conçu en 1975, que comme un instrument diplomatique particulier répondant au besoin d'une concertation accrue, à un moment où les économies occidentales connaissaient un ralentissement de leur activité sans précédent depuis la guerre. Discussions informelles, délégations réduites au minimum, absence de bureaucratie, la structure était souple et devait encadrer des échanges officieux.
Très rapidement, cependant, le G7 s'est institutionnalisé. le Président de la Commission de l'Union européenne a obtenu d'y être invité aux côtés des Chefs d'Etats et de gouvernement. Le G7 s'est doté d'une infrastucture légère assurant la préparation et le suivi des rencontres - les fameux "sherpas" (conseillers des gouvernants) observent l'évolution des échanges et se réunissent plusieurs fois par an dans la plus grande discrétion - et a acquis une dimension symbolique lui conférant une existence permanente.
Au-delà des "rencontres au sommet" annuelles, le G7 représente, en effet, le groupe formé par les ministres des Finances des sept grands pays industriels. Souvent accompagnés des gouverneurs des banques centrales, ces derniers ont pris l'habitude de se réunir fréquemment (au moins quatre fois par an) et restent en liaison constante. Le G7 tient conseil à la veille de toutes les rencontres internationales: réunions du FMI, de la Banque mondiale, de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), etc. Il ne cesse d'léargir ses thèmes de discussion: commerce, monnaie, taux d'intérêt à long terme, fonctionnement des marchés financiers, aide et rééchelonnement de la dette etc. Au sommet de Détroit, les 14 et 15 mars 1994, les ministres du Travail ont, pour la première fois, siégé au G7, dans le cadre d'une grande conférence sur l'emploi et le chômage.
Pour ceux qui n'en font pas partie, cette instance de concertation informelle dégage souvent une impression de force et d'homogénéité bien plus grandes que celles dont elle bénéficie réellement. Les seules réussites notables du G7 ont été les trois interventions concertées des banques centrales sur le marché des changes pour éviter un "atterrissage forcé" du dollar: les accords dits "du Plaza" (22 septembre 1985), ceux "du Louvre" (22 février 1987), enfin l'action du 4 mai 1994, selon un plan d'urgence adopté par les ministres des Finances quinze jours auparavant. Cette résistance face aux mouvement spéculatifs sur un marché financier fragile et volatile est à mettre au crédit du G7.
Pour le reste, les résultats sont restés faibles. En matière de coopération économique, la finalité officielle du G7 était l'harmonisation des calendriers, des méthodes, des options de politiques économiques des différents participants dans le cadre d'une économie "ouverte". Le manque d'accord conceptuel sur la nature des problèmes à résoudre et sur les moyens de les traiter n'a pas permis cette convergence des choix conjoncturels. Le renforcement des liens entre les grands pôles économique - Japon, Etats Unis, Union européenne - n'a pas progressé. Chacun a continué à se sentir tiers par rapport aux deux autres.
Le G7 se distingue donc surtout par ses prises de position générales, ses engagements en faveur du libre-échange et son orthodoxie libérale. En 1979, la priorité donnée à la lutte contre l'inflation lui avait fait abandonner son objectif de retour au plein emploi au profit de "l'ajustement positif" (c'est à dire des restructurations) comme thème central de propositions. En 1994, il s'est prononcé pour la "flexibilité" de l'emploi et du coût du travail.
La composition de ce "club de riches" a toujours été critiquée, en particulier par la Russie qui, en 1994, n'y a bénéficié encore que d'un statut d'invité, incertain, et pour les seuls dossiers politiques.
L'OCDE, définition de codes de conduite.
Le G7 n'est cependant que l'émanation la plus médiatisée d'un club plus vaste représenté par les 24 pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), lieu de rencontre et de rélfexion visant à la coordination des politiques économiques et sociales. Avec les "sherpas" et les hauts fonctionnaires des grandes institutions financières internationales, les experts de cette instances contribuent à imposer l'idée qu'il existe une économie internationale ouverte et prospère intéressant tous les pays du monde. Dans la pratique, elle est surtout utilisée par ses membres pour définir, entre eux, des codes de conduite introduisant un peu de discipline dans la course effrénée aux exportations ("consensus OCDE" sur les crédits à l'exportation, code anti-corruption, etc.). L'observation de ces règles n'est pas obligatoire, elle ne repose que sur un "gentlemen's agreement" et sur la pression qui pourrait s'exercer entre pairs.
Cette recherche de règles du jeu entre "gens du même monde", par consensus, sans droit ni sanction, s'exerce dans bien d'autres domaines: la non-prolifération nucléaire avec le Club de Londres, la gestion de la dette du tiers monde avec les clubs de créanciers (Club de Paris, etc.) l'aide aux pays d'Europe centrale et orientale avec le Groupe des 24, le maintien de la "paix" avec les trois membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations unies (P3). Dans un monde anarchique et sans points de repère, cette "diplomatie de club" tente d'introduire un minimum de régulation. Par bien des points, elle s'apparente au concert européen du XIX ième siècle: sous couvert d'assumer des responsabilités, un directoire des grands écarte la majorité des peuples de la gestion des affaires... cette fois, suprême paradoxe, au nom de la mondialisation des échanges!