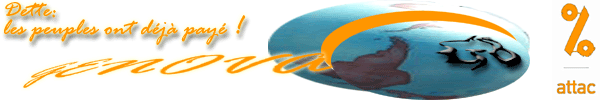

Documents:
| Plate-forme Dette |
G8 | Documents | ATTAC
FR documents |
Pays Pauvres Très Endettés
Allégements poids plume pour une dette de plomb
Par: Alain Saumon
Source: à titre personnel. Contact
Au G7 de Lyon, en 1996, le groupe des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) a été créé sur proposition de la France. Pour la communauté dirigeante mondiale une nouvelle crise de la dette s’annonçait et il devenait soudainement urgent d’alléger le fardeau insoutenable de la dette de ces pays — certains dirigeants étaient sans doute mus aussi par quelques intérêts financiers inavoués, et d’autres par la tentation de la démagogie sociale. 42 pays sont actuellement considérés comme pauvres et très endettés. Leur dette s’élève à 214 milliards de dollars (Mds $).
Dans un article au titre évocateur, « qui annule sa dette relève la tête » (dossier « dette & développement », Attac, mai 2001), Jean-Marie Harribey donne le ton : l’état des lieux du tiers-monde est désastreux et les erreurs des stratégies économiques et développementales sont patentes ; les occidentaux gagneraient en dignité à annuler sa dette. Éric Toussaint du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM) l’explique patiemment depuis des années. Depuis la crise de remboursement des années 80, de nombreuses voix s’insurgent contre le néo-colonialisme qu’imposent les pays riches aux pays pauvres, notamment par le biais des programmes d’ajustement structurel (PAS).
Pour Harribey, en économie, « ajuster signifie broyer (ou plus soft, flexibiliser) et structurel désigne le social. Résumé : ajuster le structurel c’est “ broyer le social” ». De fait, les coupes sombres dans les dépenses publiques d’éducation et de santé, la suppression des subventions aux produits de base… et l’ouverture tous azimuts des économies fragiles des pays du sud ont permis l’asservissement total des populations au profit d’une infime minorité de libéraux et de corrompus.
Force a été de constater que la marchandisation des pays en développement ne résolvait pas le problème de la dette. Ni la Facilité d’Ajustement Structurel (FAS) (à partir de 1988) ni la Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) (à partir de 1994) — des prêts à taux avantageux — ne résoudront la quadrature du cercle. Pas davantage la requalification des PAS en Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) en 1998, ni le changement par le Fonds Monétaire Intenational (FMI) en novembre 1999 de la FASR en Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FPRC) — des prêts versés en 3 ans, remboursables en 10 ans, à un taux concessionnel de 0,5 %. Fin 1999, 52 pays dont 31 africains bénéficiaient de ce type de prêt.
Pour les CSLP et les FPRC, le changement par rapport au PAS, c’est que le pays concerné doit apporter un document signé par la société civile (ONG, syndicat…) certifiant que les gouvernants sont sur la bonne voie pour réduire la pauvreté. Ainsi voit-on fleurir de nouvelles ONG dociles, pilotées par les ministres, députés et autres corrompus des régimes en place, qui ont la signature facile. On peut apporter avec soi ces ONG quand on va dans les réunions internationales. C’est pratique. En mai 2001, à Bruxelles, à la troisième conférence des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés (PMA), elles étaient nombreuses ; une militante burkinabé les a qualifiées d’ « ONG portables ».
En France, début 2001, une plate-forme d’associations (dont ATTAC et le CADTM-France), coordonnée par le CCFD s’est mise en place pour l’abolition de la dette. Nommée « Dette & Développement » elle fait les 4 constats principaux suivants :
- le remboursement de la dette des pays du sud est aujourd’hui un obstacle majeur à leur développement ;
- la co-responsabilité des prêteurs et des emprunteurs dans un processus d’accumulation dans la dette, entaché d’injustices et d’illégitimités, doit être reconnu ;
- l’absence de “mécanisme d’endettement” pour le règlement des problèmes d’endettement conduit à une aggravation de la situation des pays surendettés ;
- si la France est aujourd’hui engagée dans un processus d’allègement de ses créances envers les pays les plus pauvres, il lui reste encore beaucoup à faire.
100 Mds $ annoncés… 2,5 affectés
Les annonces de Lyon puis de Cologne n’étaient pas les premières dans le genre. « Dès » 1988, au G7 de Toronto, les bailleurs de fonds ont compris qu’un certain nombre de pays ne parviendraient pas à rembourser leur dette. De rééchelonnements en effets d’annonce, quelques mesures infinitésimales ont été prises pour soulager les plus écrasés : le Club de Paris (clubdeparis.org) estime à 55 Mds $ le manque à gagner pour les créanciers entre 1988 et 1999. Entre temps, selon la Banque mondiale, la dette des Pays Pauvres Très Endettés est passée de 141 à 214 Mds $.
Alléger c’est (clubdeparis.org) « … réduire le poids de la dette extérieure à un niveau soutenable. C’est-à-dire à un niveau qui leur permette de servir leur dette de manière confortable avec leurs ressources d’exportation, ainsi que les dons en investissements et capital qu’ils reçoivent. » « Confortable » (sic !). La mise en œuvre des mesures d’allègement est confiée aux Institutions Financières Internationales (IFI) et plus spécialement au FMI et à la Banque mondiale. En 1999, au G7 de Cologne, l’initiative est « renforcée » : les mesures (termes) de soutenabilité sont revues à la baisse et les procédures accélérées. En 2001, sur les 100 Mds $ d’allègements annoncés, 70 (dont 20 en créances d’aide publique au développement (APD) et 50 en créances d’origine commerciale et multilatérale) sont finalement retenus… et 2,5 affectés, soit un peu plus de 1 % de la dette des PPTE. Comme l’écrit le député Jean-Claude Lefort dans son rapport du 23 novembre 2000, c’est « un état d’avancement décourageant ».
Le parcours du candidat à l’allègement
Le rapport du 23 août 2000 du Ministère des Finances sur les activités du FMI et de la Banque mondiale expose les modalités de l’allègement.
Le stock de la dette qui sera traité est celui qui précède le 1er rééchelonnement de l’État candidat. Les rééchelonnement ont eu lieu à partir des années 80 — le premier étant celui du Sénégal en 1981. Les dettes contractées après cette « date butoir » ne sont pas prises en compte.
Selon les termes de l’initiative PPTE renforcée à Cologne en 1999, le candidat, pour être « éligible » à un allègement, doit satisfaire à 7 conditions qui déterminent la « soutenabilité » de sa dette :
1. le service de la dette du pays doit être supérieur à 20 % des exportations ;
2. le stock de la dette du pays doit être supérieur à 150 % des exportations ou 250 % des recettes fiscales ;
3. les exportations doivent représenter plus de 30 % du PIB ;
4. le pays doit être très pauvre, c’est-à-dire avoir un revenu inférieur à 785 dollars par tête par an ;
5. les revenus fiscaux doivent êtres supérieurs à 15 % du PIB ;
6. le pays doit avoir suivi un PAS pendant au minimum 3 ans, avec application des objectifs fixés ;
7. le pays doit procurer un document CSLP signé par la société civile.
Si les autorités de Bretton Woods agréent l’éligibilité du candidat, celui-ci se rendra à 2 rendez-vous qu’elles lui fixeront : le premier, appelé « point de décision » a pour but de notifier au pays qu’il est éligible à l’allègement s’il s’applique à continuer à observer les règles de « bonne gouvernance » édictées par le FMI ; le second, appelé « point d’achèvement », a lieu en principe 3 ans plus tard — ce délai est devenu flottant depuis Cologne — et marque le début de l’allègement si l’élève s’est montré obéissant. Depuis Cologne les bailleurs de fonds peuvent mettre en œuvre, dès la décision d’éligibilité, des mesures d’allègement de dette dites « intérimaires » qui permettent de réduire le service de la dette jusqu’au point d’achèvement.
La France détient 30 % des créances éligibles à l’allègement, soit plus de 12 Mds €. Viennent ensuite le Japon avec 26 %, les États-Unis 15 %, l’Allemagne 15 %, l’Italie 7 %, le Royaume Uni 5 % et le Canada 2 %.
Ne pas confondre vitesse et précipitation
Depuis Cologne, la France a par trois fois annoncé, à grand renfort de media, qu’elle annulait 90 voire 100 % de la dette des PPTE. Les journalistes, conscients ou non des manipulations dont ils sont l’objet, parlent souvent de dette du tiers-monde en place de dette des PPTE. Le document de référence de la plate-forme « dette & développement » indique qu’ « il ne faut pas confondre annonces d’allègement, décisions d’allègement et allègements effectifs. »
Aujourd’hui, sur 42 PPTE, 23 sont devenus éligibles. 12 pays seulement ont franchi le point de décision et 6 ont commencé à en bénéficier : la Bolivie (– 27 % du service de la dette) ; l’Ouganda (-62 %, le seul pays à avoir franchi le « point d’achèvement ») ; la Mauritanie (–31 %) ; la Tanzanie (–7 %) ; le Mozambique (–60 %) et dernièrement le Sénégal. Ces allègements représenteront environ 6 % de la dette des PPTE (soit un peu plus de 12 Mds $)… après affectation… dans 30 ans peut-être… le temps de se ré-endetter sans doute.
Dans un premier temps la France parle d’annuler 10,1 Mds € (70 Mds F). Dans un second temps, elle décide de ne plus consacrer que 45 Mds F à raison, en moyenne, de 1,5 Mds F pendant 30 ans (Ministère des Finances, août 2000). A titre de comparaison, le budget de la défense s’élève en France à 243 Mds F.
Les autres pays du G7 se font également tirer l’oreille pour « annuler » : les États-Unis, par exemple, créanciers de 3,8 Mds $ sur 22 pays éligibles à l’initiative PPTE renforcée ne prévoient d’annuler que 435 millions $ dont 360 millions destinés au fonds fiduciaire (L. Fabius 05/12/2000) et n’ont budgété que 69 millions $ en 2001.
Les statuts du FMI lui interdisent d’annuler une dette. Un fonds fiduciaire (trust funds) a alors été créé pour contourner l’obstacle. Il s’agit d’un pot commun que les créanciers abondent. La Banque mondiale y a versé 1 500 millions $, le FMI 400 millions $, l’Europe 734 millions € (dont la France 178 millions €), les États-Unis 360 millions $. Cet argent — qui n’a pas encore été déposé en totalité, loin de là — est placé sur les marchés boursiers et monétaires de la planète et le bénéfice sert à l’allègement de la dette des PPTE. Vive la spéculation sur le dos des déshérités ! Il est vrai qu’en avril 2000, les ressources totales du FMI ne s’élevaient qu’à 214,4 milliards de DTS (1 Dollar Tirage Spécial valait à l’époque 1,47 €) dont 106,2 Mds DTS en or (Ministère des Finances, août 2000). Il est vrai également que les divers revenus de la Banque mondiale ne lui rapportent que 1,5 Mds $ par an (1999) alors que ses statuts lui interdisent de faire des bénéfices.
Coût budgétaire et financier pour la France
(calculé sur la base de 10,1 Mds €, Ministère des finances, août 2000)
- La contribution multilatérale (dans le cadre du Club de Paris) : 5,4 Mds €
· Devrait être étalée sur 6 à 7 années budgétaires (jusqu’à 2005-2006) au fur et à mesure des points d’achèvement des pays bénéficiaires.
- En pratique, les créances gérées par la Banque de France, Natexis ou l’AFD (Agence Française de Développement) sont refinancées par l’intermédiaire du compte 903-17, leur annulation partielle faisant l’objet de transports en découverts du Trésor en loi de règlement et les créances portées par la Coface sont annulées.
- Si les transports en découvert ne représentent pas en tant que tel un montant en dépenses budgétaires, ils sont comptabilisés dans le déficit au sens du traité de Maastricht.
- La contribution bilatérale : 4,7 Mds € (dont 3,7 au titre des annulations des créances d’APD)
- Fait l’objet d’un refinancement par don année après année au fur et à mesure des échéances après le point d’achèvement.
- Le coût budgétaire de ces mesures sera matérialisé par l’inscription, année après année, en loi de finances, de montants correspondant aux annulations de créances.
- L’essentiel des refinancements par dons est actuellement prévu entre 2002 et 2020, et les derniers refinancements interviendront dans 40 ans.
Le refinancement par don
- Dans le cadre de « contrats de désendettement et de développement », 4 domaines principaux d’affectation sont privilégiés par la France (Laurent Fabius parle de « “sanctuariser” la santé et l’éducation dans les programmes d’ajustement structurel » ; Le Monde 27/04/01) :
- l’éducation de base et la formation professionnelle ;
- les soins de santé primaire et la lutte contre les grandes endémies ;
- les équipements et les infrastructures des collectivités locales ;
- l’aménagement du territoire et la gestion des ressources naturelles.
- Mécanisme :
- 1er temps : le pays bénéficiaire de l’annulation rembourse le service de sa dette aux créanciers français ;
- 2ème temps : les créanciers français abondent une ligne de ressources au compte du Trésor national du pays bénéficiaire dans les écritures de la Banque centrale ;
- 3ème temps : cette ligne est ensuite débitée au profit du budget du pays bénéficiaire pour le financement de programmes (sur une base trisannuelle) sur décision conjointe de l’Etat bénéficiaire et de la France.
Outre le fait que tout le monde sait que la France annule des créances qui de toutes façons sont irrécupérables et ont d’ailleurs par le jeu des intérêts été remboursées plusieurs fois, comment peut-elle, dans un premier temps, demander à un pays en quasi-faillite, étranglé, de rembourser ce qu’elle va ensuite lui « annuler » sous forme de « dons » qui bénéficient surtout à son économie ?
Comment la France peut-elle étaler cet allègement poids plume sur une trentaine d’années? Les prévisions de soutenabilité ont été calculées par le FMI sur la base d’une augmentation du prix des produits de base (coton, cacao, etc.), or les cours mondiaux ne font que baisser (CNUCED 2000) depuis des années ; les rééchelonnements post-date butoir vont bientôt arriver à échéance, ainsi de la Zambie qui malgré un allègement de sa dette devra rembourser annuellement 220 millions de dollars au lieu des 136 actuellement… (Arnaud Zacharie, Les dix limites de l’initiative PPTE).
En Afrique, Le « contrat de confiance » et la « transparence des opérations » désormais proclamés haut et fort par l’État bénéficiaire et la France passeront-ils par les « ONG portables » ? par les réseaux de la « françafrique » ? Laurent Fabius, en décembre 2000 a beau jeu de déclarer que « diaboliser la dette, en faire un exutoire en soi, ne serait pas responsable ». Comme si la politique de la France en Afrique était « responsable » au Rwanda, au Congo… partout. Lisez François-Xavier Verschave.
Nécessaire…
Le poids de la dette empêche tout développement à long terme dans les PPTE. Son annulation totale et immédiate est nécessaire mais insuffisante pour commencer à éradiquer la pauvreté. Cette annulation doit concerner l’ensemble des dettes bilatérales et multilatérales des pays pauvres, qu’ils soient sélectionnés ou non dans l’initiative PPTE (31 PPTE sont des PMA). Cette annulation doit aussi concerner l’ensemble de la dette publique des pays du tiers-monde. Quand il faut trouver des dizaines de milliards de dollars pour des plans de sauvetage on les trouve rapidement (50 Mds $ en 1995 au Mexique, 57 pour la Corée du Sud en 1997, 40 pour l’Argentine en 2001, etc.)
…mais pas suffisant
Il faut accompagner l’annulation de la dette par un certain nombre de mesures qui garantissent à la société civile mondiale l’adéquation entre développement, justice et démocratie.
- Créer des structures civiles pour surveiller les liens entre annulation de dette et investissement dans le développement : il s’agit de favoriser la transparence dans l’utilisation des fonds dégagés.
- Restituer les biens mal acquis et renforcer de manière très conséquente la lutte contre la corruption et les clientélismes nord-sud. Pourquoi ne pas instaurer un Tribunal Pénal International de la Dette, à La Haye par exemple ? Alexander Nahum Sack, dès 1923, définissait les doctrines des « dettes odieuses » et des « dettes de régime » comme des dettes ne satisfaisant pas les besoins ou les intérêts de l’État et des populations. Des études devraient être menées qui nous montreraient que bien des montants rentrent dans ces catégories et se trouvent dans les banques occidentales. Les gouvernements des pays créanciers sont-ils si impuissants ou si impliqués qu’il leur faille invoquer l’Intérêt National et la Raison d’Etat, pour servir de bouclier au capital ultra-libéral et aux corrompus des deux bords ?
- Contrôler les acteurs privés de financement : les recommandations du Forum de Stabilité Financière (FSF) et du Groupe d’action financière internationale (GAFI) sont-elles suffisamment développées pour impliquer et responsabiliser les acteurs privés lors des crises ? Au vu de la généralisation de l’adage « privatiser les bénéfices, socialiser les pertes » et de la faiblesse des actions menées contre les paradis fiscaux on peut en douter.
- Instaurer des règles de commerce international plus favorables aux pays pauvres et rendre transparents les modes de fonctionnement : contrairement à la déclaration de Christian Sautter à Seattle, le temps des négociations menées dans le secret des antichambres et des ambassades n’est pas révolu. La contribution africaine au marché mondial n’est que de 2 % actuellement contre 4 % en 1980. Plus le FMI sévit en libéralisant l’économie africaine, « plus le continent exporte en volume et moins cela lui rapporte en valeur » (Arnaud Zacharie). Sans compter les pillages et dévastations de forêts, les pollutions chimiques induites, comme au Libéria pour payer des armes, etc.
- Abandonner complètement les programmes d’ajustement structurel et réformer en profondeur le FMI et la Banque mondiale. Nous sommes de plus en plus nombreux à considérer que ces institutions sont si sclérosées qu’il serait plus simple, plus efficace et moins coûteux de les remplacer par une autorité mondiale différente et citoyenne.
- Augmenter l’aide publique au développement sans la subordonner à des opérations téléguidées pour l’avantage matériel des donateurs. « En valeur réelle par habitant, l'APD nette aux PMA a fléchi de 45 % depuis 1990 et se retrouve maintenant à son niveau du début des années 70 » (CNUCED 2000). Où en sont les promesses d’atteindre 0,7 % du PNB faites à Rio en 1992 ? La France a débloqué 29 Mds F en 2000, soit 0,32 % de son PNB dont seulement 0,65 % transitent par les ONG (20 fois moins qu’aux Pays-Bas) ( campagne « mets la pression », CCFD 2001). Seuls les pays scandinaves et la Hollande atteignent 0,7 %.
- Enfin, mettre en place une taxe de type Tobin et en utiliser une part non négligeable aux opérations de développement dans le tiers-monde.
Apprendre la dignité
Toutes les études le prouvent, la gestion de la dette est non seulement insuffisante, elle est inappropriée. Est-ce encore une bataille de chiffres ? 21 pays classés dans les moins avancés en 1971, 49 en 2001… avec ce cortège indécent de carences de toutes sortes, et ce lot incommensurable de défis au bon sens, à l’intelligence et à la démocratie. Avec les méthodes mafieuses en cours nous n’aboutissons jamais qu’à des conditions extrêmes : tous les indicateurs économiques et sociaux des pays du sud sont au rouge sang ! La société civile mondiale, au nord comme au sud, s’est mise en marche, elle a honte de l’usure à outrance qui caractérise notre époque et de ses effets meurtriers et destructeurs. Il faut envisager un développement humain au bénéfice de tous, une redistribution qui permette à l’humanité de conquérir un peu de dignité, de « relever la tête ».