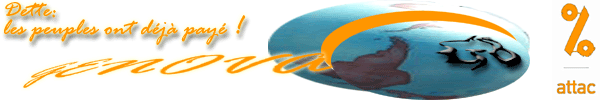

Documents:
| Plate-forme Dette |
G8 | Documents | ATTAC
FR documents |
Garantir à tous et à toutes la satisfaction des besoins humains fondamentaux et sortir du cercle vicieux de l’endettement
Par: Eric Toussaint – Arnaud Zacharie
Source: CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde)
- English
version
- Version
española
Voici une contribution du CADTM au combat pour l'abolition de la dette et pour la mise en place d'alternatives de financement du développement humain à l'échelle internationale.
C'est une contribution que le CADTM propose à la discussion dans le cadre des mobilisations qui se préparent à l'occasion du prochain sommet annuel du G7+1 qui devrait se tenir à Genova (Italie) les 20 et 21 juillet 2001, de la prochaine assemblée annuelle du FMI et de la Bm, prévue à Washington fin septembre 2001, de la réunion de l'OMC à Qatar début novembre 2001.
Ce texte n’a pas l’ambition d’être exhaustif et les mesures complémentaires sont au centre d’autres documents préparés par différents réseaux ou mouvements internationaux tels ATTAC, le CADTM, Via Campesina, Focus on the Global South, le Forum Mondial des Alternatives, la Marche Mondiale des Femmes, Jubilé Sud... ou adoptés lors de grandes rencontres internationales telles celles de Saint Denis (juin 1999), Bangkok (février 2000), Genève (juin 2000), Dakar (décembre 2000) et Porto Alegre (déclaration des mouvements sociaux lors du Forum Social Mondial de janvier 2001). Ce texte est également conçu comme une contribution à la préparation de la deuxième édition du Forum Social Mondial qui se tiendra à Porto Alegre en février 2002.
Selon la Déclaration universelle des droits de l’Homme (article 25), "Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Toute personne a droit à l'éducation, au travail et à la sécurité sociale".
Le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par la majorité des pays membres des Nations unies, stipule, quant à lui, que “ Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national adéquates afin d'améliorer constamment le bien-être de la population entière et de tous les individus sur la base de leur participation active, libre et significative dans le développement et la distribution équitable des bénéfices issus de celui-ci ”.
En interprétant les obligations de ce pacte, le comité de l'ONU des droits économiques, sociaux et culturels déclare qu' “ Un Etat membre dans lequel un nombre important d'individus est privé des aliments essentiels, de l'attention de santé primaire, de vêtements décents et de logement de base ou d’enseignement élémentaire, n'accomplit pas ses obligations en vertu de ce Pacte ”.
Pourtant, et alors que les richesses mondiales ont été multipliées par huit depuis 1960, un être humain sur deux vit aujourd'hui avec moins de deux dollars par jour, un être humain sur trois n'a pas accès à l'électricité, un sur quatre vit avec moins de un dollar quotidien, un sur cinq n'a pas accès à l'eau potable, un sur six est analphabète et un adulte sur sept et un enfant sur trois souffrent de malnutrition.
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’UNICEF estiment qu’une dépense annuelle de 80 milliards de dollars sur une période de dix ans permettrait de garantir à tout être humain l’accès à l’éducation de base, aux soins de santé de base, à une nourriture adéquate, à l’eau potable et à des infrastructures sanitaires, ainsi que, pour les femmes, l’accès aux soins de gynécologie et d’obstétrique.
Quatre-vingts milliards de dollars, c’est près de quatre fois moins que ce que le tiers-monde rembourse pour sa dette extérieure ; c’est environ un quart du budget militaire des Etats-Unis ; 9 % des dépenses militaires mondiales ; 8 % des dépenses publicitaires annuelles dans le monde ; la moitié de la fortune des 4 personnes les plus riches de la planète (1). Misère du présent, richesse du possible…
Il est impossible d’attendre de la logique du marché qu’elle satisfasse ces besoins essentiels. Les 1 300 millions de personnes qui ne disposent pas d’eau potable ou les 2 000 millions de personnes qui sont anémiques ne disposent pas d’un pouvoir d’achat suffisant.
Seules des politiques publiques pourront garantir à tous et à toutes la satisfaction des besoins humains fondamentaux. C’est pourquoi il est nécessaire que les pouvoirs publics disposent des moyens politiques et financiers pour honorer leurs devoirs envers leurs citoyennes et leurs citoyens.
Il convient également que ces derniers exercent pleinement leur droit d’agir comme les sujets centraux de la vie politique des Etats. Pour ce faire, il faut mettre en œuvre des politiques économiques et des mécanismes juridiques efficaces dans une dynamique démocratique participative. L’exemple du budget participatif pratiqué à Porto Alegre depuis le début des années 1990 devrait être étendu à l’échelle internationale et inspirer des politiques originales de démocratie radicale.
Obtenir l’application de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels implique ainsi l’entrée en action d’un puissant mouvement social et citoyen.
Il s’agit d’abord de mettre fin à l’hémorragie de richesses que constitue le remboursement de la dette. Il est ensuite nécessaire de trouver différentes sources de financement pour un développement socialement juste et écologiquement soutenable. Il convient enfin de rompre avec la logique menant au cycle de l’endettement, au détournement et au pillage massif des richesses locales, à la dépendance envers les marchés financiers et les prêts conditionnés des institutions financières internationales.
1. - Briser le cycle infernal de la dette
Les tenants de la mondialisation néolibérale nous disent que les pays en développement (ils y incluent l’Europe de l’Est) doivent rembourser leur dette extérieure s'ils veulent bénéficier de flux constants de financement.
En réalité, depuis l’éclatement de la crise de la dette en 1982, les flux sont allés des pays en développement vers les pays riches, et non l’inverse comme le prétendent sans fondement les dirigeants des institutions financières internationales. Depuis deux décennies, on assiste ainsi à un transfert net massif de richesses. Le mécanisme du remboursement de la dette s’est ajouté à d’autres préexistants (échange commercial inégal, pillage des richesses naturelles et humaines, fuite des cerveaux, rapatriements de bénéfices des transnationales vers les maisons-mères, etc.) et les a puissamment renforcés. Depuis 1982, c’est l’équivalent de plusieurs dizaines de plans Marshall (2) que les populations des pays en développement ont envoyé vers les créanciers du Nord (les élites capitalistes locales prélevant au passage leur commission).
Tenant compte qu’il faut 6,28 dollars en 2001 pour obtenir l’équivalent d’1 dollar de 1948, le coût du Plan Marshall représenterait 78,5 milliards de dollars en 2001. Si on prend en considération l’ensemble des remboursements effectués par le Tiers Monde en 1999, soit 300 milliards de dollars (Source : Banque mondiale, GDF, 2000), celui-ci a envoyé, cette année-là, à ses créanciers des pays les plus industrialisés, l’équivalent de près de 4 Plans Marshall. Dans le même ordre d’idées, depuis 1980, ce sont 43 Plans Marshall (plus de 3450 milliards de dollars) que les peuples du tiers-monde ont envoyé aux créanciers du Centre
Il est urgent de prendre le contre-pied du discours officiel : il faut annuler la dette extérieure publique du tiers-monde. A l’analyse, cette dette ne pèse pas lourd face à celle, historique, écologique et sociale, que les pays riches du Nord ont contractée à son égard. La dette du tiers-monde (pays de l’ex-bloc de l'Est non compris) s'élève en 2001 à environ 2 100 milliards de dollars (dont environ 75 % sont des dettes publiques), ce qui ne représente qu'un faible pourcentage de la dette mondiale qui atteint plus de 45 000 milliards de dollars (l’addition des dettes publique et privée aux Etats-Unis représente à elle seule 22 000 milliards de dollars).
Si la dette extérieure publique du tiers-monde était entièrement annulée, sans indemnisation des créanciers, cela représenterait une perte minime de moins de 5% dans leur portefeuille. En revanche, pour les populations enfin libérées de ce fardeau, les sommes qui pourraient être utilisées à améliorer la santé, l’éducation, à créer des emplois, etc. seraient tout à fait considérables. En effet, le remboursement de la dette publique du tiers-monde représente, bon an mal an, une dépense d’environ 200 à 250 milliards de dollars, soit 2 à 3 fois la somme nécessaire à la satisfaction des besoins humains fondamentaux tels que définis par les Nations Unies.
Certains affirment qu’une annulation de dette aboutirait à une exclusion définitive de l’accès aux capitaux internationaux. Cette affirmation ne repose pas sur une étude sérieuse de l’histoire des crises d’endettement.
Entre la fin du 18e siècle – avec l’annulation par les Etats-Unis d’Amérique de leurs dettes à l’égard de la couronne britannique – et la fin du 20e siècle – l’annulation d’une partie de la dette polonaise en 1991 –, de nombreuses mesures d’annulation de dette ont été prises sans aboutir à la fermeture du robinet du financement extérieur privé.
Au contraire, les précédents historiques en matière d'annulation de dette ont montré les effets avantageux qu'elle pouvait entraîner, notamment l’annulation de 51% de la dette de guerre allemande en 1953, qui a fortement contribué à la relance économique de l’Allemagne.
D’autres précédents historiques existent : la dette de l’Etat russe en 1918, la dette de guerre de l'Angleterre et de la France, la dette latino-américaine après le krach de 1929 à Wall Street, etc. Les pays en question ont tous connu un développement important après les mesures d’annulation.
En outre, cette menace n’a pas de sens pour la majorité des pays du tiers-monde, car ils n'ont déjà plus guère accès à ces capitaux depuis des années. Selon le PNUD, “ seuls 25 pays en développement ont accès aux marchés privés pour les obligations, les prêts des banques commerciales et les investissements de portefeuille ” (PNUD, 1999, p. 31). A noter que le PNUD inclut les Etats de l’Est européen dans les 25 pays mentionnés et que l’ensemble des pays en développement ainsi conçu est composé de plus de 180 pays.
Selon les Nations unies, en 1999, les 48 pays moins avancés (PMA), où vivent près de 600 millions d’habitants, n’ont reçu que 0,5% des Investissements directs étrangers (IDE) destinés aux pays en développement (PED). De toute manière, la part de l’ensemble des PED dans l’IDE est en déclin constant depuis trois ans – les pays riches concentrant 80 % de ces flux.
Pour la poignée de pays du tiers-monde qui ont accès aux capitaux internationaux (4 pays - Chine, Brésil, Mexique, Thaïlande - ont reçu en 1998 plus de 50% des flux d’IDE), 80 % des entrées d’investissements étrangers correspondent à des acquisitions d’entreprises déjà existantes qui passent sous le contrôle de multinationales des pays les plus industrialisés (3). Cela n’entraîne pas de création d’emplois, au contraire.
De plus, ces acquisitions impliquent une perte de contrôle national sur l’appareil productif. Sans parler du caractère fortement volatil et spéculatif des autres flux de capitaux (c’est une des leçons à retenir des crises financières des années 1990).
Une restriction de ce type de flux ne serait pas préjudiciable aux économies de ces pays. Pour remplacer ces flux improductifs, voire néfastes, nous proposons des sources alternatives de financement (voir la deuxième partie du présent texte), de manière à diminuer fortement la dépendance tant à l’égard des marchés financiers que des institutions de Bretton Woods.
Fondements juridiques de l’annulation de la dette
L'annulation de dette est légitime car elle se base sur plusieurs fondements juridiques, dont les notions de “ dette odieuse ” et de “ force majeure ”.
“ Dette odieuse ”
Les dettes des Etats contractées contre les intérêts des populations locales sont juridiquement illégitimes.
Selon Alexander Sack, théoricien de cette doctrine, “ Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir ” (Sack, 1927).
Ainsi, les dettes contractées à l’encontre des intérêts de la population du territoire endetté sont “ odieuses ” et, en cas de changement de régime, les nouvelles autorités ne sont pas tenues de les rembourser.
Cette notion provient de la fin du 19e siècle, lorsque les Etats-Unis prirent le contrôle de Cuba après une guerre contre l’Espagne, et que celle-ci leur demanda d’assumer la dette cubaine à l’égard de la couronne espagnole, conformément au droit international. La Commission de négociation des Etats-Unis refusa cette dette la qualifiant de “ poids imposé au peuple cubain sans son accord ”.
La Commission argumenta que “ la dette fut créée par le gouvernement de l’Espagne pour ses propres intérêts et par ses propres agents. Cuba n’a pas eu voix au chapitre ”. La Commission ajouta que “ les créanciers ont accepté le risque de leurs investissements ”.
Plus tard, dans les années 1930, une Cour d’arbitrage internationale, à laquelle participait le juge Taft, président de la Cour suprême des Etats-Unis, déclara que les prêts concédés par une banque britannique établie au Canada au président Tinoco du Costa Rica étaient nuls parce qu’ils n’avaient pas servi les intérêts du pays mais bien l’intérêt personnel d’un gouvernement non démocratique. Le juge Taft déclara à cette occasion que “ Le cas de la Banque royale ne dépend pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prêt pour l’usage réel du gouvernement costaricain sous le régime de Tinoco. La Banque doit prouver que l’argent fut prêté au gouvernement pour des usages légitimes. Elle ne l’a pas fait ” (Juge Taft, cité dans Adams, 1991, p. 168).
Les régimes légaux (régimes de fait selon le droit) qui succédèrent aux dictatures d’Amérique latine dans les années 1980 (Argentine, Uruguay, Brésil, etc.) auraient dû s’appuyer sur le droit international pour obtenir l’annulation de leur dette odieuse. Une part considérable des prêts à ces pays a directement été détournée par les élites locales en totale complicité avec les banques du Nord, leur offrant leur ingéniérie financière pour réaliser leurs opérations frauduleuses.
Pour ne citer que quelques autres exemples flagrants, il en est de même pour les Philippines après le renversement du dictateur Marcos en 1986, pour le Rwanda en 1994 après le génocide perpétré par le régime dictatorial (4), pour la République sud-africaine au sortir de l'apartheid, pour la République démocratique du Congo en 1997 après le renversement de Mobutu, pour l’Indonésie en 1998 après le départ de Suharto, etc.
Au lieu de fonder un refus de reconnaissance de dette sur le droit national et international, les nouveaux gouvernants préférèrent négocier des rééchelonnements et des allégements cosmétiques avec les créanciers. Ils entrèrent ainsi dans le cycle interminable de l’endettement extérieur dont les peuples font les frais.
Il faut rompre avec cette logique de dépendance. Il faut soutenir les mouvements sociaux et citoyens qui, dans les pays en développement, appellent leur gouvernement à répudier la dette extérieure publique et à en stopper le remboursement.
La “ force majeure ”
On peut aussi soutenir en droit l’annulation de la dette et la suppression de son remboursement en invoquant l’argument de la force majeure. Ce principe de droit international (5) reconnaît qu’un changement dans les conditions d'un contrat peut l'annuler. Cela signifie en substance que les contrats qui requièrent l’accomplissement d’une succession d’engagements dans le futur sont soumis à la condition que les circonstances ne changent pas (dans le droit commun, il existe différentes doctrines liées à ce principe, y compris force majeure, “ frustration ”, “ impossibilité ” et “ impraticabilité ”).
La force majeure s’applique de manière évidente à la crise de la dette des années 1980. En effet, deux facteurs exogènes provoquèrent fondamentalement la crise de la dette à partir de 1982 : la hausse dramatique des taux d’intérêt imposée au niveau international par le gouvernement des Etats-Unis à partir de fin 1979 et la baisse des prix des exportations des pays de la périphérie à partir de 1980.
Ces deux facteurs furent provoqués par les pays créanciers. Ce sont des cas de “ force majeure ” qui modifient fondamentalement la situation et qui empêchent les débiteurs de remplir leurs obligations (6).
2.- Des ressources supplémentaires pour financer le développement
Pour qu’une annulation de dette soit utile pour le développement humain, il est évidemment nécessaire que les sommes destinées jusque là au paiement de la dette soient versées dans un fonds de développement démocratiquement contrôlé par les populations locales.
Mais une fois ce premier pas franchi en matière d'annulation de dette, il est indispensable de substituer à l'économie d'endettement international actuelle un modèle de développement socialement juste et écologiquement soutenable, indépendant des fluctuations des marchés financiers et des conditionnalités des prêts du FMI et de la Banque mondiale.
Ce fonds de développement, déjà alimenté par les montants économisés grâce à l'annulation de dette, doit être financé par les diverses mesures suivantes :
2.1 Rétrocéder aux citoyennes et citoyens du tiers-monde ce qui leur a été dérobé : des richesses considérables accumulées illicitement par des gouvernants et des capitalistes locaux ont été placées en sécurité dans les pays les plus industrialisés, ceci en toute complicité avec les institutions financières privées et avec la complaisance des gouvernements du Nord (le mouvement se poursuit aujourd’hui).
Prenons l’exemple de l’Argentine sous la junte militaire (1976-1983) : la dette de ce pays a été multipliée par six. Une partie considérable des montants empruntés a été déposée par les membres du régime dans les banques des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d’autres pays industrialisés. Des entreprises financières et industrielles des pays industrialisés, ainsi que des membres du régime argentins, se sont enrichis de manière illégale. Le pouvoir judiciaire argentin a établi les faits lors d’un jugement intervenu en juillet 2000. La complicité du FMI et de la Réserve fédérale de New York a été démontrée. Sur la base de ce jugement, qui devrait faire école, il faudrait obtenir réparation pour les populations spoliées.
Pensons par exemple à ce que représenterait, pour la population argentine, la récupération des avoirs placés par la junte militaire dans les pays les plus industrialisés, pensons à ce qu’apporterait à la population congolaise, la rétrocession d’une partie importante des avoirs de feu Mobutu (représentant dix fois le budget annuel de l’Etat congolais), ou pour la population du Nigeria, la restitution de la fortune du dictateur Abacha, placée en sécurité en Suisse avec la complicité de la Citibank et du Crédit Suisse.
Une telle restitution implique l’aboutissement de procédures légales menées à bien dans les pays du tiers-monde et dans les pays les plus industrialisés. De telles enquêtes impliquent une pleine coopération internationale et la ratification de la Convention de Rome puisque, depuis mars 1991, le détournement de biens publics est considéré comme une violation des droits de l'homme.
De telles enquêtes permettraient en outre de ne pas laisser dans l'impunité les corrompus et les corrupteurs : c'est la seule manière d'espérer voir un jour la démocratie et la transparence vaincre la corruption.
Il s’agit également de soutenir les résolutions issues de la rencontre internationale tenue à Dakar en décembre 2000 (“ Des résistances aux alternatives ”) exigeant réparation pour le pillage auquel le tiers-monde est soumis depuis cinq siècles. Cela implique notamment la restitution de biens économiques et culturels dérobés aux continents asiatique, africain et sud-américain.
2.2 Taxer les transactions financières : à partir d’une proposition initiale du prix Nobel d'économie James Tobin (1972), développée plus tard par d'autres économistes, puis adaptée par le réseau international ATTAC (Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens), une telle taxation pourrait dégager des fonds importants pour le développement.
Selon des évaluations effectuées par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) en 1995, 1000 milliards de dollars par jour imposés à 1% auraient procuré 720 milliards de dollars par an. A titre d'hypothèse de travail, elle propose de couper la poire en deux : 360 milliards pour un fonds social et écologique dans les pays d’origine de la transaction, et 360 milliards pour un fonds de redistribution pour les pays du Sud (éducation, santé, etc.). Les deux fonds seraient gérés par des conseils d’administration mixtes représentant la société civile et les gouvernements.
La plate-forme internationale d'ATTAC parle, quant à elle, d'une taxe de 0,1% rapportant quelque 100 milliards de dollars annuels, pouvant être utilisés dans la lutte contre les inégalités, pour l'éducation, la santé publique, la sécurité alimentaire et le développement durable. Evidemment, il est impossible de déterminer avec exactitude le montant qu'une telle taxe dégagerait, puisqu’il qu'il dépend du taux de la taxe et de l'ampleur des flux financiers.
Cependant, il semble nécessaire, vu la globalisation des marchés qui s'est opérée depuis la proposition initiale de Tobin (et notamment le développement de produits dérivés créant des passerelles entre tous les marchés), de taxer toutes les transactions financières (actions, obligations, devises et dérivés), afin que les opérateurs ne puissent pas éviter cette taxe de solidarité en passant par d'autres marchés. La centralisation informatique de la liquidation des opérations, par le biais des clearing houses telles la SWIFT pour le marché des changes et Clearstream et Euroclear pour les transactions mobilières internationales, facilite grandement la faisabilité d'une telle taxe, puisque toutes les transactions financières internationales sont retraçables et dénouées dans ces uniques lieux.
2.3 Porter l’aide publique au développement (APD) à au moins 0, 7% du PIB : son montant actuel, en effet, ne neutralise pas l’effet négatif du remboursement de la dette.
D’abord, il faut tenir compte du fait qu’une partie importante de l’APD est constituée de prêts qu’il faut rembourser. Ensuite, en 1999, le montant total de l’APD n’a pas dépassé 50 milliards de dollars, soit environ cinq fois moins que ce que le tiers-monde a remboursé en service de sa dette extérieure publique.
En 1999, l’APD ne représentait que 0,24% du produit intérieur brut (PIB) des pays les plus industrialisés alors qu'ils se sont engagés, à maintes reprises, dans le cadre de l’ONU, à atteindre l'objectif de 0,7%. En réalité, l’APD a baissé de 33 % entre 1992 et 1998, en contradiction scandaleuse avec les promesses faites à Rio (1992) par les chefs d’Etat des pays industrialisés.
Avec une moyenne actuelle de 0,24 %, l'APD doit être multipliée par 3 pour atteindre les engagements pris. Sachant que l’APD représente un peu moins de 50 milliards de dollars, en la multipliant par trois, on devrait atteindre 150 milliards par an, qui devraient être versés entièrement sous forme de dons (en forme de réparation, et non plus, comme c'est encore trop souvent le cas, sous forme de prêts).
2.4 Instaurer un impôt exceptionnel sur le patrimoine des grosses fortunes : dans son rapport 1995, la CNUCED propose d'imposer un prélèvement unique sur le patrimoine des grosses fortunes.
Un tel impôt, prélevé partout dans le monde, permettrait de mobiliser des fonds considérables. Cet impôt exceptionnel (différent d’un impôt récurrent sur le patrimoine, tel qu’il existe dans quelques pays de la planète) pourrait être prélevé à l’échelle nationale. Un tel impôt exceptionnel de solidarité de l’ordre de 10 % sur le patrimoine du décile le plus riche dans chaque pays pourrait générer des ressources internes tout à fait considérables.
Plus généralement, il convient d’aller vers un système fiscal réellement redistributif donnant aux pouvoirs publics le moyen de se conformer à leurs obligations à l’égard de leurs citoyen(ne)s en matière de droits économiques, sociaux et culturels.
3.- Une nouvelle logique de développement
A la logique actuelle de développement, qui voit les pays du Sud adopter sous la contrainte des créanciers des programmes d'ajustement de type néolibéral, il faut substituer une logique de développement endogène et intégrée. Cette mutation passe par la mise en pratique des mesures suivantes :
3.1 Mettre fin aux plans d’ajustement structurel : les plans d'ajustement structurel (PAS), en prônant la libéralisation totale des économies du Sud, ont pour conséquence d’affaiblir les Etats en les rendant plus dépendants de fluctuations extérieures (évolution des marchés mondiaux, attaques spéculatives, etc.) et de les soumettre à des conditionnalités imposées par le tandem Banque mondiale/FMI et, derrière lui, par les gouvernements des pays créanciers regroupés dans le Club de Paris.
Les PAS, sans résoudre le problème de l'endettement (la dette du tiers-monde a quadruplé depuis la mise en œuvre des PAS, alors qu'elle a été remboursée six fois durant la même période), livrent les économies du tiers-monde aux appétits des grandes entreprises multinationales et impliquent des licenciements massifs et des coupes drastiques dans les budgets sociaux. Ils empêchent un réel développement humain.
La Commission des droits de l’homme de l’ONU (7) a adopté de multiples résolutions sur la problématique de la dette et de l’ajustement structurel. Dans une résolution adoptée en 1999, la Commission affirme que “ l’exercice des droits fondamentaux de la population des pays endettés à l’alimentation, au logement, à l’habillement, au travail, à l’éducation, aux services de santé et à un environnement sain, ne peut être subordonné à l’application de politiques d’ajustement structurel et à des réformes économiques générées par la dette ” (1999, Art. 5).
Pour sa part, le secrétaire général de l’ONU écrit que “ le rapporteur spécial de l’ONU sur l’ajustement structurel met en évidence que les programmes d’ajustement structurel, que les institutions financières internationales recommandent, influencent de manière clairement négative (tant directement qu’indirectement), la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et sont incompatibles avec la réalisation de ces droits ” (ONU, Secrétaire général, 1995, p.66, cité par Chris Jochnick, 2000, p. 136).
En outre, selon l’ONU, certaines conditions fixées par les créanciers et les bailleurs de fonds constituent une violation de la libre détermination des peuples : “ Tout pays a le droit souverain de disposer librement de ses ressources naturelles pour son développement économique et le bien-être de sa population ; toute mesure ou pression extérieure, politique ou économique, qui s’exerce contre l’exercice de ce droit, est une violation patente des principes de la libre détermination des peuples et de la non intervention énoncés dans la Charte des Nations unies. (…) Ces mesures comprennent la pression économique destinée à influencer la politique d’un autre pays ou à contrôler des secteurs essentiels de son économie nationale. L’assistance économique et technique, les prêts et l’augmentation des investissements étrangers doivent être réalisées sans mettre des conditions qui vont à l’encontre des intérêts du pays qui les reçoit ” (Secrétaire général 1995 : 165, 171, 173).
Le bilan humain des politiques d’ajustement structurel est incontestablement négatif. Ils doivent donc être supprimés.
3.2 Adopter des modèles de développement partiellement autocentrés : de tels modèles impliquent la construction de fondations économiques intérieures suffisamment solides pour pouvoir ensuite s’ouvrir aux échanges internationaux.
Ce type de développement suppose la création de zones politiquement et économiquement intégrées, l'émergence de modèles de développement endogènes, un renforcement des marchés intérieurs, la création d’une épargne locale pour les financements locaux, le développement de l'éducation et de la santé, la mise en place d'un impôt progressif et de mécanismes de redistribution des richesses, une diversification des exportations, une réforme agraire garantissant un accès universel à la terre aux paysans, une réforme urbaine garantissant un accès universel au logement, etc
A l'architecture mondiale actuelle, dont la logique impose à une périphérie d'apporter les matières premières et la main d'œuvre bon marché à un centre détenant capitaux et technologies, il faut substituer des regroupements économiques régionaux. Seul un tel développement partiellement autocentré permettrait l’émergence de relations Sud-Sud, condition sine qua non au développement économique du tiers-monde et, par extension, du monde.
Ces zones intégrées pourraient se doter d’institutions régionales ayant un pouvoir de régulation économique et sociale.
3.2 Agir sur le commerce : l’existence d’un échange inégal entre les pays les plus industrialisés et les pays du tiers-monde constitue une des causes fondamentales de l’endettement de ces derniers. En effet, l'échange inégal crée un déficit structurel de la balance des paiements : les importations croissent plus vite que les exportations, d’où l’endettement.
Il faut mettre fin à la tendance historique de la dégradation des termes de l’échange. Pour cela, il s’agit de mettre en place des mécanismes garantissant une meilleure rémunération du panier de produits exportés sur le marché mondial par les pays en développement (stabiliser le prix des matières premières, garantir les revenus d'exportation, constituer des stocks régulateurs - ce qui implique l’abandon des stocks zéro, etc.).
En l’absence de tels mécanismes concertés, il convient de soutenir les efforts des pays en développement pour constituer des cartels de pays producteurs. La réalisation de tels cartels pourrait permettre à la fois une réduction des volumes exportés et une augmentation des recettes d’exportation à réinvestir dans le développement par les pays bénéficiaires Les pays de la périphérie doivent pouvoir recourir à des mesures de protection de leurs productions locales.
En ce qui concerne l’agriculture, comme le revendique Via Campesina, il convient de reconnaître le droit de chaque pays (ou groupe de pays) à la souveraineté alimentaire et notamment à l’autosuffisance pour les produits de base. La protection à l’importation en est le corollaire, en totale opposition avec le quota minimum d'exportation agricole de 5% actuellement imposé par les règles de l'OMC à tous ses pays membres.
Les règles du commerce mondial doivent en outre être subordonnées à des critères environnementaux, sociaux et culturels stricts. La santé, l'éducation, l'eau ou la culture doivent être évacuées du champ du commerce international. Les services publics d’intérêt général sont la garantie des droits fondamentaux et doivent donc être exclus de l’Accord Général sur le Commerce et les Services (AGCS).
Il convient par ailleurs d’abolir les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce (ADPIC) qui permettent une appropriation par le Nord des richesses naturelles du Sud et qui empêchent les pays du Sud de produire librement des biens (médicaments, par exemple) visant la satisfaction des besoins de leurs populations.
4.- Une nouvelle discipline financière
Les crises financières à répétition des années 90 ont prouvé par l'absurde qu'aucun développement durable ne pouvait être atteint sans un contrôle strict des mouvements de capitaux et de l'évasion fiscale. Plusieurs mesures sont donc nécessaires afin de soumettre les marchés financiers à la satisfaction des besoins humains fondamentaux.
4.1 Re-réglementer les marchés financiers : la déréglementation des marchés financiers a entraîné un développement totalement démesuré de la spéculation financière.
Il est temps de réglementer à nouveau les marchés financiers, en commençant par assurer une "traçabilité" de toutes les opérations financières (déterminer clairement qui fait quoi et dans quel but).
4.2 Contrôler les mouvements de capitaux, afin que l’afflux de capitaux internationaux ne débouche plus inlassablement sur des reflux dévastateurs.
L’article VI des statuts du FMI prévoit de manière explicite le bien-fondé de mesures de contrôle des capitaux exercées par les autorités d’un pays. Cet article permet à un pays membre du FMI “ d’exercer un contrôle sur les mouvements internationaux de capitaux afin de les réguler ” (8).
Une mesure appropriée pourrait être l'établissement d'un dépôt temporaire et obligatoire, imposant à toute entrée de capital un dépôt conjoint d'un an d'une valeur de 30 % de la somme investie. Après un an, ce dépôt serait restitué à l’investisseur (encouragé à n’investir qu’à long terme). Le dépôt serait non rémunéré.
De nombreuses autres mesures de contrôle existent, notamment l'imposition de détenir les actions et obligations pendant au moins un an avant de les revendre, la limitation de la convertibilité de la monnaie aux transactions commerciales (excluant donc les activités financières), l'imposition d'une forte taxe en cas de fluctuation excessive (comme le propose l'économiste Bernd Spahn), etc.
4.3 Supprimer les paradis fiscaux qui ont pour effet de gonfler la bulle financière et de fragiliser les économies licites (entre 500 et 1500 milliards de dollars sont blanchis annuellement). Dans ce but, les Etats doivent identifier par le biais des clearing houses les transactions provenant des paradis fiscaux et les taxer fortement, afin d'annihiler l'avantage tiré de cette politique fiscale déloyale. Parallèlement, il est nécessaire de lever le secret bancaire pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale, le détournement de fonds publics et la corruption.
4.4 Adopter des règles assurant la protection des pays qui recourent à l’endettement extérieur : l’endettement extérieur peut se justifier si les pays concernés le décident démocratiquement. Mais il faut organiser l’utilisation de l’endettement selon des principes radicalement différents de ceux qui ont prévalu jusqu’ici.
Deux principes nouveaux doivent être respectés. Primo, celui d’une conditionnalité “ à l’envers ” : la charge de remboursement et d’intérêt de ces prêts consentis à des taux d’intérêt bas et inférieurs aux conditions du marché ne sera assurée que s’il est prouvé que cet endettement a effectivement permis une création de richesse suffisante dans les pays concernés.
Secundo, une protection forte et efficace des pays débiteurs devra être organisée en faveur des pays en développement à l’échelle internationale, de telle sorte que ces pays puissent se défendre contre toute forme d’abus et de spoliation par les banques, les investisseurs privés internationaux et les institutions financières internationales.
5.- Mesures complémentaires indispensables
L’annulation de la dette publique extérieure du tiers-monde, l’abandon des politiques d’ajustement structurel et les autres mesures proposées plus haut constituent des conditions nécessaires mais elles sont en soi insuffisantes pour garantir un authentique développement humain des peuples de la périphérie. Des mesures complémentaires sont indispensables à commencer par l’égalité homme/femme et le droit des peuples indigènes à l'auto-détermination. Ce texte n’a pas l’ambition d’être exhaustif et les mesures complémentaires sont au centre d’autres documents préparés par différents réseaux ou mouvements internationaux tels ATTAC, le CADTM, Via Campesina, Focus on the Global South, le Forum Mondial des Alternatives, la Marche Mondiale des Femmes et Jubilé Sud ou adoptés lors de grandes rencontres internationales telles celles de Saint Denis (juin 1999), Bangkok (février 2000), Genève (juin 2000), Dakar (décembre 2000) et Porto Alegre (déclaration des mouvements sociaux lors du Forum Social Mondial de janvier 2001).
Bibliographie :
ADAMS Patricia (1991), Odious debts, Londres, Toronto, 1991, Probe International, 252 p.
AITEC, ATTAC, CADTM, CETIM (2000), FMI : les peuples entrent en résistance, Paris, 2000, coédition CADTM-CETIM-Syllepse, 142p
ATTAC (1999), Attac contre la dictature des marchés, Paris, 1999, Attac, La Dispute, Syllepse, VO Editions, 158 p.
ATTAC (2000), Les Paradis fiscaux, Paris, 2000, 102p
Banque mondiale, Global Development Finance, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, Washington.
BERTHELOT Jacques (2001), “ Un autre modèle pour l’agriculture. L’urgente réforme des politiques européennes ”, in Le Monde diplomatique, avril 2001.
CHESNAIS François (1998), Tobin or not Tobin, Une taxe internationale sur le capital, Ed. L’Esprit frappeur, 87p.
CNUCED (2000a), Les Flux de capitaux et la croissance en Afrique, New York et Genève, 2000, 36 p.
CNUCED (2000b), Les pays les moins avancés. Rapport 2000. Aperçu général, New York et Genève, 2000, 54 p.
CNUCED (2000c), Rapport sur le commerce et le développement 2000, New York et Genève, 2000, Nations unies, 77 p.
CNUCED (2000a), World Investment Report 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, New York et Genève, 2000, ONU, 337 p.
CNUCED, The Least Developed Countries 2000 Report, New York -Genève, 2000, 252 p.
JOCHNICK Chris (2000), “ Nuevos Caminos legales para enfrentar la deuda ”, in Un Continente contra la deuda, Quito, 2000, pp 127 -156.
OCDE (2000), Statistiques de la dette extérieure. Principaux agrégats : 1998 – 1999, Paris, 2001, 36 p.
OECD (2000), Statistics on the Member Countries, Paris, 2000, 96 p.
ONU, Secrétaire général (1995) “ Conjunto preliminar de directrices normativas basicas sobre programas de ajuste estructural y derechos economicos, sociales y culturales ” Informe preparado en cumplimiento de la resolucion 1994/37, E/CN.4/Sub.2/1995/10.
ONU (2000), Financing for Development, A Critical Global Collaboration , brochure 2 p.
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Economica, Paris, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ; Editions De Boeck, Paris - Bruxelles, 2000.
PNUD, Rapport sur la pauvreté 2000, Nations unies, New York, 2000, 144 p.
SACK Alexander Nahum, Les Effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, Paris, 1927.
Sentence arbitrale, Recueil des arbitrages internationaux, T. II, 1928, p. 545 et ss.
TOUSSAINT Eric (1998), La Bourse ou la Vie, La finance contre les peuples, coédition CADTM-CETIM-Luc Pire-Syllepse, Bruxelles-Genève-Paris, 1999, 422p
TOUSSAINT Eric, ZACHARIE Arnaud (2000), Le Bateau ivre de la mondialisation, Escales au sein du village planétaire, coédition CADTM- Bruxelles / Syllepse , Paris, 2000, 264p.
TOUSSAINT Eric, ZACHARIE Arnaud (2001), Afrique : Abolir la dette pour libérer le développement, coédition CADTM- Bruxelles / Syllepse, Paris, 2001, 272p.
Note de bas de page : (1) Selon le magazine Forbes 2001, Bill Gates, Larry Ellison, Paul Allen et Warren Buffett étaient en 2000 à la tête d’une fortune s’élevant à 160,6 milliards de dollars.
Note de bas de page (2) Plan Marshall (1948-1951): Ce plan a été conçu par l’administration du président démocrate Harry Truman, sous le nom de European Recovery Program. Il sera ensuite connu sous le nom du secrétaire d’Etat de l’époque, Georges Marshall (qui a été chef d’état-major général entre 1939 et 1945), chargé d’en assurer la mise sur pied. Entre avril 1948 et décembre 1951, les Etats-Unis accordent, sous forme de prêts à seize pays européens, une aide de 12,5 milliards de dollars. Le Plan Marshall visait à favoriser la reconstruction de l’Europe dévastée au cours de la deuxième guerre mondiale.
Note de bas de page (3) Voir CNUCED, World Investment Report 2000. A noter que la Chine constitue un cas particulier car elle maintient d’importantes mesures de contrôle sur les mouvements de capitaux.
Note de bas de page (4) Dans le cas du Rwanda, le Comité du développement international du Parlement britannique a explicitement évoqué la notion de dette odieuse pour plaider son annulation : “ Une grande partie de la dette extérieure du Rwanda fut contractée par un régime génocidaire… Certains argumentent que ces prêts furent utilisés pour acheter des armes et que l’administration actuelle, et en dernière instance la population du Rwanda, ne devrait pas payer ces dettes “ odieuses ” Nous recommandons au gouvernement qu’il pousse tous les créanciers bilatéraux, et en particulier la France, à annuler la dette contractée par le régime antérieur ” (in Report of the British International Development Committee, mai 1998, cité par Chris Jochnich, 2000).
Note de bas de page (5) Dans sa formulation originale : Contractus qui habent tractum successivum et dependetiam de futurum, rebus sic stan, tibus intelligentur.
Note de bas de page (6) Charles Fenwick, International Law (3e éd. 1948) : de façon similaire, un des textes définitifs sur la common law, explique que “ une condition tacite, liée à tous les contrats, est que ceux-ci cessent d’être obligatoires dès qu’il se produit des changements substantiels dans l’état des faits et des conditions sur lesquels ils ont été basés ”, in Black’s Law Dictionary 1267 (6e éd. 1990). Voir également, en jurisprudence internationale, la sentence arbitrale rendue le 11 novembre 1912 dans l’affaire d’emprunt d’Etat Turquie/Russie dans laquelle il est dit , “ …l’exception de la force majeure …est opposable en droit international ” ( Sentence arbitrale, Recueil des Arbitrages internationaux, T. II, 1928, p. 545 et ss.). Par ailleurs, le Code civil d’Argentine stipule que l’obligation d’un débiteur s’éteint “ quand la prestation qui forme la matière de celle-ci devient physiquement ou légalement impossible, sans faute du débiteur ” (Arts 724 et 888).
Note de bas de page (7) Se référant aux investigations de rapporteurs spéciaux, de groupes de travail d’experts et du secrétaire général de l’ONU.
Note de bas de page (8) “ Exercise such controls as are necessary to regulate international capital movements ”.