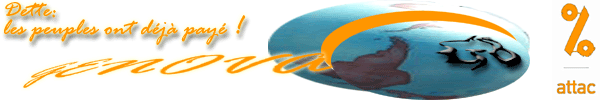

Documents:
| Plate-forme Dette |
G8 | Documents | ATTAC
FR documents |
Deux ans après le G7 de Cologne : la dette tenace des pays pauvres
Par: Arnaud
Zacharie
arnaudzac@swing.be
Le 19 juin 1999, le G7 de Cologne répondait aux exigences des mouvements sociaux et citoyens du Nord et du Sud, demandant l'annulation de la dette extérieure illégitime et insoutenable des pays pauvres : 100 milliards de dollars devaient permettre l'allégement de la dette de 41 pays jugés "pauvres et très endettés" (PPTE).
Dès l'annonce de cette initiative, de nombreuses organisations - dont le CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde) - en ont dénoncé les limites. Elles ont été rappelées lors de la Conférence panafricaine de Dakar (décembre 2000) et du Forum Social Mondial de Porto Alegre (janvier 2001). Malheureusement, deux ans après le G7 de Cologne, la pertinence de ces critiques se confirme...
Sur les 41 pays pauvres très endettés (PPTE) recensés par les institutions financières internationales, 23 pays sont actuellement éligibles pour un allégement total de 35 milliards de dollars, ce qui représente 15% de la dette des PPTE et 1,6% de la dette extérieure du Tiers Monde. Selon la Banque mondiale, le service total de la dette des pays éligibles passera de 2,5 à 2,1 milliards de dollars entre 1999 et 2005 et près d'un tiers de ces pays devront en réalité rembourser plus en 2005 qu'en 1999 (Unité PPTE de la Banque mondiale, Rapport sur l'impact financier de l'initiative PPTE, février 2001).
Mais ces chiffres modestes cachent une réalité encore bien plus insatisfaisante : l'effort des créanciers est en réalité minime et la nature de l'initiative fait que les chiffres annoncés sont des plus hypothétiques.
Des créanciers moins généreux qu'en apparence
Depuis la crise de la dette des années 80 et le G7 de Toronto de 1988, les pays riches ont à plusieurs reprises opéré des mesures d'allégement et de rééchelonnement de la dette des pays pauvres. Aussi, alors que l'initiative actuelle est présentée comme un élan de générosité novateur, elle ne fait en réalité que renforcer les mesures antérieures par nécessité, tout simplement parce que ces dites mesures ont été insuffisantes et que l'endettement des pays pauvres n'a cessé d'augmenter malgré elles - la dette des PPTE est passée selon la Banque mondiale de 141 à 214 milliards de dollars entre 1989 et 2001.
Ainsi, les pays riches n'envisagent en rien d'annuler une partie du stock de la dette des pays pauvres. L'initiative se limite à des remises d'intérêts et à des aides destinées à financer une partie du service de la dette, ceci année après année et étalé sur une période de plusieurs décennies. C'est pourquoi l'OCDE affirme que "la mise en œuvre intégrale de l'initiative ne se traduira pas par une diminution de la valeur nominale de la dette" (OCDE, Rapport 2000 sur la dette extérieure, p. 10).
L'opération vise donc clairement, comme le dénonçait le Wall Street Journal dès décembre 1999, à refinancer de vieilles créances impayables et sans valeur par de nouvelles, ce qui implique que l'effort financier à apporter par les créanciers est nettement inférieur aux réductions de dette annoncées. Par exemple, d'après le Trésor des Etats-Unis, "le coût budgétaire effectif de l'annulation des quelque 3,8 milliards de dollars dus aux Etats-Unis par les 22 pays susceptibles de bénéficier de l'initiative PPTE renforcée serait d'environ 346 millions de dollars" (CNUCED, PMA 2000, p. 153-154).
Quant au FMI et à la Banque mondiale, qui pour la première fois acceptent de participer à une telle opération d'allégement, leur engagement est plus que timide. La Banque mondiale envisage en effet d'engager au total 4,8 milliards de dollars, alors qu'elle enregistre des profits annuels de 1,5 milliard. Parallèlement, le FMI se limite à engager 1,7 milliard de dollars, fruit de la vente d'une partie de son or, alors qu'il est assis sur un magot de quelque 200 milliards. En outre, les institutions multilatérales pourront, lorsqu'elles accorderont un allégement, se rembourser par le biais d'un fonds fiduciaire alimenté par le rendement des prêts de pays membres investis sur les marchés financiers internationaux. Mais les contributions futures des pays membres restent hypothétiques, ce qui rend incertain l'allégement multilatéral annoncé.
Un objectif minimaliste et des projections hypothétiques
L'objectif de l'initiative n'est pas d'en finir avec la dette des pays pauvres, mais bien de la rendre "soutenable", c'est-à-dire d'aider les pays à s'acquitter intégralement des obligations actuelles sans devoir recourir à de nouvelles mesures de restructuration et sans que cela ne compromette trop leur croissance économique. Les institutions financières internationales n'interviennent ainsi que lorsque les mesures d'allégement opérées par les pays riches ne sont pas suffisantes pour rendre la dette d'un pays pauvre "soutenable". Le but est donc de redonner un peu d'oxygène financier à des pays au bord de la faillite, le tout en échange de l'accélération des réformes macroéconomiques de libéralisation et de privatisation en cours depuis près de deux décennies.
Mais même cet objectif minimaliste est en réalité plus qu'aléatoire. En effet, comme le note la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), "la réussite à moyen terme de l'initiative PPTE, même sous sa forme renforcée, ne tient qu'à un fil : les projections sur lesquelles on s'est fondé pour déterminer l'évolution future de la viabilité de la dette reposent sur des postulats extrêmement optimistes" (CNUCED, op. cit, p. 161).
D'abord, de nombreux pays pauvres, asphyxiés par la spirale infernale de leur endettement, n'ont pu s'acquitter de toutes leurs obligations et ont accumulé des arriérés entre 1994 et 1998. Aussi, lorsque ces pays bénéficieront d'un allégement, des créanciers "de second rang" sortiront du bois et demanderont qu'on les rembourse enfin. C'est ce qui explique que ces pays rembourseront en fait plus qu'avant les mesures d'allégement!
Ensuite, les projections ne prennent pas en compte les nouveaux emprunts qui seront inéluctablement contractés pour financer d'importants et indispensables investissements d'infrastructure physique et sociale.
Enfin, les projections de "soutenabilité" à moyen terme de la dette des pays pauvres par les experts du FMI et de la Banque mondiale se fondent sur des postulats très improbables, alors que ce sont elles qui déterminent le montant de l'allégement octroyé. Par exemple, dans le cas de l'Ouganda, du Honduras, du Nicaragua et de la Tanzanie, le Fonds et la Banque tablent pendant 20 ans sur une augmentation annuelle de 9% des recettes d'exportation et sur une croissance annuelle de 6% à 10% aussi bien pour le PIB que pour les recettes publiques, ce qui entre en contradiction avec les chiffres moroses de ces dernières années !
Ces exemples ne sont pas des exceptions. Au contraire, on retrouve cet optimisme dans pratiquement tous les cas. Il suffira donc par exemple d'une chute des cours des matières premières ou d'un tassement de l'aide publique au développement pour que la dette extérieure des pays pauvres recommence son effet boule de neige. Aussi, lorsque l'Unité PPTE de la Banque mondiale annonce que "l'économie réalisée sur le service de la dette (…) représente en moyenne 1,2% du PIB" (Rapport février 2000, p. 4) - chiffre de toute façon insuffisant pour réduire durablement la pauvreté -, il faut savoir qu'un tel bénéfice est conditionné à une conjoncture qui, malheureusement, risque de ne jamais voir le jour dans le monde réel… Et le raisonnement vaut tout autant pour les calculs du futur service de la dette en % des exportations ou des recettes publiques.
Quel impact sur l'endettement, la pauvreté et la démocratie ?
Selon les créanciers, l'initiative PPTE renforcée vise à lier davantage l'allégement de la dette à la lutte contre la pauvreté, d'une part en incitant les pays pauvres à appliquer des réformes macroéconomiques et d'autre part en les poussant à affecter les ressources libérées à des dépenses sociales et de lutte contre la pauvreté. Ces engagements doivent être recensés dans un "document stratégique de réduction de la pauvreté" rédigé par les pays pauvres en relation avec le FMI, la Banque mondiale et la "société civile".
Mais à nouveau, de sérieux doutes sont à émettre sur la réalisation de tels objectifs, comme le soulignent notamment les travaux de la CNUCED (Rapport 2000 sur les PMA, p. 155-171).
D'abord, le peu d'allégement de dette accordé ne permettra pas aux pays endettés de s'attaquer sérieusement à la pauvreté. Ainsi, "d'après les études récentes portant sur l'ensemble des pays bénéficiaires de l'initiative PPTE, l'économie résultant de la mise en œuvre de l'allégement ne représente qu'environ un dixième du total des flux de ressources nettes". Evidemment, ce ne sont pas 10% de leurs maigres ressources qui permettront aux pays pauvres de sortir de leur misère. Aussi, "les pays bénéficiaires de l'initiative n'obtiendront pas un allégement suffisant au point d'achèvement. En conséquence, leur endettement ne pourra pas retomber à un niveau viable et le financement de leurs programmes de réduction de la pauvreté sera compromis, ce qui les empêchera d'atteindre les deux objectifs essentiels de l'initiative".
Ensuite, les experts du FMI et de la Banque mondiale tablent sur une corrélation entre réduction de la pauvreté et croissance économique, mais cette idée séduisante ne va pas de soi : "Il n'est pas exclu qu'une stratégie trop axée sur la lutte contre la pauvreté soit mauvaise pour la croissance. (…) Il n'est donc pas impossible qu'en ajoutant des conditions de lutte contre la pauvreté à leurs programmes d'ajustement, le FMI et la Banque mondiale ne conduisent les pays dans une impasse, en leur imposant des objectifs inconciliables à court terme".
En outre, de nombreuses études - dont celle de Ravi Kanbur, ex-directeur du World Devlopment Report de la Banque mondiale - ont démontré que la répartition de l'aide publique au développement est déterminée par les pays riches en fonction du taux d'endettement des pays pauvres. Ainsi, plus un pays est endetté et plus il recevra d'aide afin de pouvoir rembourser sa dette. En clair, les pays riches donnent d'une main ce qu'ils reprennent de l'autre. Evidemment, cette réalité laisse supposer que lorsqu'un pays recevra un allégement, il verra son aide publique au développement diminuer d'autant, ce qui annulera l'effet bénéfique de l'allégement.
Enfin, les intentions de démocratisation affichées par le FMI et la Banque mondiale, en permettant une plus grande participation des pays pauvres et de leur "société civile" dans la définition des réformes, ne semblent que poudre aux yeux. D'une part, le modèle à définir par les pays endettés reste celui conçu par la Banque et le Fonds et ces derniers se réservent de toute façon le droit de l'approuver in fine. D'autre part, les participants des ONG du Sud au Sommet des PMA de Bruxelles en mai 2001 ont unanimement dénoncé la nouvelle mode de "société civile portable" : de nombreux ministres africains fondent leurs propres ONG accompagnant les délégations officielles pour approuver les politiques menées.
En conclusion, les effets d'annonce ont beau se multiplier autour des allégements, la dette du Tiers Monde reste, deux ans après le G7 de Cologne, malheureusement tenace. Les mouvements citoyens du monde entier ne manqueront pas de le rappeler lors de la semaine mondiale de la dette décidée à Dakar en décembre 2000 et qui se déroulera du 15 au 22 juillet à la veille du G7 de Gênes.
Arnaud Zacharie,
Chercheur au CADTM, auteur avec Eric Toussaint de "Le bateau ivre de la mondialisation" (2000) et de "Afrique : abolir la dette pour libérer le développement" (2001).