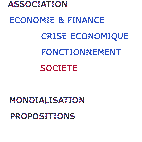|
|
|
Résumé
La concurrence des entreprises entraîne un double mouvement d'intensification du travail et de flexibilisation de la main d'œuvre destiné à augmenter la productivité des facteurs de production. Mais les progrès associés de l'instabilité et de l'insécurité des conditions de travail contribuent à creuser les inégalités de santé, d'où une moindre équité.
INTRODUCTION
La domination des logiques concurrentielles implique un mouvement permanent de réorganisation des entreprises qui, à première vue, a de nombreuses conséquences bénéfiques : le progrès des techniques, la meilleure utilisation des facteurs et, en définitive, des augmentations de l'efficience des processus de production. Mais elle est associée à une intensification du travail qui, directement, entraîne des coûts humains. Dans le même temps, elle implique le développement de l'instabilité et de l'insécurité des conditions de vie de larges parties du collectif ouvrier et employé. Les coûts associés sont-ils répartis de manière équitable ? En particulier, les importantes inégalités de santé qui découlent de la participation à la production sont-elles accrues ou atténuées par les formes modernes de la concurrence ? Cette communication a le projet d'expliciter en quoi, dans le cadre de l'entreprise, les objectifs d'efficience et d'équité peuvent être contradictoires. Pour ce faire nous analyserons le cas particulier des liaisons de l'intensification du travail avec les détériorations de l'état de santé de certaines catégories de personnel.
1. DE L'INTENSIFICATION DU TRAVAIL AUX PROGRÈS DE L'EFFICIENCE DU PROCESSUS DE PRODUCTION
Les développements actuels de la concurrence mondiale des capitaux s'exercent directement au niveau des entreprises. Les multiples pressions des marchés financiers entraînent un flux continu d'initiatives des firmes afin de réorganiser la production, d'optimiser la productivité des facteurs et de permettre, en définitive, d'augmenter le rendement des capitaux investis. Parmi les multiples moyens employé par les entreprises pour développer la productivité des facteurs, trois méritent une analyse attentive : la mise en place des modes de production dits "en flux tendu", ou "en juste à temps" ; les formes de réorganisation de la production dites de "reengineering" ; et la flexibilisation de la main d'œuvre.
1.1. Les modes de production "en flux tendu" ou "en juste à temps"
Ces modes d'organisation de la production ont été mis au point dans l'industrie automobile japonaise avant d'être repris et théorisés aux USA. Ils entraînent de considérables progrès de la productivité des facteurs de production dans la mesure où ils permettent d'éliminer les gaspillages, de limiter au minimum le niveau des stocks immobilisés en fabrication et d'accroître la pression exercée sur les salariés, ceux-ci ayant à réagir au plus vite à tout incident pour assurer la continuité du flux de produits. À la limite, si l'entreprise atteint l'idéal d'une "production synchrone", un niveau de stock minimum et une main d'œuvre réduite à l'extrême lui permettent de réaliser un flux continu de biens et services satisfaisant "juste à temps" les besoins de sa clientèle. Ainsi l'efficience du processus de production atteint son maximum. Mais dans cette organisation, "ce sont les hommes et non plus les stocks qui servent de régulateurs" (Lehndorff, 1997).
En France, de tels modes d'utilisation de la main d'œuvre ont été expérimentés puis développés dans les grandes entreprises de la "filière automobile". Cette révolution a entraîné, à travers notamment la généralisation de normes de qualité très strictes (telles Iso 9000 ou le référentiel EAQF), une formalisation croissante des méthodes de travail et un encadrement de plus en plus strict des tâches de chacun. D'où une surcharge de contrôles et de responsabilités pesant sur le collectif de travail. De plus, la mise en place des organisations en flux tendus a partout été associée à l'extension des productions à la chaîne ou en continu : un enchaînement d'opérations répétitives réalisées par des salariés peu qualifiés techniquement et interchangeables entre eux.
1.2. La développement de la sous-traitance
Le développement de la sous-traitance contribue, lui aussi, à la progression de l'efficience de l'appareil de production. Il peut aller jusqu'à la systématique "externalisation" hors de l'entreprise de toutes les activités qui, ne ressortant pas directement de sa spécialité, sont moins productives et donc moins rentables. Les relations interentreprises se transforment au fur et à mesure que la sous-traitance se complexifie. Par exemple, dans la filière automobile, sont reconnues comme "fournisseur de premier rang" les firmes qui sont responsables de la qualité des produits livrés, dont les délais sont compatibles avec les normes du "juste à temps" et qui sont capables de gérer la production d'un équipement de la conception jusqu'à la livraison. Les fournisseurs de second rang, eux, n'ont de contacts directs qu'avec les fournisseurs de premier rang qui leur appliquent un mode de contrôle équivalent basé également sur des référentiels de qualité EAQF (Gorgeu et Mahieu, 1998b).
Une telle organisation permet une adaptation souple aux fluctuations de la demande tout en réduisant la dimension des fonctions que les constructeurs principaux ont à gérer. Les nouvelles entreprises devenues équipementiers bénéficient des produits dont les constructeurs se séparent, comme les sièges et la maroquinerie des voitures par exemple. Du même coup, cette organisation reporte sur les collectifs autonomes de travail des charges auparavant assurées par les donneurs d'ordre, telles le contrôle de la qualité ou la polyvalence nécessaire pour s'adapter au perpétuels changements de gamme proposés à la clientèle. L'accroissement correspondant de la flexibilité externe est complété par une augmentation de la flexibilité interne aux entreprises.
1.3. La flexibilisation de la main d'œuvre
L'augmentation de la souplesse d'utilisation des salariés constitue un autre moyen pour accroître la productivité des firmes. Afin de limiter le plus possible les coûts de main d'œuvre, les entreprises limitent en effet "au plus juste" les effectifs de leur personnel permanent. Dès que la demande augmente, dès que survient un besoin extraordinaire ou qu'une absence "imprévue" menace d'interrompre le processus de production, elles n'embauchent pas mais font appel à des contrats à durée déterminée (CDD) ou à des sociétés d'intérim. Ainsi, les formes précaires d'emploi connaissent en France un développement impressionnant : selon les enquêtes "Emploi" successives de l'INSEE, l'intérim pèse aujourd'hui 3,2 fois plus qu'en 1982, avec 410 000 salariés, et les CDD trois fois plus avec 900 000 salariés. Au total, si l'on considère également ces formes provisoires d'emploi que sont les stages et contrats aidés (multipliés par 5,4 depuis 1982) et l'apprentissage (multiplié par 1,7), on constate que le nombre de salariés avec un statut précaire a été multiplié par 2,7 de 1982 à 1998 pour atteindre aujourd'hui deux millions d'emplois (près de 10%).
Au niveau des entreprises prises isolément, la souplesse accrue des moyens de gestion de la main d'œuvre, la concentration sur le noyau d'expérience de la firme et l'intensification de l'utilisation des moyens de productions entraînent des gains de productivité notables. Nous pouvons ainsi estimer qu'une bonne part du redressement remarquable de la rentabilité des entreprises françaises depuis 15 ans doit être associé à ces transformations. Mais au niveau macro-économique, ces gains sont moins évidents tant les contre-tendances sont nombreuses. La dégradation des conditions d'emploi a d'abord favorisé des comportements d'épargne de précaution qui étouffent la croissance de la consommation. Les personnes à statut précaire peuvent difficilement s'endetter tant il est difficile pour elles de présenter des garanties aux organismes financiers. La fragilité des perspectives d'emploi conduisent les ménages à repousser leurs projets d'investissements. D'autre part, l'externalisation des coûts induits par l'activité de l'entreprise, aussi bien pour ce qui est de l'environnement (gestion des ressources naturelles ou des déchets) que pour la couverture des dépenses de santé des salariés induites par leurs conditions d'emploi (fatigue, usure et stress), entraîne des charges qui reposent sur la collectivité. Si les gains d'efficience sont avérés au niveau microéconomique, ils sont moins évidents au niveau de la société dans son ensemble. Cette interrogation est encore renforcée quand on compare les situations des différents salariés du point de vue de la santé.
2. L'INTENSIFICATION DU TRAVAIL ET LA FLEXIBILISATION DES EMPLOIS ENTRAÎNENT UN SURCROÎT D'INÉGALITÉS DE SANTÉ
Selon Michel Gollac et Serge Volkoff, chercheurs au Centre de recherche et d'études sur l'âge et les populations au travail (CRÉAPT), "les transformations du travail et de l'emploi, telles qu'elles sont ressenties par les salariés, apparaissent comme des conséquences mineures par rapport à l'objectif de l'entreprise : survivre, gagner la guerre économique". Il n'empêche que de tels modes d'augmentation de la productivité des entreprises se payent dans une surcharge d'urgences et de contraintes que doivent supporter les différents membres des collectifs de travail. Quatre types de conséquences peuvent y être associées.
2.1. La détérioration des conditions de travail
Les enquêtes sur les conditions de travail qu'a menées la DARES (du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité), en 1984, 1987, 1991 et 1998, sur des échantillons successifs de 17 000 actifs permettent de suivre certaines des conséquences de ces transformations du processus de travail (cf. Cézard et Hamon-cholet, 1999, pour des données sur la méthodologie). Deux évolutions sont très caractéristiques :
Même si les gains d'autonomie sont notables (85% déclarent en 1998 organiser directement leur travail en fonction d'un objectif, contre 77% en 1987), l'augmentation de la proportion de salariés estimant que leur travail est répétitif est importante : de 20% en 1984, elle est passée à 29% en 1998. Ce mouvement varie très fortement selon les catégories socioprofessionnelles : s'il ne touche toujours qu'une petite minorité des cadres (4,7% en 1998, contre 2,5% en 1984, soit 2,2% de plus), il concerne maintenant la majorité des ouvriers non qualifiés (58,9% en 1998, soit 10,2% de plus qu'en 1984) et une part croissante des ouvriers qualifiés (41,0% en 1998, soit 14,2% de plus qu'en 1984) comme des employés (32,3% en 1998, soit 14,4% de plus qu'en 1984).
L'accentuation de la pénibilité du travail est notable, surtout pour les catégories ouvrières. La proportion des personnes déclarant "rester longtemps dans une position pénible" fait plus que doubler en 14 ans dans toutes les catégories socioprofessionnelles : seule une faible proportion, quoique croissante, des cadres est concernée (12,9% en 1998, contre 5,3% en 1984), alors que plus de la majorité des ouvriers travaillent aujourd'hui dans des postures pénibles (58,9% des non qualifiés en 1998, contre 24,2% en 1984 ; 55,7% des ouvriers qualifiés en 1998, pour 28,8% en 1984) et que plus du tiers des employés s'estiment aussi avoir des postures difficiles (37,4% en 1998, vis-à-vis de 12,7% en 1984).
2.2. Le développement des affections périarticulaires lié au travail répétitif
Le développement des dits TMS ("troubles musculo-squelettiques") est associé au caractère prolongé de certains gestes répétitifs. Soumis à des normes de temps, un opérateur stressé mobilise de façon intense et prolongée certaines articulations particulièrement concernées par les gestes qu'il doit exécuter : quand un ouvrier doit répéter par exemple vingt fois par minute et 1200 fois par heure la même torsion sèche du poignet, ses articulations finissent par marquer le coup. Les douleurs traduisent une inflammation des tendons et des nerfs actionnant les articulations. Elles surviennent dans les zones les plus exposées : tendinites des coudes, des épaules ou des poignets. La pathologie la plus répandue - le syndrome du canal carpien - est provoquée par la compression du nerf médian du poignet. Les premiers signes se manifestent par des engourdissements nocturnes et douloureux des doigts avec, à terme, une difficulté pour attraper les objets. C'est l'une des raisons pour lesquelles le lien n'est pas automatiquement établi avec l'activité professionnelle (cf. Héran-Leroy et Sandret, 1997).
Pour donner un exemple concret, dans les abattoirs de viande de porc, les opérateurs ne peuvent se permettre de prendre du retard car ils disposent de 15 à 20 secondes, face à une chaîne circulaire tournant sans arrêt, pour scier des pièces pesant entre 10 et 15 kilos. Le même geste de découpage avec une scie de 8 kilos est effectué environ deux mille fois par jour. "Les salariés veulent tenir le coup et continuent à travailler au-delà de l'apparition des premières douleurs par peur de perdre leur poste. C'est une erreur qu'ils payent plus cher ensuite en termes de santé, car, lorsque la maladie s'est installée, elle est plus difficile à soigner, les récidives étant fréquentes. Pour beaucoup, cela se traduit par l'inaptitude au travail, première amorce du cycle de la précarité", précise un membre du Comité d'Hygiène et Sécurité (cf. Ovadia, 1998).
Les TMS ont été à l'origine de près de 7 000 cas de maladie professionnelle reconnue en 1996, alors qu'ils n'étaient en cause que dans 3 165 cas en 1993 et dans 1 040 en 1990. Si tous les secteurs de l'industrie sont concernés à des degrés divers, les salariés qui en sont victimes travaillent en majorité dans les industries agro-alimentaires, l'automobile, la confection. Dans l'abattage des viandes, par exemple, selon le service prévention de la Mutualité sociale agricole, le nombre de salariés victimes de troubles musculo-squelettiques a été multiplié par six en cinq ans. Le secteur tertiaire commence à son tour à être touché par cette pathologie professionnelle, même si les risques sont moins visibles que dans le secteur industriel. Aux États-Unis, l'épidémie du syndrome du canal carpien est aujourd'hui largement répandue dans l'informatique, alors que les cas sont encore faibles dans les banques et les assurances. François Cail, chercheur à l'INRS, insiste sur les dommages articulaires engendrés par des contraintes de posture : positionnement trop élevé ou trop bas du clavier ou de l'écran, éloignement de la souris par rapport aux outils d'ensemble, espaces trop larges pour les manipulations amplifiant les gestes. Tous ces facteurs anodins en apparence deviennent pathogènes lorsqu'ils s'inscrivent dans la durée, la répétitivité et les impératifs de rendement, multipliés dans nombre d'entreprises par la pénurie d'effectifs. Cette évolution, liée à la dégradation des conditions de travail, pose un véritable problème de santé publique : selon le ministère du Travail, près de 3,5 millions de salariés seraient exposés aux troubles musculo-squelettiques, soit près du quart de la population active du secteur privé (cf. ANACT, 1998).
2.3. Les conséquences de la précarisation du travail sur la santé des salariés
La flexibilité accrue de la main d'œuvre se traduit dans un surcroît d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Selon les dernières statistiques professionnelles, les travailleurs temporaires connaissaient en France et en 1996 un taux d'accidents du travail 2,2 fois plus élevé que la moyenne de tous les salariés, et un taux d'accidents mortels au travail 2,1 fois plus élevé (CNAMTS 1999). Les missions d'intérim sont en effet souvent décidées au dernier moment et au plus vite, avec des personnels hâtivement sélectionnées, pour effectuer des travaux fréquemment complexes et dangereux, ce qui est difficilement compatible avec une formation minimum, voire avec le simple rappel des consignes de sécurité, précautions que l'on prend classiquement pour les nouveaux embauchés. Si bien que selon Dominique Huez, médecin du travail, "la généralisation de la précarisation du travail accule de plus en plus de personnes à devoir choisir entre le droit à l'emploi et le droit à la santé" (Huez, 1999). Que peut faire en effet un intérimaire à qui est proposé au téléphone, dans l'urgence, une mission dans une entreprise et un lieu qu'il ne connaît pas ? Que peut-il faire ensuite quand il arrive dans un chantier qu'il ne connaît pas, dans lequel les consignes de sécurité ne sont pas indiquées, les équipements de protection non disponibles et les tâches de travail toutes plus urgentes les unes que les autres ? Ainsi, quatre intérimaires et deux salariés d'entreprises sous-traitantes figuraient parmi les dix victimes de l'explosion, en juillet 1993, d'une colonne de raffinage de zinc de l'entreprise Metaleurop : personne ne les avait avertis que la zone était dangereuse.
Aujourd'hui, 24% des missions d'intérim ne durent qu'une journée et 64% moins d'une semaine (Jourdain et Tanay, 2000). La durée des missions d'intérim étant donc souvent très limitée, il est impossible ou presque de mobiliser sur le sort des intérimaires les interlocuteurs traditionnels de la prévention en entreprise : comités d'hygiène et de sécurité, médecins du travail, syndicats. Selon Odile Héran-Le Roy, de la DARES, "du fait de leur méconnaissance des postes de travail, les intérimaires sont en permanence sollicités dans les limites de leurs possibilités physiques et mentales". Quand ils restent plus longtemps dans l'entreprise, "ils font toujours les boulots les plus embêtants, ceux que les gars en fixe n'aiment pas faire", déclarait un ajusteur monteur venant d'achever une mission d'intérim de trois ans (en fait reconduite de semestre en semestre) chez Thomson. Une enquête, réalisée en 1994 par le ministère du Travail, le confirme : 40 % des ouvriers de l'intérim, contre 24 % des ouvriers en contrat à durée indéterminée, réalisent des gestes répétitifs à cadence élevée plus de vingt heures par semaine ; 70 % (contre 60 %) sont debout plus de vingt heures par semaine, tandis que 50 % (contre 20 %) sont soumis à la rigidité des horaires alternés (cf. Devillechabrolle, 1998).
Enfin, dans l'industrie et dans de nombreuses entreprises du tertiaire, l'intérim, les contrats à durée déterminée et les stages aidés sont devenus les voies pratiquement exclusives de l'embauche des personnels d'exécution. Cette fonction de sélection que n'ignorent pas les jeunes recrutés augmente encore la tension qui pèse sur eux. Les travailleurs temporaires sont alors enclins à accepter sans broncher leurs conditions de travail dégradées, du fait de leur double dépendance économique vis-à-vis de l'agence d'intérim et de l'employeur d'accueil, et parce qu'ils peuvent espérer une intégration définitive. De plus, ils tenteront de faire leur possible pour satisfaire les exigences de qualité et de délai de livraison qui correspondent aux organisations en flux tendus. Toutes choses qui ne peuvent que contribuer à développer leur stress.
2.4. Le développement du stress et ses conséquences sur la santé
Dans l'industrie automobile, la réalité du système de flux tendu ne réalise que rarement l'objectif de fluidité de la production. Il s'agit, bien plus souvent, "d'un fonctionnement discontinu provoqué par les pannes" (Rot, 1998). La gestion de la production devient alors la gestion d'une série d'urgences. La dimension des niveaux de stress supportés par les différents acteurs tout au long d'un épisode de production s'accroît ainsi à la fois avec l'interdépendance des diverses unités de fabrication, avec la complexité de l'organisation qu'elle mobilise et avec la multiplicité des aléas qui peuvent en mettre en cause le déroulement. Les enquêtes de la DRES sur les conditions de travail témoignent de l'importance des facteurs de stress subis par les diverses catégories de personnel à l'occasion de leur travail, ce qui a des conséquences non négligeables sur leur état de santé.
2.4.1. Les facteurs de stress selon les diverses catégories socioprofessionnelles
Plusieurs évolutions récentes mises en évidence par les enquêtes de la DRES sur les conditions de travail montrent que les réorganisations de la production dans les entreprises en France ont considérablement accru les facteurs de stress des salariés dans les quinze dernières années. Si nous distinguons les contraintes selon les catégories socioprofessionnelles, nous constatons de plus que les catégories les plus défavorisées subissent davantage, dans l'absolu, les transformations de l'organisation du travail.
Premier facteur de stress : l'imposition d'un rythme de travail et de délais. Certes, les ouvriers et les employés sont moins nombreux à déclarer avoir à "appliquer strictement les consignes" (seulement 54,7% pour les ouvriers non qualifiés et 49% pour les employés en 1998, soit respectivement 12,5% et 6,5% de moins qu'en 1991, ce qui témoigne des progrès de leur autonomie). Mais la proportion de salariés estimant que "leur rythme de travail est imposé par des normes et délais" est de plus en plus importante. Les cadres sont de plus en plus touchés, bien qu'à un niveau encore minoritaire (32,9% en 1998, soit 24,7% de plus qu'en 1984), et aussi les employés (31,9% en 1998, soit 20,2% de plus qu'en 1984) ; mais ce sont les ouvriers qui connaissent les progressions les plus fortes : d'abord les qualifiés (65,9% en 1998, soit 35,3% de plus qu'en 1984) et les non qualifiés (60,4% en 1998, soit 28,2% de plus qu'en 1984).
Deuxième facteur de stress : la peur de sanctions. Cet accroissement concerne davantage les catégories ouvrières. Plus de la moitié des salariés estime "qu'une erreur de leur part peut ou pourrait entraîner des sanctions à leur égard (risque pour leur emploi, diminution de leur rémunération)" ; de plus, cette proportion augmente fortement en sept ans pour toutes les catégories socioprofessionnelles : 9,3% de plus de cadres sont concernés en 1998 qu'en 1991 (soit 58%), alors que les ouvriers qualifiés et non qualifiés sont respectivement 16,7% et 14,4% de plus à craindre les sanctions en 1998 que sept ans plus tôt et les employés 14,1% (pour des totaux respectifs de 64,6%, 54,8% et 57,4% en 1998).
Le poids croissant de ces contraintes de temps et de cette crainte des sanctions se conjugue avec d'autres éléments de tensions et d'anxiété moins quantifiables et contribue au développement du sentiment de stress des salariés aujourd'hui. L'inégale distribution de ces tensions selon les catégories sociales est un des éléments qui aide à comprendre que les conséquences stressantes du travail augmentent davantage dans les catégories les plus défavorisées que parmi les plus aisées, contrairement à certaines idées reçues sur le surmenage des cadres et des patrons. Ces évolutions aident aussi à interpréter les progrès différents selon les catégories sociales des maladies liées au stress.
2.4.2. Une estimation de l'augmentation du stress par catégorie socioprofessionnelle
Vivre en permanence dans l'urgence ou dans l'angoisse des aléas se traduit par une surcharge psychique qui se manifeste dans des surcroîts de nervosité, dans des angoisses apparemment "sans cause" ou dans une irritabilité plus importante. La dernière enquête décennale de l'INSEE sur la Santé, "représentative" de la situation en France en 1992, permet d'évaluer plusieurs indicateurs des tensions psychiques vécues par les personnes interrogées. Ainsi, 49% des adultes interrogés ont répondu que "habituellement", "ils se sentaient nerveux et tendu" ; 40% qu'ils "se faisaient du souci pour des choses qui ne sont pas graves" ; et 30% qu'ils "se mettaient en colère pour des choses sans importance". La répartition de ces réponses selon les caractéristiques des situations de travail est riche d'enseignements.
Si nous nous limitons aux 3875 personnes ayant un emploi au moment du passage du questionnaire, nous constatons d'abord que les cadres sont les moins concernés par ces tensions psychiques (43% se sentent nerveux, 27% ayant du souci, et 25% coléreux), alors que les employés le sont bien plus (respectivement 54%, 50% et 32%) comme les ouvriers (respectivement 50%, 39% et 33%). Mais il est plus difficile d'évaluer l'influence des statuts précaires sur les tensions psychiques du fait de leur association avec les âges plus jeunes.
Pour isoler le rôle dans le développement du stress des facteurs liés à la jeunesse de l'emploi que sont l'intérim ou les contrats précaires, il nous faut avoir recours à des modèles de régression multidimensionnelle dit "logit". Si nous considérons alors comme constants l'influence des variables d'âge, de sexe, de niveau de diplôme et de statut familial, nous constatons que le fait d'être salarié avec un contrat à durée déterminée est associé avec des augmentations statistiquement significatives du risque de se sentir coléreux (pour un seuil d'erreur inférieur à 5%) : le risque relatif correspondant s'accroît dans un rapport 2,3 pour les ouvriers et 4,2 pour les cadres.
2.4.3. Les surcroîts de maladies associés aux développements du stress
Plus les indicateurs de stress sont élevés, plus la probabilité de connaître des maladies cardio-vasculaires est importante (cf. Johnson, 1988), plus les manifestations des affections périarticulaires associées à des gestes répétitifs sont fréquentes (cf. Héran-Leroy et Sandret, 1997), et plus grande est la probabilité de fumer, ce qui est un facteur de risque pour de nombreuses autres pathologies (cf. Otten et alii, 1999). La combinaison des divers facteurs de surcharge psychologique avec la plus grande vulnérabilité des travailleurs précaires (manque de temps pour se soigner, moindre protection sociale, etc.) contribue à expliquer que les couches fragilisées par les transformations de l'organisation du travail se retrouvent dans des états de santé bien plus défavorables.
Plus précisément, l'indicateur synthétique de morbidité, dit de "risque vital", évalué par les médecins du CREDES pour les individus interrogés dans l'enquête "Santé 1991" sur la base de leur dossier médical permet de quantifier les risques de mort prématurée associés aux niveaux élevés de tension psychique. Sur l'échantillon représentatif des personnes vivant en France en 1991, cet indicateur varie de 0, pour les 18% de personnes qui ont un risque de décès infime, à 5 pour les 0,3% qui ont un risque de 50% de ne pas rester une année en vie. Pour toutes les tranches d'âge, nous constatons que cet indicateur augmente nettement quand la personne fait état d'un des indicateurs de tensions psychiques : de 18% en moyenne quand elle s'estime "habituellement nerveuse", de 11% seulement quand elle déclare "avoir des soucis", et de 13% quand elle pense "se mettre en colère pour des problèmes sans importance".
Ainsi des conditions de travail plus difficiles à vivre conduisent, à travers de multiples voies, à des mises en cause parfois importantes de la santé des personnes. La recherche unilatérale de gains d'efficience dans la production aboutit à une détérioration de l'équité d'ensemble de ses résultats. Cette conclusion est d'autant plus préoccupante qu'elle s'applique à des situations marquées par l'inégalité des ressources et des vulnérabilités. Mais le libre jeu de la concurrence n'incite-t-il pas à externaliser les coûts des entreprises ? À quelles conditions peut-il permettre de prendre en considération les contraintes qui en découlent sur les personnes ou sur l'environnement ?
CONCLUSION
Nous pouvons nous interroger en fin de compte sur le bilan des récents "progrès" de l'efficience des moyens de production que nous avons associés aux multiples réorganisations du processus de production. Si nous considérons les entreprises isolément, nous pouvons nous dire que la souplesse accrue de l'utilisation des moyens de production entraîne des gains de productivité notables. Mais au niveau macro-économique, ces gains sont plus douteux tant les contre-tendances sont nombreuses. Tant que les responsabilités sont dispersées entre les différents donneurs d'ordre, sous-traitants du premier ou deuxième niveau et agences d'intérim, les incitations à se soucier de la santé des travailleurs sont limitées. Tant que peuvent être externalisées la quasi totalité des conséquences du surcroît de stress induit par les conditions de travail et une large part des coûts de réparation et d'indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, les entreprise ne sont guère poussées à prendre en considération dans leurs choix les coûts humains induits par leur organisation du travail.
Deux voies complémentaires apparaissent donc pour limiter cette contradiction entre les objectifs d'efficience et d'équité. D'abord, puisque ce sont les cadres d'entreprises ou les dirigeants publics qui déterminent les choix visant à améliorer l'efficience de l'organisation du travail, il faut les amener à prendre en compte les conséquences de leurs décisions en matière de situations des salariés. Au delà de l'effort d'éducation toujours utile pour les rendre plus conscient de l'importance de la dimension humaine du travail, il est nécessaire d'encadrer leurs choix par un ensemble de règles et de normes de bonne organisation, lesquelles devraient être associées avec l'augmentation du pouvoir des institutions qui ont à les surveiller. Si nous voulons éviter un amoncellement de réglementations, il serait alors utile de promouvoir un ensemble de critères d'évaluation et d'outils statistiques de mesure qui permettraient à chaque entreprise d'établir elle-même des bilans du caractère plus ou moins pathogène de son organisation du travail. La mise au point et la promotion de tels indicateurs permettraient à la fois la prise en compte plus complète des conséquences des modifications de l'organisation du travail et leur surveillance plus aisée par des instances extérieures.
D'autre part, l'objectif d'amélioration de l'équité correspond davantage aux points de vue des salariés et de leurs représentants syndicaux ou politiques. C'est donc de ce coté que réside l'autre perspective d'action complémentaire de la précédente. Si, par exemple, les pouvoirs des Comités Hygiène et Sécurité sont développés et si leurs moyens d'évaluation sont améliorés par la disposition d'outils statistiques adaptés, leurs capacités à interpeller les directions d'entreprise seront accrues. La mise en place d'un tel dispositif dynamique d'observation et de surveillance des conséquences de l'intensification du travail pourrait ainsi modifier l'équilibre interne aux entreprises et aboutir à une meilleure prise en compte des intérêts des diverses parties concernées par la production. C'est souligner par là les responsabilités des chercheurs qui contribuent à mettre au point des outils de mesure et d'évaluation des diverses conséquences de l'organisation du travail.
BIBLIOGRAPHIE
- ANACT (1998), TMS et évolution des conditions de travail – Les actes du séminaire 1998, coordonné par Bourgeois F, éditions de l'ANACT, Lyon.
- Cézard M., Hamon-Cholet S. (1999), "Efforts et risques au travail en 1998", Premières Synthèses, 99.04 - 16.1, MES-DARES.
- CNAMTS (1999), Statistiques financières et technologiques des accidents du travail, Années 1994-1995-1996, Paris.
- Devillechabrolle V (1998), "L'intérim est mauvais pour la santé", Alternatives économiques, 158, Avril.
- Gorgeu A, Mahieu R (1998a), "Filière automobile : intérim et flexibilité", 4 pages du CEE, Centre d'études de l'emploi, Noisy le Grand.
- Gorgeu A, Mahieu R (1998b), "Restructuration productives et évolutions des organisations", in TMS et évolution des conditions de travail – Les actes du séminaire 1998, coordonné par Bourgeois F, éditions de l'ANACT, Lyon.
- Johnson J V, Hall E M (1988), "Job strain, work place social support, and cardiovascular disease", American Journal of Public Health, 78, pp. 1336-42.
- Héran-Leroy O, Sandret N (1997), "les contraintes articulaires pendant le travail", Premières synthèses, n°97.06-24.4, MES-DARES, Paris.
- Jourdain C, Tanay A (2000), "Le travail temporaire au premier semestre 1999", Premières informations, n°2000.02 - 06.1, MES-DARES, Paris.
- Lehndorff (1997), "La flexibilité chez les équipementiers automobiles en Europe", Travail et Emploi, 172, juillet.
- Otten F, Bosma H, Swinkels H (1999), "Job stress and smoking in the Dutch labour force", European Journal of Public Health, 9, 1, pp. 58-61.
- Ovadia C (1998), "Quand le travail casse le corps", Alternatives économiques, 161, Juillet.
- Rot G (1998), "Urgence et flux tendu dans l'industrie automobile", Sciences de la société, n°44, pp. 99-111.