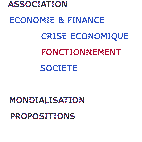|
|
|
Penser autrement le commerce international. Susan George m'avait proposé de réfléchir à un "au-delà de l'OMC". Pour penser le commerce international autrement, il faut d'abord voir comment on le pense aujourd'hui - et vous permettrez de me contenter du rôle modeste de l'économiste en la matière.
J'avoue que dans le titre de cette session, un mot m'intrigue: celui de fonction. Quelle est la fonction du commerce international? Je m'effrocerai de répondre d'abord à cette question. Ceci nous permettra d'avancer sur la compréhension de l'idéologie dominante concernant le commerce international qui, depuis Ricardo et Montesquieu, considère que le commerce international est une fort bonne chose pour les nations. Ensuite on verra comment "penser le commerce international autrement".
La fonction du commerce international
La fonction du commerce est de faire circuler les biens et les services et de participer à la division du travail. Quiconque a lu des statistiques de commerce international n'a pu qu'être frappé par cette tendance inexorable que le commerce international croît plus vite que la production mondiale. On peut donc penser que le commerce international tire la production mondiale, ce qui n'est pas tout à fait exact, et même le plus souvent faux. Vous savez que les économistes aiment les "robinsonnades"...
1er Apologue: Apologue de l'explosion du commerce international sans augmentation de la production"
Supposons que les français et les allemands ne produisent que des voitures. Si toutes les voitures françaises étaient consommées par des français, et si toutes les voitures allemandes étaient consommées par les allemands, le commerce franco-allemand serait nul. Maintenant, si les français produisent le même nombre de voitures et les allemands aussi, et si les français achètent 30% de voitures allemandes et réciproquement, le commerce international entre les deux pays explose, il représente 30% du PIB de chaque pays, bien que les productions, les PIB, n'aient pas changé.
Que faut-il pour que le commerce ait une incidence sur les PIB ?
Ça les économistes le savent depuis Ricardo, il faut qu'il provoque une spécialisation des économies. Si les français se spécialisent en voitures bas de gamme et les allemands en voiture haut de gamme, et si les français ont un avantage comparatif (main d'oeuvre, technique et ressources) dans le bas de gamme, une meilleure affectation des facteurs de production dans chaque pays provoquera un accroissement du nombre de voitures bas de gamme en France, de voitures haut de gamme en Allemagne, et globalement du nombre de voitures.
Il se trouve que l'exemple est très mauvais, car il n'y a pas vraiment de spécificité allemande ou française en matière de travail ou de ressources. Mais il veut dire que le commerce international, s'il implique la spécialisation, peut conduire à l'accroissement des productions.
On peut donc proposer l'équation : commerce international accru, plus division du travail accru, impliquent plus de croissance.
Cette phrase, comme toutes les phrases économiques en général, contient une multitude de présupposés.
1- D'abord qu'est-ce que la croissance ?
Une bibliothèque entière ne suffirait pas à répondre et ce n'est pas à des militants d'ATTAC que je dirai qu'une heure dans un embouteillage, parce que je dépense de l'essence, et parce que je prépare un cancer des poumons qui sera soigné par des chimiothérapies coûteuses est extrêmement favorable à la croissance. (Dans un article publié dans Le Monde daté du vendredi, Laurent Fabius dit qu'entre le PIB et le bonheur national net, il a choisi: c'est le PIB. Parce que le PIB réduit le chômage. "Ça crée des emplois" est la nouvelle raison économique d'Etat qui justifie tout, jusqu'à transformer Notre-Dame de Paris en bureaux pour TotalElfFina. A ce titre je rappellerais que le pays qui ne connaissait pas un seul chômeur était la Russie de Staline.) Les indicateurs, et particulièrement le PIB, ne valorisent que les activités marchandes. Tout ce qui est gratuit n'a aucun intérêt pour l'économie. La cargaison de l'Erika a une valeur. Le temps passé pour nettoyer les plages n'en a aucune.
2- Ensuite, est-ce que la division du travail et la spécialisation est toujours une bonne chose ?
Et là, je propose un 2ième apologue: Le Pérou dévouvre le commerce.
Voici un pays pauvre, largement autosuffisant. Le Pérou des années 50. Il y a des paysans qui autoconsomment leur production largement diversifiée. Des multinationales bénévolentes, se proposent d'humaniser, de nourrir et de développer ces sous-développés en leur proposant du lait concentré suisse, du maïs américain et des pommes de terre françaises. Toute la dépense de consommation qui n'était pas, auparavant, comptabilisée va être aussitôt comptabilisée. Le Pérou va devenir un pays infiniment plus riche comptablement, qu'il ne l'était auparavant. En même temps le commerce international s'est accru. Certes, la population des montagnes est descendue habiter les bidonvilles de Lima. Certes, le niveau de calories par habitant n'a pas changé. Certes, la consommation est beaucoup moins diversifiée. Mais, pour les statistiques internationales, le Pérou est un pays beaucoup plus riche qui désormais consomme la production agricole des pays du Nord.
Cet apologue montre un effet particulièrement pervers de l'échange: l'échange a bidonvillisé un pays, dont le revenu réel n'a pas bougé, mais dont le revenu apparent a considérablement augmenté.
Alors? Dans quel cas faut-il favoriser le commerce international ou non ?
3ième apoloque: L'apologue du Tour de France.
Je rends hommage à l'économiste qui me l'a conté la première fois, Bruno Ventelou (OFCE). C'est un apologue particulièrement génial. Je pense que la plupart des problèmes économiques peuvent être modélisés par l'apologue du Tour de France. Il montre deux choses. D'abord que le libéralisme, la concurrence sauvage, sans règles, donne toujours le mauvais équilibre. Ensuite, que le commerce international n'est pas toujours bon.
Voici donc nos coureurs prêts à partir pour le Tour de France. Que faire ? Se doper ou non ? S'il n'y a pas de règles, et si l'on fait l'hypothèse de "selfishness" des individus, dès qu'il y en a un qui se dope, tout le monde se dope. Si je pense que les gens sont cupides et vindicatifs comme moi, je suis idiot de ne pas me doper. De sorte que la hiérarchie est respectée, le meilleur gagne, exactement comme si personne ne s'était dopé. Sauf que la mort est au rendez-vous des coureurs. C'est le mauvais équilibre. Si personne ne s'était dopé, soit du fait d'une règle morale forte ou d'une police forte, le même individu aurait gagné. La concurrence, sans institutions, donne le mauvais équilibre. (Nota bene: remplacez dopage par corruption, et vous aurez un beau modèle de la société politique).
Application au commerce international. L'EPO s'appelle dans le commerce international "travail des enfants, absence de législation sociale, dumping social, subventions, dévaluations compétitives, etc."
Quelle est l'EPO préconisé par les docteurs du FMI ? Réductions des dépenses publiques, réductions des protections, affaiblissement des barrières douanières, lutte contre le secteur public, compression des salaires pour des raisons de compétitivité, soumission à des taux d'intérêts usuraires pour durcir la monnaie, etc.
Imaginons, au lieu de deux coureurs qui se dopent, deux pays qui participent à l'échange international. Disons qu'un pays est fort en "machines et travail qualifié" et l'autre "en matières premières et travail". On peut imaginer une relation positive, coopérative: plus tu me vends de machines, plus j'investis en travail pour piloter tes machines, plus la qualification de mon travail s'accroit, notamment grâce à l'éducation que j'acquiers chez toi (j'apprends à conduire tes machines), plus tu perfectionnes tes machines, etc.. Et puis on peut imaginer une relation concurrentielle: si je te vends des tronçonneuses, c'est pour profiter du fait que tu coupes tes arbres avec ton travail non qualifié et que tu me les vendes à un prix dérisoire. Equilibre haut, équilibre bas, encore une fois. L'équilibre coopératif du commerce international est un équilibre haut, l'équilibre concurentielle du commerce international est un équilibre bas.
Prenons l'équilibre France - Etats-Unis en matière agricole: on peut imaginer un équilibre haut qui serait coopératif, et un équilibre bas quiest concurentiel: chacun abreuve ses paysans de subventions, lesquels empoisonnent l'eau et fabriquent de la vache folle.
Revenons maintenant à un autre apologue, bien connu celui là. 4ième apologue: L'apologue de Ricardo
Chaque pays est plus ou moins favorisé par la "nature". Le Portugal est favorisé pour la production du vin, l'Angleterre pour la production du drap. Il coûte moins cher à l'Angleterre de produire du drap que du vin. On élimine les productions dans chaque pays pour lequel le pays souffre d'un désavantage comparatif. Ceci est plein de bon sens: il serait maladroit de s'obstiner à produire des ananas en Islande et de fabriquer du matériel de ski alpin en Côte d'Ivoire. (tout le libéralisme est frappé au coin du bon sens, de la bêtise la plus crasse)
Mais le problème, c'est que la nature aujourd'hui, ne représente plus rien ou presque de l'activité humaine. Eu égard au contenu technologique des produits échangés entre pays du Nord, on peut affirmer que la plupart des avantages comparatifs ne relèvent pas du cadre naturel. La Californie est bonne pour la production informatique, pas parce que les vagues du Pacifique sont magnifiques, ou parce que le désert proche fait travailler les neurones, mais parce qu'elle concentre une forte proportion d'informaticiens. La France est bonne pour les avions parce qu'elle a de bons ingénieurs et non parce que le ciel est plus bleu qu'ailleurs.
Conlusion: aujourd'hui, les avantages comparatifs doivent être considérés comme construits, et nons comme des données.
Et c'est là qu'intervient toute la perversité d'un libre-échangisme systématique: la concurrence peut, à court terme, sanctionner des inefficacités relatives; elle est funeste lorsqu'elle empêche la construction d'un avantage comparatif pertinent. Exemple: la production de voitures en Corée.
Ce n'est évidemment pas le commerce mondial qui a permis à la Corée de vendre des voitures, c'est l'inverse. Les premières voitures coréennes n'étaient absolument pas compétitives. Sans une politique commerciale protectionniste, la Corée n'aurait jamais vendu de voitures. Ce qu'on n'imaginait pas en Corée en 1970, c'est que la construction d'un secteur automobile aurait des effets d'entrainement sur la qualification des individus et sur des secteurs connexes comme l'informatique, aussi impressionants. Ce que disait le marché en 1970 c'est: il ne faut pas construire de voitures, point final. Le marché est bête et aveugle.
Et là, vous allez m'objecter quelque chose. Vous allez me dire: "oui, mais regardez la concurrence entre la France et l'Allemagne s'est beaucoup accrue, et pourtant les deux pays se sont enrichis."
Je réponds: non.
Si deux pays s'enrichissent en commerçant, c'est que leur relation est plus coopérative que concurrentiel. Autrement dit, qu'il y a eu des synergies, ou des rendements croissants, ou des externalités positives (en gros: j'apprends des allemands, et les allemands apprennent de moi). Bref, il s'est produit au niveau du couple franco-allemand, ce que les économistes appellent de la croissance "endogène". Du progrès engendré par les phénomènes coopératifs. Si la concurrence avait vraiment joué, l'Allemagne aurait gagné, la France aurait perdu (ou l'inverse), l'un des deux pays aurait disparu et le premier, le vainqueur, aurait disparu aussi. Ça c'est quelque chose qu'avait très bien compris Marx: le vainqueur ne doit pas tuer le vaincu. Le capitaliste doit laisser l'ouvrier bouffer un peu, sinon il crève lui aussi. C'est ce que n'a pas compris le capitalisme contemporain, qui s'efforce de ruiner le salariat au profit du seul capital.
Pour en revenir au commerce international, l'ouverture des frontières après 45, a engendré dans l'Europe de 58 des phénomènes coopératifs et d'apprentissages (constructeurs) plus forts que les phénomènes concurrentiels (destructeurs). On peut dire qu'entre le Nord et le Sud, la concurrence joue plus que la coopération. Le Nord est entrain de tuer le Sud. Le problème c'est que le Nord n'a pas besoin du Sud. (Nota bene ou exercice: appliquez la relation concurrence-coopération aux relations entre le secteur public et le secteur privé. Entre l'Education nationale et le privé par exemple.)
Un peu d'histoire maintenant. "L'histoire économique est un sourd qui répond à des questions qu'on ne lui a jamais posé", Paul Bairoch paraphrasant Léon Tolstoï. Il faut lire le livre de Bairoch "Mythes et paradoxes de l'histoire économique" paru à La Découverte, pour comprendre que le décollage anglais n'a rien dû au commerce internaitonal, que la colonisation a été un facteur d'appauvrissement plutôt que d'enrichissement réciproque entre les Nations, et que les phases de croissance de l'économie mondiale ne sont pas corrélées avec des phases d'ouverture - témoin la période libérale dominée par une monnaie unique du XIXième siècle. L'économie est malheureusement plus compliqué que le modèle libéral, qui est d'un simplisme navrant et totalisant.
Penser le commerce international autrement
1- Retenons que la coopération crée la croissance plus que la concurrence. On comprendra que se féliciter du solde positif de la balance commercial n'a pas grand intérêt, sauf pour des gens qui n'ont pas suivi l'histoire des Etats-Unis. Des économistes comme Baghwâti ont très bien montré comment la participation au commerce international pouvait appauvrir certains pays:
5ième apologue: Apologue du Cacao
Il me faut des devises pour acheter au Nord, donc je vends du cacao intensivement, mais mon voisin fait pareil, donc le prix du cacao s'effondre, donc il me faut encore plus de devises, donc je produis plus encore de cacao, etc.. L'apologue du cacao est transposable immédiatement au porc en France. Dans le premier cas je détruis la forêt, dans le second j'empoisonne l'eau.
2- Les phrases comme "l'OMC est le juge et l'arbitre de la concurrence internationale et mieux vaut un arbitre que pas d'arbitre". Réponse: non. La ocncurrence n'est pas un principe en soi. Si l'OMC est un organisme qui doit favoriser la coopération entre les nations, soit. Mais s'il doit favoriser la concurrence, non.
3- Le commerce international doit être défini par le maximum non économique, et non par le minimum. Par exemple, ce doit être la clause de la nation la plus socialement favorisée qui doit guider tout échange de marchandise.
4- Si on estime que la diversité est un facteur de culture, alors, plus il y a d'éditeurs et de libraires dans un pays, plus ce pays est intelligent et cultivé. Un casseur de prix comme Amazon.com est une catastrophe culturelle. La loi Lang est une très bonne chose. Le commerce réalise l'uniformisation lorsque triomphe la concurrence, dont l'aboutissement est le monopole, une entreprise ayant éliminé toutes les autres.
5- Le commerce international doit être soumis à la volonté politique, supranationale si elle existe, et, à défaut, nationale. C'est un principe de subsidiarité à l'envers. Mais la volonté politique doit définir ce qui est commercialisable ou non, hors de tout critère marchand. Un marché des droits à polluer est la preuve d'un échec politique, moral, et d'un échec de civilisation: c'est le marché qui gère l'environnement. En l'occurrence, on demande au tortionnaire de soigner la victime. On peut demander aussi à la mafia de réguler le droit à la prostitution, etc..
6- Le commerce international, l'OMC, doit accepter la Chine. Sous entendu: le commerce favorise la démocratie. Il fonctionne sur l'opacité et sur le double principe "un dollar égale une voix" et "l'argent n'a pas d'odeur" qui sont deux principes anti-démocratiques.
Je conclurai sur un dernier apologue: HEC contre la banlieue, et je dois encore à Bruno Ventelou ce bel exemple.
Huit élèves d'HEC formés au crétinisme ambiant de la concurrence, jouent contre une équipe de basket de banlieue formée au jeu collectif. ON distribue quatre cartes à chacun, deux noires et deux rouges. ensuite on rammasse deux cartes par personne. Chaque carte rouge gardé dans une main, vaut quatre points à celui qui la garde. Chaque carte rouge donnée à celui qui ramasse les cartes vaut 1 point. HEC joue personnel (concurrence), la banlieue joue collectif (coopération). Qui gagne ?