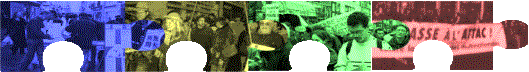
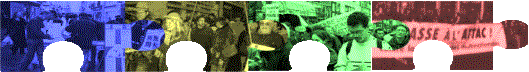 |
I) Les services publics au péril de l'idéologie néo-libérale; luttes et résistances par ceux qui les animent La matinée du 14 mai a été marquée par les interventions de représentants syndicaux qui ont fait le point des luttes récentes dans la Fonction Publique. Présentant la journée, Roland DUMAS, au nom d'ATTAC 63, a mis en lumière les motivations profondes du pouvoir financier lorsqu'il s'attaque aux services publics. Tirer un taux de profit de 15% alors que le taux de croissance est de 3% ne peut avoir qu'un temps. Il faut exploiter d'autres sources de profits. Parallèlement, il est indispensable pour ce pouvoir de continuer à détruire les poches de résistance. Pour le pouvoir financier, le nouvel Eldorado, c'est le vivant: agriculture, génomes, eau, santé, éducation. Le processus de destruction de l'agriculture paysanne au profit de l'agriculture industrielle mérite notre attention. Jacky CHABROL (vice-président d'ATTAC 63) a présenté quelques échos des Etats généraux des élus locaux d'Auvergne qui se sont tenus à Clermont-Ferrand le 12 mai à l'invitation du Président du Sénat. Un travail sur l'aménagement du territoire a donné lieu à une enquête à laquelle 40% de ces élus ont répondu. A la question quelles sont les priorités pour l'aménagement du territoire, la réponse arrivée en tête a été le maintien des services publics en milieu rural (73% des réponses). L'enquête fait également apparaître que les élus locaux ont une bonne perception des services publics: plus de 60% les considèrent comme de qualité. Au cours des débats, on a pu noter le double discours tenu par un certain nombre de responsables nationaux de la majorité sénatoriale ou de la majorité gouvernementale. Tout en se présentant comme soucieux de l'aménagement du territoire, ils affirment que la "mondialisation" est inéluctable et qu'il faut en assumer les conséquences. Ils n'hésitent pas à s'en prendre assez violemment aux "bureaucrates européens" ! Pour Francis VERGNE (F.S.U.), il existe une véritable agression contre le service public et laïque d'éducation qui reste encore la référence majeure en France. Ceux qui s'opposent à la réforme libérale sont traités de conservateurs, d'archaïques. Dans l'optique libérale, l'Education doit être vendue partout avec les nouvelles technologies de communication. Dans les discours accompagnant les dernières réformes, on distingue plusieurs thèmes: - le "moins d'école" car il n'est pas nécessaire d'atteindre le bac+5 pour vendre des pizzas ! - la segmentation qui va contre les finalités globales d'une école républicaine et qui facilite la marchandisation - l'usager devient un consommateur - le "dégraissage du mammouth" ouvre des portes aux services marchands pour assurer certaines disciplines (E.P.S., disciplines artistiques, …). Les "sponsors" introduisent une privatisation rampante. Les luttes récentes qui ont conduit au départ d'Allègre, ont montré qu'il était possible de mobiliser en masse les enseignants et les parents. Pour Thierry FOULQUIER et Claudine CHAVANAZ (C.F.D.T. Santé), le système de santé publique en France est marqué par ses contradictions. Il y a un attachement certain à la médecine libérale et même au sein des hôpitaux publics où l'on retrouve des médecins spécialistes qui exercent en libéral. Il y a également confusion entre médecine et enseignement universitaire: un chef de service est un hospitalo-universitaire. Autre caractéristique, le financement est assuré en grande partie par le salarié cotisant (50%) et par les employeurs (30%; ceux d'entre eux qui utilisent beaucoup de main d'œuvre sont pénalisés). Le plan Juppé a introduit une vision comptable: ce n'est pas le besoin de santé qui détermine les engagements financiers. Le budget est subdivisé en enveloppes par région, ce qui verrouille un peu plus toutes revendications locales. Le dérapage dans les dépenses de santé "bénéficie" surtout aux grands laboratoires pharmaceutiques (+ de 40% en 10 ans), mais la seule variable facile d'ajustement est l'emploi dans les hôpitaux publics (70% de leurs budgets). Christophe DULCIRE (C.G.T. Impôts): Le ministère des Finances vient de connaître ces derniers mois un conflit majeur, provoqué par un projet de réforme présenté par les ministres Strauss Kahn et Sautter. Sous couvert d'un meilleur service à l'"usager", il s'agissait, en conformité avec les directives de réduction des déficits publics issues du traité d'Amsterdam, et dans l'esprit qui anime la réforme de l'Etat, de rechercher un fonctionnement à moindre coût. Comme pour toutes les administrations et services publics, les premières mesures se déclinaient en terme d'emplois: en 3 ans, 3000 suppressions de postes étaient annoncées aux impôts, et 1000 perceptions (Trésor public) devaient être fermées, principalement en milieu rural. Par ailleurs, cette recherche de rentabilité a des incidences importantes sur la politique fiscale. Le rapport "coût/rendement" institué depuis quelque temps par le ministère a tendance à se substituer aux critères habituels de justice fiscale ou d'efficacité économique pour juger de la validité d'une taxe ou d'un impôt. Concrètement, c'est la mise en danger du seul impôt progressif (où le taux s'accroît avec le revenu), l'impôt sur le revenu, au bénéfice des impôts proportionnels (où chacun contribue en proportion de ses revenus ou de sa consommation). Il doit être noté que l'impôt sur le revenu ne représente déjà plus en France que 17% des rentrées fiscales, contre plus de 44% pour la TVA. La combativité des personnels, la réaction des élus et l'appui des usagers ont entraîné l'échec et la démission du ministre Sautter. Des questions importantes restent cependant en suspend : - La réforme de l'Etat continue de se mettre en place, dans le cadre évoqué précédemment de réduction des dépenses et de privatisation des services publics; les déclarations des représentants français au récent sommet de Lisbonne sont sans ambiguïté: il faut "moderniser" (en clair: privatiser) les services publics, à commencer par l'énergie et les transports. Une "vraie" réforme du ministère, jugée par tous indispensable, et que le nouveau ministre L. Fabius s'est engagé à mener, échappera-t-elle à cette logique ? En particulier, quel avenir pour le service du Cadastre, menacé de privatisation par un rapport concomitant au projet de réforme ? - Avec quels objectifs, quelles modalités de consultation des représentants des personnels et des citoyens, la réforme sera-t-elle menée ? - Quelle place sera attribuée au Service public fiscal et foncier dans le cadre des projets territoriaux qui sont en train de se mettre en place dans tous les départements ? Bernard FAVODON (Confédération Paysanne) pose le problème en terme d'aménagement du territoire. L'agriculture, telle qu'elle est actuellement conçue, va ramener à 100 000 le nombre d'agriculteurs en France avec pour conséquences la désertification de certaines zones et la disparition logique des services publics. Pour la Confédération Paysanne il faut encourager, en France comme à l'étranger, l'autosuffisance et l'autonomie alimentaire. Il faut moins de capitaux et plus de valeur ajoutée. Cette agriculture de proximité fournit une alimentation de qualité. Le rôle de l'agriculteur dépasse largement la fonction de production et on doit prendre en compte sa place dans l'aménagement du territoire et l'occupation de l'espace. Vu dans Alerte Générale à la Capture des Services publics / Coordination pour le Contrôle Citoyen de l'OMC (CCM-OMC), avril 2000 :
II) Quels services au public et pour quel aménagement du territoire ? Quel fonctionnement et quels salariés ? Avec quels moyens ? La notion de service public Les accords de Marrakech de 1994 fondant l'OMC donne la définition suivante du service public : " Tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de service ". Si l'on s'en tient à cette définition, c'est pratiquement tout le secteur public qui doit être "libéralisé" à l'exception de l'armée et de la justice. A cette définition de l'OMC nous préférons celle de René Passet (président du Conseil scientifique d'ATTAC) qui distingue l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Le critère de l'utilité individuelle ou collective permet de souligner trois types d'activités : 1) Les activités concernant la satisfaction des besoins individuels mettant en cause des agents individuels (consommateurs, commerçants, artisans, activités à faibles effets induits sur la collectivité) et qui ne sont pas de nature à infléchir le choix des finalités sociales. 2) Les activités qui par leur nature (biens collectifs, santé, éducation, sécurité,…) relèvent d'une certaine conception de l'utilité sociale, échappent à la logique du marché et doivent être assumées par la collectivité. 3) Les activités susceptibles de rentabilisation par le marché mais qui, par leur nature et la masse des effets induits qu'elles comportent ou le pouvoir qu'elles confèrent à ceux qui les détiennent, engagent en fait l'avenir de la collectivité (banques, industries lourdes, armements,…). Tel est le champ de l'entreprise publique, de la planification, du contrôle étatique. On peut aussi dire que les "droits de l'homme" (droit au travail, droit à la santé, droit au savoir, droit au logement) définissent des droits fondamentaux qui doivent être assurés à chaque individu par la collectivité d'où la nécessité de services publics. L'importance du rôle des services publics Dans les sociétés où les services publics ont été démantelés ou s'ils sont faibles, on constate une augmentation des inégalités et donc de la violence sous toutes ses formes : sociales, accidents, atteintes à l'environnement… L'exemple de la Grande-Bretagne est particulièrement édifiant. En cherchant à s'accaparer le secteur public les transnationales cherchent avant tout à satisfaire leurs appétits financiers. Le maintien des services publics est encore plus important dans une région pauvre et rurale (donc sans intérêt pour les transnationales). Il n'est pas surprenant qu'en Auvergne les élus locaux soient sensibilisés sur cette question. Le champ d'action du secteur public Le service public assuré actuellement en France par les 3 fonctions publiques (Etat, Hospitalière et Territoriale) doit être maintenu. Abandonner au secteur marchand la santé ou l'éducation reviendrait à considérer le malade ou le demandeur de savoir comme une source de profit. Un monopole de service public doit être établi dans un certain nombre de secteurs: la Poste, les Telecom, l'Energie électrique ou gazière, les transports en commun, l'Eau, la gestion des déchets. Le niveau de fonctionnement du service public La dimension européenne paraît nécessaire pour un certain nombre de services publics: Poste, Telecom, transports par voie ferrée. La gestion de l'eau suppose au minimum un échelon national mais pour certains bassins, on ne peut que dépasser le cadre des frontières. Idem pour le traitement des déchets. Le contrôle des services publics Le monopole dans les services publics sera une bonne chose s'il y a des contrôles indépendants associant les usagers. Des instances de contrôles indépendantes soutenues par une législation et un financement adéquats devraient être mises en place. Un service public ne doit pas être son propre contrôleur comme c'est le cas pour EDF avec l'énergie nucléaire. Des commissions tripartites avec voix consultatives associant à certains niveaux les pouvoirs publics, les salariés et les usagers pourraient être envisagées. Il faut lutter contre la propagande tendant à associer service public et archaïsme. De nombreuses innovations technologiques (Ariane, TGV, télécommunications,…) sont le fait d'entreprises publiques. Très souvent la recherche publique découvre et le privé récupère les profits (contrats INSERM, industrie pharmaceutique,…). Les personnels et la précarité 25% de précaires dans la Fonction publique d'Etat, 40% dans la Territoriale, 17% dans l'Hospitalière, on atteint au total le million de personnes. Cela n'est pas admissible, il faut faire pression pour que l'Etat patron montre l'exemple au lieu de ne pas appliquer la loi sur les 35 heures et de développer la précarité. Pour éviter la précarité induite par la sous-traitance, il faut rendre les conditions du marché moins rentable pour le privé en imposant un cahier des charges comprenant un volet social (conditions de travail, salaires). Cette tactique peut amener une réduction de la sous-traitance (exemple: INRA Clermont). Les salariés du secteur public et ceux du secteur privé ont les mêmes adversaires: les transnationales et le pouvoir financier. On doit combattre les tentatives de monter le privé contre le public. Le secteur public avec quels moyens ? Les dépenses publiques ne sont pas un détournement ni un gaspillage de richesses créées. Elles représentent une utilisation d'une partie de ces richesses, pour une part à des fins de production d'une meilleure qualité de vie et pour une autre part à l'amélioration du potentiel de production de valeurs. En 1998 en France, le total des prélèvements obligatoires représentait 44,9% du PIB (produit intérieur brut), ventilé entre 20,6% pour la protection sociale (retraite, santé, chômage, famille), 5,8% pour les collectivités territoriales et 17,2% pour l'Etat. Pour la protection sociale le prélèvement se fait sous la forme de cotisations ou de CSG (contribution sociale généralisée). Le budget de l'Etat représente 20% du PIB. A l'intérieur de ce budget les dépenses en personnel représentent 35% soit 7% du PIB. Les dépenses d'interventions (dont les aides aux entreprises) représentent 27% du budget. La possibilité de financer le développement de l'emploi public repose sur 3 niveaux d'argumentation: 1) Il n'y a pas de chiffre idéal concernant le taux des prélèvements obligatoires. Les différences entre pays reflètent des choix de société concernant les charges collectives (santé, éducation, recherche,…). Le marché et le privé ne permettent pas de répondre correctement à des besoins fondamentaux. 2) Le problème de la rationnalisation des dépenses publiques est un problème réel et il faut s'interroger sur leur efficacité (dépenses militaires, aides aux entreprises,…). 3) Une partie des impôts, taxes ou cotisations joue à contre-courant de la création d'emplois. Certains revenus totalement improductifs sont oubliés (taxe Tobin). En zone rurale, la création de communautés de communes (qui doivent être dirigées par des responsables élus au suffrage direct) peuvent faciliter la création d'emplois publics. Conclusion Nous manquons d'enseignants, de juges, de personnels dans les transports, de gardiens de prisons, de policiers, d'éducateurs, d'inspecteurs du travail, d'infirmiers, de médecins urgentistes,... Une liste à n'en pas finir d'emplois alors que le chômage attend tant de jeunes. Pourquoi ne pas mettre en avant les besoins réels de la société et, à partir de là, élaborer le budget sans exclure qu'il puisse falloir l'augmenter ? Document réalisé par les responsables des commissions: J.C. BRONDEL, J. CHABROL, Ch. DULCIRE, J. LEBOEUF, Ph. FAVRE, C. VALLENET et avec les contributions de Madeleine GRIGNON et Viviane CHEX pour le compte rendu de la matinée. ATTAC 63, Maison des associations, 2 Boulevard Trudaine, 63000 CLERMONT-FERRAND |
| GROUPES LOCAUX |