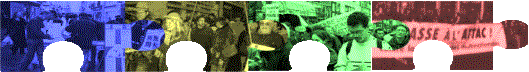
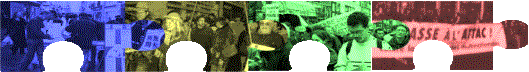 |
Modérateur : A. Prawerman. Le sujet de cet atelier, est la mondialisation financière et son implication dans les pratiques de soins.. Un petit historique pour introduire le débat : dans les années 5O nous avions des hôpitaux publics qui étaient vétustes et qui servaient de lieux sociaux, des cliniques privées tenues par des congrégations religieuses et des spécialistes qui travaillaient comme on pouvait le faire à l’époque. Avec le développement explosif des techniques médicales en une dizaine ou une quinzaine d’années, la situation s’est modifiée avec l’apparition d’hôpitaux qui sont gigantesques. Dans les années 7O-8O d’une part, une logique de concentration qui favorise les appétits à faire des profits financiers sur les investissements qui sont déjà en place et d’autre part, le développement des cliniques privées avec le système de conventionnement qui atténue l’opposition entre le public et le privé puisque tant l’hôpital public que l’hôpital privé ont le même type de financement. Ce sont les remboursements de la sécurité sociale, argent non pas public mais argent commun, qui est prélevé essentiellement sur les fruits du travail et non pas sur les bénéfices des capitaux. Les services publics de santé ont besoin de s’adapter à une société en pleine mutation, il y a des réformes indispensables partout, on en parlera au cours de chacun des débats, la question qui se pose vraiment est : est-ce que la libéralisation et la marchandisation est la seule réponse à ce besoin de réforme ? C’est par un exposé de Bernard Topuz qui a coécrit un livre : « les lobbies contre la santé » et ensuite Gérard Berthiot médecin hospitalier qui nous exposera les problèmes que la mondialisation peut avoir sur la vie de l’hôpital public. Je vous propose ensuite d’élargir le débat, parce que la pratique de soins ne se résume pas à la prise de médicaments, qu’on aborde le problème du déséquilibre actuel entre les médecins généralistes de proximité et la pléthore de médecins spécialistes qui aboutit à une ségrégation des soins et à une surconsommation qui est préjudiciable à une bonne santé. Les lobbies contre la santé : Intervenant : B. Topuz Merci de m’ avoir invité. En introduction je voudrai commencer par préciser quel a été mon itinéraire : j’ai été médecin généraliste pendant 8 ans, puis je suis rentré dans la santé publique et actuellement je dirige le service de protection maternelle et infantile (PMI) de Seine Saint Denis. Dans la partie de ma vie où j’étais médecin généraliste, j’ai collaboré, participé à une revue qui s’appelle la revue «Prescrire » qui est une revue indépendante des intérêts pharmaceutiques et également des pouvoirs publics. Elle s’autofinance complètement, et constitue un pôle indépendant et critique sur l’organisation du soin et de la santé en France. Il s’agit d’une revue de formation continue des médecins et des pharmaciens. Les exemples que je vais donner dans mon exposé sont tirés en partie du compagnonnage avec cette revue. L’enjeu de cette revue est important : il porte sur une organisation de l’information des professions de santé qui soit indépendante des intérêts financiers de l’industrie pharmaceutique. Avant de rentrer dans le vif du sujet je souhaiterai rappeler quelques notions qui permettront de mieux cerner le champ que je vais aborder : -la différence entre d’une part la santé , ses déterminants et d’autre part la médecine. -la différence entre différents types de soins : quand on ne va pas bien, on peut avoir recours à des soins qui sont de l’ordre de la médecine et/ou à d’autres soins qui sont d’un autre registre. Au cours de l’exposé, je me limiterai essentiellement au registre des soins médicaux et plus particulièrement à la situation des médicaments en France. Dans le livre que j’ai coécrit avec Roger Lenglet, nous avons élargi notre propos en montrant comment des lobbies industriels pouvaient paralyser les autorités publiques dans des domaines plus vastes. A côté du médicament, nous avons exploré le champ de l’environnement autour des problèmes de l’eau et des décharges toxiques, le champ de l’amiante, et celui de la politique sur l’alcool et le tabac. Ces quatre domaines ont en commun d’avoir une influence déterminante sur la santé. Mais venons en maintenant au médicament et commençons à planter le décor : d’un côté il y a l’état, qui est censé organiser, légiférer, réguler, de l’autre il y a un énorme complexe médico-industriel ; enfin il y a la société civile. Je pense que l’analyse d’ATTAC différencie bien ces trois acteurs. Nous allons tenter de comprendre comment ils interfèrent ensemble. Je vais partir d’exemples très concrets sur la pénétration des intérêts industriels et commerciaux dans les pratiques de soins ; à partir de ces exemples nous rebâtirons ensemble les mécanismes sous-jacents qui conditionnent la situation actuelle. Les exemples choisis permettent d’illustrer trois idées : La première idée porte sur le très grand nombre de médicaments sans efficacité prouvée et néanmoins remboursés par la Sécurité Sociale. Cela a fait la une des journaux sans émouvoir les pouvoirs publics ; les plans de déremboursement annoncés s’étaleront sur de nombreuses années . L’argent de la collectivité continuera d’enrichir les laboratoires concernés pour un bénéfice en termes de santé quasi nul. La deuxième idée concerne le maintien sur le marché des médicaments qui ont plus d’inconvénients que d’avantages. Et la troisième idée est relative à la médicalisation générale de notre vie quotidienne avec les inconvénients que cela comporte. Pour naviguer parmi ces exemples, je suivrai une trame chronologique de la naissance de l’humain jusqu’à sa mort. Dans le contexte médical de la naissance, commençons par trois types de médicaments fréquemment prescrits : le fluor , les médicaments contre la diarrhée infantile et le prepulsid donné contre les régurgitations. En matière de fluor, au début des années 90, l’industrie pharmaceutique faisait de la publicité pour que tous les enfants prennent du fluor y compris dans les villes où l’eau est naturellement fluorée. Le fluor a un intérêt pour la prévention de la carie dentaire, mais la dose toxique est proche de la dose efficace au niveau préventif. La dose toxique donne une fluorose : on a des dents qui deviennent grises et puis qui se cassent avec d’autres inconvénients plus importants. D’où la nécessité d’encadrer la prescription de ce médicament de façon stricte et de ne pas en généraliser l’usage, d’autant que nous avons un certain nombre de sources d’apport fluoré dans notre vie quotidienne: un grand nombre d’eaux, certains sels, le thé, les dentifrices. Il y a eu plusieurs consensus d’experts européens et nord américains qui ont proposé de ne plus prescrire de fluor aux enfants de moins de 3 ans et de réfléchir au type d’ajout de fluor à partir de 3 ans .Le plus logique est d’utiliser le sel fluoré en vente dans les grandes surfaces chaque fois que la dose de fluor apportée par l’eau est faible. C’est quand même plus simple que de penser à donner un médicament chaque jour à son enfant. L’essentiel des recommandations soulignait le risque de fluorose si on continuait à prescrire du fluor médicamenteux de façon systématique. Au Canada et aux Etats-Unis la politique de supplémentation en fluor a conduit à de nombreuses fluoroses bien décrites depuis 3O ans. Ces informations ont été publiées par la revue « Prescrire » il y a 4 ans. A l’heure actuelle les laboratoires continuent de multiplier le marketing et je peux vous dire que dans le département où je travaille, les bébés sortent de chacune des 17 maternités avec des ordonnances de fluor. Mon deuxième exemple porte sur la diarrhée infantile, symptôme banal qui peut tourner au drame : il arrive que le nourrisson se déshydrate et meurt. Vision des pays du tiers monde ? Pas seulement. Les données de l’INSERM indiquent une cinquantaine de décès annuels en France liés à la déshydratation et plusieurs milliers d’hospitalisations. La déshydratation depuis vingt ans est très facile à prévenir à travers la prise de sels de réhydratation orale. Or ceux ci ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale et donc peu utilisés. Ils permettent à l’eau d’être retenue dans le sang au lieu de fuir dans le tube digestif. Produit simple et peu coûteux dont l’usage est recommandé depuis vingt ans en prévention de la déshydratation. La déshydratation est un problème de santé publique : avec la bronchiolite, ce sont les deux premières causes d’hospitalisation du nourrisson. Or en France, selon plusieurs études épidémiologiques, un médecin seulement sur trois, prescrit des sels de réhydratation orale quand ils rencontre un bébé qui a une diarrhée ; par contre il prescrit une série de médicaments dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déconseille l’usage. Pour une fois l’OMS a publié un livre où elle critique de façon très argumentée l’usage des médicaments anti-diarrhéiques qui n’ont pas de réelle utilité et qui risquent de détourner le patient des sels de réhydratation orale. Ces médicaments présents sur le marché français sont pour la plupart, remboursés par la sécurité sociale, alors que leur usage n’a pas d’efficacité démontrée sur la déshydratation ( l’ultra levure et le smecta en sont quelques exemples), et que le produit qui devrait être utilisé, n’a pas le statut de médicament et n’est pas remboursé par la Sécurité sociale. Un troisième exemple : le Prépulsid contre la régurgitation. La régurgitation est assez naturelle chez le nourrisson puisque la porte de son estomac (le sphincter) commence à bien fonctionner vers la fin de sa première année. Traditionnellement on offrait au bébé un bavoir et on lui faisait faire son rôt. . Récemment un médicament, le Prépulsid rattaché à la classe des neuroleptiques, a pris une place importante sur le marché. Il a des inconvénients forts à savoir des troubles cardiaques, notamment quand le bébé est aussi traité par certains antibiotiques ou anti mycosiques, ce qui est fréquent. Dans une étude officielle faite dans une crèche des Yvelines, on s’est aperçu qu’un bébé sur trois était sous Prépulsid. La multiplication des prescriptions de Prepulsid occasionne des situations à risque grave pour ce trouble de régurgitation qui dans la plupart des cas peut être simplement résolu par des mesures d’hygiène et des laits épaissis.. Le Prépulsid vient d’être retiré du marché aux USA, les autorités françaises ont décidé de lancer des avertissements mais de le laisser sur le marché. Il y a un décalage entre le risque encouru par cette utilisation massive de Prepulsid et le bénéfice obtenu. Pour les adultes, le phénomène le plus révoltant est la prescription impressionnante de psychotropes en France ; ce sont les médicaments qui agissent sur le psychisme, tranquillisants, neuroleptiques, anti dépresseurs. A l’heure actuelle, on consomme huit fois plus de tranquillisants en France qu’en Grande Bretagne à niveau de population équivalent ; on peut s’interroger sur cette consommation, ainsi que par rapport à l’information qui est faite sur ces médicaments.. Pas plus tard qu’hier, dans ma famille un médecin a prescrit du Stilnox, tranquillisant rattaché à la classe des somnifères ; quand j’étais étudiant en médecine le marketing nous indiquait qu’il n’avait pas les effets secondaires des autres tranquillisants, à savoir l’induction de dépendance. Or la revue «Prescrire » a récemment révélé qu’il provoquait une dépendance comme les autres. Cela a d’ailleurs été repris dans le «Monde ». Défaut d’information très classique. L’ histoire de l’information sur l’Halcion est également édifiante. Plus de deux mille patients ont porté plainte contre la firme en Grande Bretagne car elle avait caché les effets rebonds à type d’instabilité et d’agitation parfois très forte, à distance de la prise. Le témoignage des patients interrogés trop prématurément après la prise du médicament n’en faisait pas état dans les essais cliniques. L’Halcion a par la suite été retiré de la vente dans certains pays. Le laboratoire a reconnu avoir dissimulé certaines données. A travers l’utilisation des psychotropes, on peut s’interroger sur la médicalisation des personnes dans leur vie quotidienne. Aux USA l’association des psychiatres financée par l’industrie pharmaceutique a réécrit la classification des maladies touchant le psychisme, en y intégrant de plus en plus de symptômes de la vie quotidienne. Par exemple l’agressivité du conducteur devient une maladie. A chaque maladie convient un médicament. On a véritablement une réécriture de la médecine pour favoriser la vente de médicaments. L’hyper agitation du jeune enfant est un autre exemple qui, aux USA et au Canada donne lieu à des prescriptions démesurées. On peut trouver 5 à 10 % des enfants dans certaines écoles qui sont traités par Ritaline . Au lieu de s’interroger sur le pourquoi de l’agitation et de trouver des causes affectives, sociales, environnementales, l’industrie pharmaceutique s’est engouffrée dans ce marché pour généraliser l’usage de la Ritaline. En France, pays de culture plus analytique, l’influence de Françoise Dolto a été déterminante : la prescription reste bien cadrée pour l’instant. La définition utilisée par les psychiatres américains conduit à se dire que 3 à 5% des enfants devraient être sous Ritaline alors que la définition de l’OMS conduit à une reconnaissance de ce trouble chez seulement 0,5% des enfants. On voit là l’enjeu de la définition de normes. Elles ouvrent un marché gigantesque. L’industrie est prête à mettre toute son influence dans la bataille. Un autre type de médicaments utilisé massivement à mauvais escient, est la classe des vasodilatateurs cérébraux. Le concept même d’insuffisance circulatoire cérébrale chronique semble avoir été inventé par les secteurs marketing des firmes pharmaceutiques. Il est officiellement récusé par l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale. Cette classe de médicaments sans efficacité démontrée a changé plusieurs fois de noms ces trente dernières années. Dans les 15 médicaments les plus vendus en France en 1995 on en trouve trois qui font partie de cette famille : le vastarel, le tanakan et le sermion. C’est un concept complètement creux. A sa défense, il s’agit d’une belle image que les médecins de Molière n’auraient pas récusé. Nous imaginons les vaisseaux dans notre cerveau qui se dilatent avec de l’oxygène et de l’énergie qui arrivent en plus... mais c’est une image fausse. Ça fait partie de ces médicaments inutiles très largement prescrits. Je ferai une transition maintenant avec la situation des personnes âgées. Des études montrent que dans certaines maisons de retraite, un tiers des personnes âgées consomme 5 médicaments ou plus. Parmi ces médicaments, certains bien sûr sont efficaces, d’autres non.. Mon propos n’est pas d’être anti-médicament mais de pointer l’importance de l’usage irrationnel et démesuré du médicament. Quand les débordements de consommation deviennent la norme la situation devient critique. Quand vous discutez avec certaines personnes âgées, ils en ont parfois marre de tous ces médicaments ; il leur arrive de tout bazarder, les utiles et les inutiles, ce qui aura aussi des conséquences sur leur santé. On pourrait prolonger la litanie de ces exemples : par exemple vous trouverez un excellent article à propos du marché français des laxatifs dans la revue 60 millions de consommateurs. Les médicaments anti-cancéreux représentent aussi une jungle où un certain nombre de médicaments sont mis sur le marché dans des indications où ils n’apportent pas forcément de bénéfices et, où par contre, ils ont des effets secondaires très lourds ; la situation de la lutte anti-cancéreuse en France est plutôt dramatique... Des études faites dans les hôpitaux quand Bernard Kouchner était ministre de la santé, signalent qu’environ 18000 morts par an sont dues aux médicaments ; ces chiffres ont été publiés par la presse après avoir été maintenus secrets. Bernard Kouchner y faisait allusion sous forme de pourcentage . On ne dit pas assez .la toxicité induite par un usage irrationnel du médicament.. Remontons maintenant aux mécanismes sous jacents à l’organisation de ce marché. Je développerai pour cela deux idées : La première porte sur le pouvoir d’influence considérable des laboratoires pharmaceutiques en matière d’information ; ce pouvoir prend plusieurs formes : la forme la plus banale est l’organisation d’informations biaisées, adressées à la fois, à la population à travers des tas de revues grands publics financées par leur publicité, mais également à travers des revues destinées aux professionnels de santé. Tout médecin reçoit dans sa boîte aux lettres 3 à 4 revues gratuites parce que financées par les publicités du laboratoire. Dans ces revues il est difficile de faire la différence entre ce qui est de l’ordre du rédactionnel ou de la publicité. Quand la revue «Prescrire » a publié ses premiers articles préconisant d’arrêter les prescriptions de fluor dès la naissance, le laboratoire a pris contact avec des pédiatres et financé un numéro exceptionnel de la revue pédiatrique «archives pédiatriques », concluant qu’il fallait continuer les prescriptions systématiques sans retenir les arguments critiques. La quatrième de couverture de ce numéro spécial était une publicité pour le médicament à base de fluor du laboratoire.. Dans un congrès récent de pédiatrie, deux heures de formation ont été organisées sur la diarrhée infantile, sujet d’autant plus intéressant qu’une étude récente dans 7 hôpitaux du nord de la France incluant 326 nourrissons hospitalisés, montre que les sels de réhydratation n’ont été prescrits que dans 35% des cas par le médecin qui a vu l’enfant au préalable. Pendant la semaine d’étude, il y a eu un décès lié à la déshydratation, et deux enfants ont gardé des séquelles très graves. Le congrès, financé par des laboratoires évacue le problème en deux minutes. En effet les sels de réhydratation ne sont pas enregistrés comme des médicaments contrairement à la flopée de médicaments sans réelle efficacité qui sont remboursés et sur la consommation desquels les laboratoires sont intéressés . On peut résumer la question par une formule lapidaire : information biaisée, formation médicale noyautée. Dans les ordonnances Juppé de 1995 il y avait bien obligation de formation continue impartiale pour les médecins mais cette obligation n’est toujours pas mise en oeuvre. La question de l’impartialité de la formation a donné lieu à beaucoup de débats. Un exemple de formation très fréquente destinée aux généralistes, est la soirée financée par un laboratoire avec repas et bon vin. Le sujet débouche le plus souvent sur les produits du laboratoire financeur. Cela ne veut pas dire que cela exclut des formations de qualité mais elles restent marginales dans ce contexte. L’information vers les médecins passe aussi à travers les visiteurs médicaux. Des études faites sur les visiteurs médicaux montrent que les informations données aux médecins pendant la visite du délégué du laboratoire sont fausses dans un tiers des cas, et que dans les quatre cinquièmes des cas les effets néfastes des médicaments ne sont pas signalés. On notera que 60 à70 % des médecins considèrent que la visite médicale faite par les délégués médicaux des laboratoires est leur principale source d’information. Une autre forme d’influence est l’achat de leaders d’opinions. Edouard Zarifian auteur d’un rapport commandé par Simone Veil en 1995 sur les psychotropes a décrit le lobbying d’environnement : véritable processus d’acculturation, qui introduit dans l’esprit des médecins des représentations de la clinique, de la pathologie et du traitement le plus favorables possible à la prescription médicamenteuse. Il montre comment le corps médical est enfermé dans une vision de la maladie et du système de soins complètement référencée par les critères des firmes pharmaceutiques. Un exemple, le marché des anti-dépresseurs : une campagne des laboratoires a été amplifiée par des psychiatres éminents. Elle visait à criminaliser les médecins non-prescripteurs d’anti dépresseurs, en faisant croire que la montée des suicides en France était liée au fait qu’ils n’en prescrivaient pas assez. Pourtant la majorité des suicides sont liés à une détresse sociale sur laquelle les antidépresseurs n’ont pas d’action. Seuls 3 à 4% des suicides sont liés à des facteurs psychopathologiques. Ainsi le chaîne des informations est contrôlée de l’amont à l’aval, c’est à dire de la création des critères de diagnostique jusqu’à l’information délivrée aux prescripteurs en passant par le recours aux médias grands publics dont le médecin est également lecteur. La boucle est bouclée. D’ailleurs les firmes vont même jusqu’à investir dans le champs de l’éducation pour la santé : le syndicat national de l’industrie pharmaceutique organise depuis quelques années une campagne d’éducation pour la santé sur le bon usage du médicament, dans les écoles, avec les enseignants. Impressionné par la qualité du matériel pédagogique élaboré, on s’inquiète néanmoins que le principal message délivré dans la campagne soit : quand on va mal, il faut prendre des médicaments. La campagne réduit le soin à la consommation de médicaments. La manipulation de l’information passe aussi par des subventions de l’industrie à certaines associations de patients qui sans en avoir une conscience très claire peuvent devenir le relais des intérêts pharmaceutiques. Un exemple,au début des années 90, fut l’énorme campagne organisée par une firme pharmaceutique lors de la sortie de son antimigraineux, le sumatriptan, afin d’obtenir son remboursement par la Sécurité sociale . Le sumatriptan était plus cher que les produits anti migraineux déjà sur le marché. Le laboratoire arguait d’une efficacité bien plus importante. Quatre ans plus tard, une étude montre que ce produit a une efficacité comparable aux autres anti-migraineux. Les associations de patients représentent un contre pouvoir trop précieux pour se laisser aller à la moindre naïveté.. Le deuxième mécanisme perturbant est le noyautage et la paralysie des autorités de l’état organisés par les industriels. L ‘exemple le plus flagrant est celui de l’amiante détaillé dans l’autre partie de notre ouvrage. On y montre comment la commission chargée de ce dossier au sein du ministère a été infiltrée, noyautée et manipulée pendant quinze ans par certains de ses membres qui étaient directement payés par l’industrie. Ainsi, quand l’état délègue des fonctions essentielles aux industriels ce sont les intérêts industriels qui se jouent contre l’intérêt sanitaire de la population. L’évaluation du médicament est un moment important pour observer ce jeu d’influence. L’agence du médicament a été créée en France en 1993.. En regardant la constitution des commissions consultatives de l’agence, on s’aperçoit que la plupart des experts sont subventionnés voire salariés par les laboratoires. .Or s’il y a bien un principe à sauvegarder, c’est la distinction forte entre ceux qui produisent et ceux qui évaluent, comme l’ont montré tous les scandales récents de santé publique. En 1994 Simone Veil impose à l’agence un rapport annuel comportant la publication des liens d’intérêt des experts travaillant pour l’Agence . Finalement trente quatre pages des deux cent vingt quatre pages de ce rapport exposent les liens d’intérêt entre experts et laboratoires sans que personne ne s’en émeuve réellement .La confusion des rôles est pourtant très préoccupante. Dans l’enquête menée dans le cadre de la rédaction du livre, j’ai interrogé un expert qui venait de perdre ses fonctions à l’agence. Il m’a relaté la mise sur le marché d’un médicament vasodilatateur cérébral l’adlone dans les années 80. Cet exemple en dit long. Avant la prise de décision de mise sur le marché, il existait un effet secondaire hépatique dangereux documenté, alors que l’efficacité de ce médicament n’était pas prouvée. L’expert a donné deux avis défavorables, avant que le ministère ne se décide de faire appel à un autre expert plus complaisant. Le laboratoire recevra alors l’autorisation de mise sur le marché pour son médicament en 1985. En 1989 le médicament sera finalement retiré du marché suite à 82 cas d’hépatites dont un mortel enregistrés durant les six mois précédant la décision… Dans un autre registre, la cour des comptes a publié un rapport repris par le «canard enchaîné » sur un médicament à base d’huile de poisson, le maxepa, destiné à lutter contre le cholestérol, médicament sans efficacité prouvée mais remboursé par la Sécurité sociale. Enquête faite, le laboratoire Pierre Fabre avait mis entre les mains du ministre de la santé de l’époque, Claude Evin, un marché : « ce médicament obtient un prix fort et un remboursement par la Sécurité sociale et on vous construit une usine sur votre circonscription électorale. » En 1999, l’émission de télévision « Argent public » a enquêté à Castres où siège le laboratoire. Elle a bien montré le rapport de force entre le ministère et le laboratoire : si vous nous déremboursez nos médicaments, ce sont cent cinquante personnes que nous mettrons au chômage. Entre la dynamique industrielle et la dynamique de l’intérêt public pris dans sa globalité, c’est bien souvent la dynamique industrielle qui l’emporte. Ainsi récemment, Martine Aubry, au lieu de décider de ne plus rembourser les médicaments inutiles, s’est engagée, sur plusieurs années à baisser leur taux de remboursement. Pour faire valoir leurs intérêts, les industriels se sont dotés de cabinets de lobbying extrêmement performants pour jeter le flou et mener les gens en bateau : par exemple il suffit qu’il y ait une inquiétude sur un rejet des déchets à La Hague, pour qu’une croisière soit organisée pour les journalistes autour du Cotentin. Ces cabinets sont peu connus de l’opinion publique et notre démocratie a un certain déficit dans la compréhension de leur fonctionnement. Ils sont pourtant dangereux et leurs ficelles mériteraient d’être mieux connues. Par exemple, comment jeter le flou sur une question ?. On se souviendra du débat pseudo technique sur l’amiante avec la distinction entre des fibres toxiques et d’autres soit disant moins toxiques alors qu’il existait des solutions de rechange. Ou encore semer la confusion sur qui est qui : c’est ainsi qu’il y a eu confusion entre le comité permanent amiante créé par le lobby industriel et le comité anti-amiante, confusion entre un institut de l’environnement créé par les professionnels des nitrates et l’institut français de l’environnement émanent du ministère. Ces lobbies sont extrêmement réglementés et surveillés aux USA alors qu’en France ils ont la vie belle. Les solutions à venir dépendent en partie de l’équilibre des forces entre le pouvoir médico-industriel, l’état, et la société civile. L’état doit développer une vision collective du risque et garantir à tous, l’accès aux connaissances qui la fondent. Il faut que l’expertise soit contradictoire, transparente et accessible au citoyen. L’état doit aussi développer un service public de santé qui soit capable d’aiguiller les divers acteurs dans des actions coordonnées n’obéissant pas aux logiques marchandes. Le système de santé légué par les pouvoirs de l’après-guerre n’est pas fonctionnel ; des réformes sont indispensables ; il est plus urgent que jamais que la société civile développe un contre-pouvoir fort face aux intérêts du complexe médico-industriel. C’est la santé des populations qui est au centre de ce débat… L’hôpital public Intervenant : Gérard Berthiot : Médecin hospitalier à Chalons en Champagne Vive la grippe ! ! : l’épidémie de grippe de l’an dernier a mis en évidence l’inadaptation des hôpitaux publics à une demande accrue soudaine et dévoilant les disfonctionnements a entraîné un mouvement de contestation des personnels hospitaliers. Un petit retour en arrière : le plan Juppé de 95-96 a entraîné une mobilisation importante en novembre et décembre 95. Malgré cette mobilisation et le changement de pouvoir nous sommes toujours confrontés à ces ordonnances. Les quatre ordonnances : - La R.D.S. remboursement de la dette sociale. - La réforme de la sécurité sociale. - La mise en place de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé pour la médecine de ville. -Enfin la réforme de l’hospitalisation publique, ordonnance qui sert toujours de référence à la politique hospitalière. Son objectif est la limitation des dépenses de santé : le montant des dépenses de l’assurance maladie est voté chaque année par le parlement, ce qui conditionne les budgets hospitaliers. Pour gérer ce budget, l’ordonnance a crée les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), dont les directeurs ont rang de préfet. Ces directeurs interviennent essentiellement sur deux axes : la planification sanitaire déterminant la carte sanitaire et la répartition des budgets entre les établissements de la région pour encadrer les dépenses hospitalières. Parallèlement l’ordonnance impose à chaque établissement une accréditation qui est censé évaluer la qualité des soins. Ainsi est posé le dogme de la maîtrise comptable qui, d’un côté a pour objectif de limiter les dépenses, et de l’autre d’améliorer les soins : l’hôpital public n’a pas pu absorber l’épidémie de grippe cinq ans après la mise en œuvre de cette ordonnance, qui a permis la suppression de 17 000 lits. A ce propos, le mouvement de lutte des personnels hospitaliers a permis le déblocage d’une somme importante : un fond de modernisation et la création de postes de personnel soignant sans remettre en cause le dogme de la maîtrise comptable. Nos gouvernants ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour accroître «la productivité ». Dans les discussions entre l’ARH et les établissements hospitaliers, les budgets sont donnés en fonction de la productivité : il s’agit de produire des points ISA (Indice Synthétique d’Activité). Ces points ISA ont l’ambition d’évaluer à la fois la productivité des services et leurs dépenses ; ils valorisent les actes techniques sans prendre en compte la dimension humaine et sociale du soin. Ce système d’évaluation de la productivité sur le modèle américain, veut mettre en place la notion de coût par pathologie, donnant un prix à chaque maladie et dans la logique libérale concurrentielle, il faut que ça coûte le moins cher possible. A. Prawerman : médecin hospitalier à la retraite. Je remercie G. Berthiot et B. Topuz qui nous ont montrés comment les lobbies avec la complicité des politiques peuvent dévoyer le bien public : ce qui coûte aux uns rapporte aux autres. J’aimerais revenir sur l’hôpital public et l’articulation avec la médecine ambulatoire pour ne pas dire libérale. A propos de l’épidémie de grippe qui a engorgé les urgences, on ne règlera pas le problème, avec l’organisation actuelle des soins, en réinjectant de l’argent. Il faut remonter en amont, c’est au niveau de la prise en charge des patients par la médecine de ville et rurale, qu’on peut trouver des solutions. La maîtrise comptable et l’évaluation par les points ISA ont favorisé la sélection d’activités médicales coûteuses qui deviennent rentables, et plus ça coûte et plus c’est rentable : ce sont des artifices comptables qui font que les actionnaires des complexes médico-industriels vont s’emparer du gâteau fantastique payé par la collectivité. L’hôpital public que, bien sur il faut défendre, présente des anomalies qui appellent des réformes. L’opposition entre l’hôpital public et l’hospitalisation privée n’est pas si tranchée, les médecins ont des formations semblables avec des statuts différents, ces statuts à l’intérieur même de l’hôpital public sont parfois proches de ceux du privé ; le secteur privé hospitalier, les mandarins chefs de service universitaires salariés et subventionnés par l’industrie pharmaceutique forment des féodalités à l’intérieur de l’hôpital, contrastant avec des situations inacceptables : surcharge de travail, manque de personnel... A l’intérieur de l’hôpital le virus du libéralisme est installé. A noter que le secteur privé à but lucratif est financé par la sécurité sociale comme l’hôpital public. Pour finir je voudrais insister sur l’idéologie médicale qui nous est imposée : un symptôme, un médicament ; un problème, une technique. Ce qui entraîne un hyper activisme technologique et une hyper consommation hospitalière. Le débat : Jean Luc Gorel, médecin généraliste, a évoqué un exemple de lutte ayant abouti, bien que beaucoup reste à faire, c’est l’application de la C. M U. (couverture Médicale Universelle), puis les articulations entre la médecine de ville et les hôpitaux avec la répartition du budget de la santé, l’importance des situations sociales dans la genèse des maladies : Budget de la sécurité sociale ou budget social. Yvan Levasseur, président de la mutualité de la Marne, a souligné le caractère solidaire de l’assurance mutualiste que la communauté européenne ne reconnaît pas. Il a également posé le problème du remboursement des «médicaments inutiles ». Dominique Dépinoy, médecin généraliste, médecin libéral ce qui ne veut pas dire adepte du libéralisme, a ouvert de nombreuses pistes. Que tout a été très rapide, la mondialisation de l’industrie est récente. La solitude du médecin à la sortie de la faculté. L’exemple de la revue «prescrire » qui est un élément d’optimiste, le nombre d’abonnés augmente, le nombre de lecteurs émérites augmente, cette revue est indépendante financièrement après avoir été subventionnée par les pouvoirs publics. On ne parle plus d’usagers de soins mais de consommateurs de soins avec des patients mieux instruits. Emergence de contre pouvoirs ? Les médecins qui refusent de recevoir les visiteurs médicaux sont de plus en plus nombreux. Le syndicat de la médecine générale (SMG) trouve dans le plan Juppé des avancées qui ont été bloquées par des syndicats corporatistes. La réflexion du SMG à travers la revue «pratique » l’amène à préciser que ce qui «pourri » la médecine est le paiement à l’acte en favorisant la rentabilité au détriment de la qualité. La santé est devenue un produit comme un autre et les patients veulent tout, tout de suite, il est difficile pour un médecin seul de dire non. Il faut remettre en cause la dichotomie hôpital public et clinique privée ayant d’ailleurs le même financement. Enfin il faut insister sur l’absence de politique de santé publique en France. Pour l’avenir, la planification médicale va s’imposer, car le médecin ne peut rester solitaire. Pendant que les hôpitaux voient leurs lits diminuer, les paramédicaux s’organisent pour le maintien à domicile avec redistribution des rôles. Les médecins n’exerceront plus de la même manière. Des réflexions avec des échanges indépendants, comme dans cet atelier, vont permettre d’avancer. Dominique Lafourcade, médecin de santé publique, apporte une réflexion sur la globalité de la santé, par exemple, pour une personne âgée l’important est-il son état cardiaque ? Qu’elle soit seule ? Ou que son logement soit insalubre ? La santé ne peut se résoudre aux soins, le médecin est certes indispensable mais pas unique ; sont importants l’environnement, la prévention, il faut remettre le patient au centre du débat. Stéphane, infirmier a posé le problème du pouvoir des médecins, c’est d’eux que relève la prescription de médicament. Bernard Topuz rappelle que devant la crise du système de santé on a besoin de la représentation de la population pour dire ce qui est important (où mettre de l’argent ?). Actuellement cette représentation par des syndicats est archaïque, une clarification est indispensable qui se fera probablement au niveau régional. Quant à la question quel médicament est utile ? L’évaluation a fait d’énormes progrès et actuellement on sait apprécier la valeur thérapeutique d’un médicament et se pose le problème du remboursement par la communauté de médicaments à effet placebo ou néfaste. Plutôt que d’opposer «étatisme et libéralisme », assurance publique ou privée, poser les principes de la refondation : pour les assurances non-sélection des risques avec une prime déconnectée du risque, d’autant plus important qu’avec la connaissance de la bio génétique un danger existe de sélectionner les patients. Il faut l’application de la CMU avec un panier de biens et de services minimum. Enfin il faut décloisonner et développer les réseaux de soins pour qu’ils ne soient pas déconnectés de la santé. Alain Béhar, médecin généraliste, la santé, c’est l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) qui le dit, est un état d’équilibre physique, psychique et social, et j’en veux beaucoup à la faculté de ne pas m’avoir formé à la prise en charge globale du malade. A.Prawerman : Le déséquilibre entre le nombre de généralistes et de spécialistes favorise une médecine technocratique. La pléthore de spécialistes, depuis environ dix ans, fait que ce spécialiste pratique la médecine générale de sa spécialité, la globalité du soin est perdue de vue, le patient consomme de l’acte. La place du généraliste est amoindrie, dévalorisée. Cette situation facilite la marchandisation du soin. Jean Marc expose son expérience de vingt ans de traitement de sa «dépression ». Multitudes de thérapeutiques, consommation médicamenteuse. Tout va bien grâce à la musique et à Attac ! ! ! Christian Magnien pose le problème de la comparaison du système de santé français avec ceux de l’étranger. J.L Gorel nous fait part de son expérience : les médecins étrangers qui découvrent notre pratique et surtout le milieu hospitalier, sont frappés par son cloisonnement et sa hiérarchisation. Conclusions G.Berthiot : construire un système de santé basé sur les besoins évalués de la population et non pas à partir d’une maîtrise comptable. B.Topuz expose, à partir de l’exemple de la prise en charge de la mortalité néonatale en Seine St Denis, une alternative exemplaire, où un espace de concertation avec toutes les forces du département, maternités, généralistes, obstétriciens, les politiques, a permis en cinq ans d’abaisser de manière importante la mortalité. Le décloisonnement, la rencontre avec des gens qui se parlent peu, l’implication de la population autour d’un objectif concret, permettent des stratégies plus cohérentes que la pression économique. A.Prawerman : Au cours de ce débat de nombreux problèmes ont été soulevés, il en reste encore beaucoup. Les institutions ont une longue histoire, ce qui explique la difficulté de solutions toutes faites, des réformes tant de nos institutions que de notre manière de travailler sont indispensables. Réformes discutées dans un esprit démocratique et non de profit, sinon les défauts que nous avons analyses ne pourront que servir les forces du marché pour se partager le «gâteau ».
|
|
| GROUPES LOCAUX |